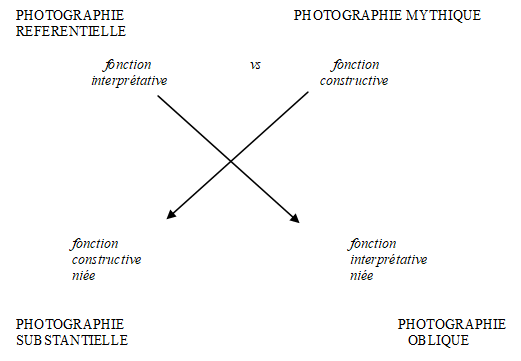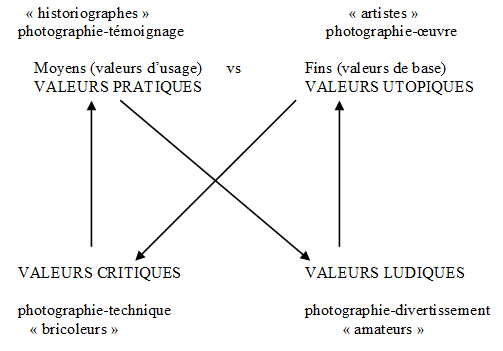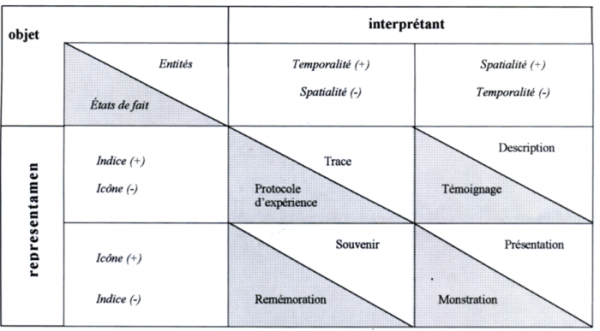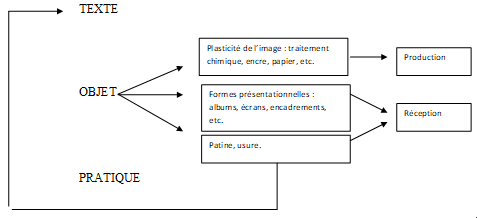Première partie. RECHERCHES THEORIQUES
Cartographie de la recherche sémiotique sur la photographie
Sommaire
Texte
0. Introduction
Dieu fut peintre, sculpteur, architecte ou poète, selon les cas, parce que l’homme l’était. Nous n’avons donc pas de paroles pour décrire une photographie (Van Lier).
- Note de bas de page 1 :
-
Voir à ce sujet Zannier (1982). Sur les systèmes techniques des images photogra-phiques voir Barboza (1996).
- Note de bas de page 2 :
-
Voir Benjamin (1931).
- Note de bas de page 3 :
-
Sorlin (1997) met en lumière comment l’invention de la photographie (et du cinématographe) a transformé les systèmes perceptifs des observateurs et comment, par exemple, la diffusion du portrait photographique a développé le goût pour l’introspection.
- Note de bas de page 4 :
-
Une exception heureuse est Van Lier (1992).
- Note de bas de page 5 :
-
Sans doute le seul qui aille dans cette direction est le précieux exemple de Bourdieu (1965).
- Note de bas de page 6 :
-
Pour le dire très brièvement, par genre visuel on entend une généalogie d’images caractérisée par la même architecture énonciative et par des normes réceptives semblables. Le statut se constitue à travers la stabilisation des pratiques d’interprétation et d’institutionnalisation sociales des photos. Le statut peut être entendu aussi selon le concept d’économie de Bordron (2010) : « L’économie désigne en premier lieu l’ordonnancement qui fonde la possibilité des valeurs et leur éventuelle circulation […]. Interroger l’économie d’une image revient ainsi à se demander dans quel ordre global elle s’inscrit, quelle articulation fondamentale est présupposée pour que l’on puisse la comprendre. […] Remarquons également que les pratiques dans lesquelles les images sont prises s’expliquent, pour une grande part, par l’économie. Cela s’entend immédiatement à propos des modalités sensorielles de l’interprétation. On ne regarde pas selon la même temporalité des images inscrites dans ce que Mallarmé appelait l’« éternel reportage » et celles dont l’économie suppose des instances transcendantes. Il y a des images que l’on peut toucher, d’autres non, etc. ». On reviendra sur le statut dans le chapitre 3.
- Note de bas de page 7 :
-
Plus développée est la recherche sur les fonctions de la photographie dans la recherche scientifique dans les sciences humaines. En ce qui concerne la recherche en histoire, voir Van Ypersele (2007), sur la recherche en anthropologie et en sciences sociales (et notamment sur la photographie-interview) voir Edwards (1992), ainsi que le dossier de Conord (dir.) (2007) et pour la recherche en sociologie voir Becker (2009). Sur le portrait comme genre qui permet d’étudier les différents groupes sociaux dans le cadre des sciences sociales voir Maresca (1996).
Les multiples problématiques liées à l’image photographique ont été soulevées et analysées principalement par la sociologie, par l’anthropologie et par des approches de type historico-artistiques. Dans tous ces secteurs d’étude on rencontre une certaine tendance à étudier la photographie à partir d’une réflexion générale sur le médium, ou à partir d’une histoire des techniques1, en laissant de côté deux questions fondamentale : l’analyse des photographies et la problématisation de leurs usages et de leurs statuts. Ceci arrive le plus souvent dans le domaine de l’histoire de l’art, où se multiplient les histoires de la photographie par auteurs et par techniques, ou encore dans la littérature qui reparcourt l’histoire critique et théorique de la photo, de Baudelaire aux théoriciens contemporains. Plus heuristiques se présentent les études qui mettent en rapport peinture et photographie, même si la mise en relation entre la photographie et les autres arts s’avère toujours légitimée à partir d’une pertinence thématique et donc purement figurative. Nombre d’ouvrages critiques et théoriques, qui se situent entre la philosophie, la médiologie et la science de la culture et des idées, comme par exemple le très célèbre texte de Benjamin2, ou l’ouvrage de Sorlin Les fils de Nadar, s’emploient à décrire l’impact déstabilisant que le médium photographique (c’est-à-dire la photographie en général) a produit sur l’art pictural, sur la société ou sur la perception3. D’autres ouvrages, comme La photographie de Rouillé, retracent non seulement l’histoire de l’impact du médium photographique, mais aussi l’histoire réceptive des théories de la photo jusqu’à nos jours (le vrai photographique, la photographie-document, la photo artistique, etc.) ainsi que le rapport entretenu par la photographie avec les arts contemporains et son utilisation à leur intérieur (photographie-matériau). Mais aucun de ces ouvrages ne s’intéressent ni à l’histoire des formes photographiques4, ni à la poursuite d’une étude systématique sur les rapports entre les pratiques5, les genres et les statuts photographiques6. Même en sémiotique, hormis les admirables ouvrages de Floch (1986), de Schaeffer (1987) et de Beyaert-Geslin (2009), il n’existe aucune problématisation des usages au sein desquels l’image particulière s’insère et acquiert un sens7.
- Note de bas de page 8 :
-
Pour une discussion approfondie sur la tradition d’études peirciennes de la photographie voir Basso infra et Darras (2006).
La sémiotique philo-peircienne de la photographie et notamment l’approche de Dubois (1983), qui a connu pendant longtemps un certain succès, a ramené sa signification à l’acte d’instanciation, sans prêter attention ni aux configurations internes des images, ni aux régimes discursifs ou aux pratiques communicationnelles (et pourtant, elle se présente comme une pragmatique !)8.
Ces théories, au lieu de multiplier les instruments méthodologiques pour rendre compte des diverses stratégies énonciatives des occurrences photographiques, ont réduit le fonctionnement du médium à des définitions de spécificité, à des essences médiatiques et entendu ainsi la photographie comme icône, ou comme indice, ou bien comme symbole du réel. Bref, le versant sémiotique d’obédience peircienne a abordé la problématique de la photographie avec un regard ontologisant et classificateur basé sur des considérations générales et généralistes sur le médium ; le fait que l’énonciation ne soit considérée que comme un acte productif et que ses « traces » sémiotiques à l’intérieur de l’énoncé ne soient pas étudiées témoigne de cette indifférence à l’égard de l’articulation du sens développée par la textualité visuelle.
- Note de bas de page 9 :
-
L’énonciation en tant qu’instance linguistique logiquement présupposée par l’énoncé est à distinguer de l’énonciation en tant qu’acte non linguistique (référentielle) liée à la situation de communication. À son tour l’énonciation en tant qu’instance linguistique logiquement présupposée est à distinguer de l’énonciation énoncée concernant les marques (ou traces) analysables dans l’énoncé et ayant fonctions de simulacres des instances de l’acte énonciatif : « Une confusion regrettable est souvent entretenue entre l’énonciation proprement dite, dont le mode d’existence est d’être le présupposé logique de l’énoncé, et l’énonciation énoncée (ou rapportée) qui n’est que le simulacre imitant, à l’intérieur du discours, le faire énonciatif : le « je », l’« ici » ou le « maintenant » que l’on rencontre dans le discours énoncé, ne représentent aucunement le sujet, l’espace ou le temps de l’énonciation. L’énonciation énoncée est à considérer comme constituant une sous-classe d’énoncés qui se donnent comme le métalangage descriptif (mais non scientifique) de l’énonciation », Greimas et Courtès (1979), entrée énonciation.
- Note de bas de page 10 :
-
Pour Floch (1985) le propos de la sémiotique plastique concerne « le refus de substituer aux objets de sens manifestés par le jeu des formes, des couleurs et des positions, une lexicalisation immédiate de leur seule dimension figurative » et le refus de la confusion du visible et du dicible. C’est donc en étudiant concrètement des images prises dans leur globalité [qu’il faut reconnaitre] ce « systèmes de sens, de type sémi-symbolique, qu’est la sémiotique plastique, où les deux termes d’une catégorie du signifiant peuvent être homologués à ceux d’une catégorie du signifié » (pp. 13-14).
- Note de bas de page 11 :
-
Pour le dire très brièvement, la stratégie énonciative concerne l’épaisseur intersubjective possédée par chaque énoncé, voire le fait que chaque image est le résultat d’une prise de position du producteur (physique mais aussi cognitive, idéologique, passionnelle) et proposée au spectateur. Cela veut dire que chaque image est en même temps le résultat d’une opération transitive (la prise de vue de quelque chose qui est là) et d’une opération intransitive (les choix internes à la prise de vue en elle-même). Voir à ce propos aussi les notions de transparence et opacité chez Marin (1993) qui sont à la base de la théorie de l’énonciation visuelle en sémiotique.
- Note de bas de page 12 :
-
Dans ce sens, il est nécessaire d’éclaircir, d’une fois à l’autre, quels sont les confins de la sémantisation des textes, à savoir les éléments qui sont convoqués comme pertinents à la constitution du sens textuel.
La sémiotique développée par Algirdas Julien Greimas et l’Ecole de Paris, qui choisit en revanche l’énoncé comme unité pertinente d’analyse, et plus précisément les traces de l’acte énonciatif dans l’énoncé (« énonciation énoncée »)9 et la lecture plastique de l’image10, a le mérite de désontologiser le discours sur l’image photographique. Elle se détache d’une classification par médium en ouvrant ainsi l’analyse à la variété des stratégies énonciatives11 et, avec l’ouvrage de Floch (1986), à la problématique des diverses pratiques d’interprétation et de réception de la photographie. Poursuivre sur cette voie et prendre en compte la pratique réceptive selon laquelle une image est sémantisée au cours de son existence, ou le statut social sous lequel elle circule, permettrait à l’analyste de mieux en justifier la lecture et d’expliquer comment on choisit certains traits pertinents plutôt que d’autres12. On reviendra sur toutes ces questions au chapitre 3.
- Note de bas de page 13 :
-
De plus, l’image doit être analysée à partir d’une sémiotique qui considère l’énonciation corporelle à la base de la médiation sémiotique elle-même. L’image revendique le fait que son énonciation, afférente à un langage visuel, est intimement ancrée dans une énonciation corporelle en tant qu’elle doit être perçue comme objet matériel doté d’un support d’inscription.
Il nous faut tout de suite préciser notre manière d’utiliser les termes « énoncé » en tant que produit d’une énonciation et texte en tant que produit d’une textualisation. Dans cette étude nous emploierons le terme « énoncé » et « texte » comme synonymes en entendant par ces derniers aussi des manifestations visuelles voire photographiques. En fait, en suivant la terminologie de la sémiotique greimassienne, le terme « texte » peut être entendu de deux manières : en tant qu’objet et en tant que paradigme. En tant qu’objet, et c’est ce qui nous intéresse ici de plus près, il concerne un plan de l’expression et un plan du contenu liés par les actes d’énonciation productif et réceptif qui en déterminent la constitution. Le texte concerne donc une configuration qui construit « un tout de signification ». Dans ce sens on peut considérer une image photographique en tant que texte : les images sont elles aussi des configurations attestées, délimitées et informées par la discursivité. L’image, comme tout énoncé, est un tissu, un tout de signification, qui institue des corrélations particulières entre plan de l’expression et plan du contenu via l’instance médiatrice de l’énonciation. L’image, comme le texte verbal, n’est pas une pure somme de signes et possède une syntaxe signifiante qui fait partie de son organisation discursive propre13.
- Note de bas de page 14 :
-
Dans l’histoire de la sémiotique récente on pourrait opposer le paradigme textuel de Greimas (où, par exemple, le sens d’un ouvrage littéraire est reconstruit à partir de la fin) et le paradigme d’Eco, où l’on suit le parcours de déploiement du sens tout au long de la lecture. Voir, pour cette seconde option, aussi Landowski (2005) et Fontanille (2008).
Par contre, par texte comme paradigme on entend le paradigme épistémologique de l’immanence. Cela veut dire qu’on peut étudier par exemple les pratiques culturelles à travers un paradigme textuel, à savoir comme si le sens était déjà donné, thésaurisé, et non pas comme si le sens était en acte, voire en train d’être pratiqué. Le paradigme des pratiques aurait par contre comme objet d’étude le sens saisi en même temps qu’il se construit14. Avant d’approfondir ces distinctions sémiotiques, je me permettrai de rappeler les questions qui ont marqué les théories « de champ » sur la photographie.
0.1. La photographie comme argument accessoire
- Note de bas de page 15 :
-
Si nous passerons en revue, dans ce qui suit, certaines théories sur l’image photographique qui en ont infléchi l’histoire critique, comme celles de Benjamin et Barthes, cela se justifie non dans un but historico-philologique, mais dans une tentative de montrer comment certaines de ces théories peuvent faire réfléchir la recherche sémiotique actuelle à son « impensé ».
La plupart des ouvrages sur la photographie ne présentent (malheureusement !) pas d’images reproduites, comme pour signifier que les images photographiques peuvent être théorisées, appréciées et comprises « en général ». À ce propos Krauss (1990) a raison lorsqu’elle affirme que toutes les œuvres théoriques sur la photographie devenues célèbres et fondamentales, en particulier celles de Benjamin (1931) et de Barthes (1980)15, ne peuvent être définies comme des ouvrages sur la photographie, mais plutôt comme des ouvrages dans lesquels la photographie est un prétexte pour pouvoir discuter d’autre chose :
Pour Barthes la photographie est l’objet théorique à travers lequel il est possible d’examiner l’évidence brute, dans son rapport avec l’aoriste ou les codes de connotation — avec la mort ou avec la publicité —, elle est au même titre l’objet théorique de Benjamin. C’est la photographie qui lui permet de penser la culture moderniste à partir des conditions produites par la reproduction mécanique (Krauss 1990, p. 13).
Le sémioticien italien Marrone (1994) est du même avis lorsqu’il affirme que dans La chambre claire Barthes va à la recherche d’un « au-delà de l’image », et que l’image photographique lui est utile pour parler d’autre chose, à savoir de lui-même et de la mort :
- Note de bas de page 16 :
-
La perspective phénoménologique porte en effet Barthes à « discuter, au cas par cas, de la photo individuelle face au sujet individuel » (Marrone 1994, p. 201, nous traduisons) : l’extrême « personnalisation » de l’image photographique, son être et « rendre sauvages » devient au cours du traité barthésien le noème de l’image. L’approche de Barthes est en définitive « une approche paradoxale qui à travers l’expérience du particulier fait apparaître l’effective universalité de la Photographie » (Marrone 1994, p. 202, nous traduisons) et qui renonce donc à une analyse systématique des configurations textuelles.
L’objet principal de la recherche de La chambre claire a évolué : ce n’est plus la photographie, comme on pourrait apparemment continuer à penser, mais quelque chose qu’il n’est possible de traiter que par le biais de la photographie : de façon quasi heideggerienne, la mort (Marrone 1994, p. 210, nous traduisons)16.
- Note de bas de page 17 :
-
A ce propos voir Wahl (1990).
Barthes affirme en effet que « quoi qu’elle donne à voir et quelle que soit sa manière, une photo est toujours invisible : ce n’est pas elle qu’on voit » (Barthes 1980, p. 18, nous soulignons). Ce qu’on appelle en sémiotique greimassienne le texte photographique n’a donc aucune pertinence ni pour Barthes ni pour Krauss. Car Krauss, contrairement à nous toutefois, se situe dans le sillage de ces travaux théoriques en finissant, délibérément, par faire de la photographie « un objet théorique, autrement dit une sorte de grille ou de filtre au moyen duquel on peut organiser les données d’un autre champ qui se trouve, par rapport à lui, en position seconde » (1990, p. 12). Les ouvrages de Krauss, qui ont comme objet théorique le photographique, c’est-à-dire les « règles d’indexicalisation » qui ont « remplacé dans l’art contemporain celles de l’icône », nous confirment que dans ce type de littérature savante la photographie sert de prétexte pour bâtir une théorie sur la société moderniste (Benjamin 2000), sur l’art contemporain (Krauss elle-même) ou sur soi-même (Barthes)17. Krauss affirme que, de la sorte, la photographie, mieux « le photographique », devient une « tache aveugle » (p. 13) : « Rien à dire, du moins pas sur la photographie » (Krauss, 1990, p. 13, nous soulignons).
- Note de bas de page 18 :
-
« L’œuvre de Duchamp redistribue les pratiques picturale et sculpturale selon le moule de l’“indice”, proposant une nouvelle interprétation de ce qui constitue l’image esthétique » (Krauss 1990, p. 13).
Si Dubois (1983) échafaude sa théorie sur l’« image normale », prise normalement et regardée normalement, en faisant donc de cette image normale un modèle (type) dont toutes les occurrences (tokens) se rapprochent plus ou moins, Krauss dépasse en ambition le théoricien français, élargissant encore plus le champ dominé par la photographie : « le photographique » s’étend à d’autres média, à l’art contemporain, du surréalisme à Duchamp18 jusqu’aux œuvres des artistes contemporains :
- Note de bas de page 19 :
-
Nous devons rappeler que le travail de Krauss est une réponse critique à la propagation du Modernisme greenbergien qui prêche la spécificité de chaque forme d’art (bidimensionnelle pour la peinture, tridimensionnelle pour la sculpture) : chaque forme d’art est donc ramenée à une essence dont Krauss tente de se défaire grâce à l’étude de la « nature de l’indice » ne se rendant pas compte que de cette façon le travail « par essence » est réaffirmé – quoique de façon transversale à l’égard des différents arts.
Analyser la nature de ce changement impliquait que j’écrive, non pas sur la photographie, mais sur les conditions indicielles auxquelles elle avait soumis le champ anciennement clos du monde de l’art. Non pas sur la photographie mais sur la nature de l’indice, sur la fonction de la trace dans son rapport avec la signification, sur la condition des signes déictiques (Krauss 1990, p. 14, nous soulignons)19.
L’indice peircien devient dès lors un modèle interprétatif du culturel et de l’artistique, comme la reproductibilité photographique était un modèle culturel de la décadence de la modernité pour Benjamin, et le ça-a-été de l’instantané le modèle théorique de la preuve irréfutable du Vrai Affectif pour Barthes. Le risque de ces approches réside évidemment dans le fait qu’elles partent de la photographie et finissent immédiatement par l’outrepasser, en l’utilisant seulement comme moyen de réflexion générique.
0.2. Le faux espéranto des images photographiques
La nature est un produit de l’art et du discours (Goodman)
Entre la photographie et l’œil, il y a plus souvent lutte que syntonie (Volli)
- Note de bas de page 20 :
-
Référence classique et évidente, mais obligée : Bazin (1945, en particulier p. 14-16).
Un des premiers lieux communs que nous devons combattre, lié à la technique de production photographique, est celui qui voit dans la photographie un langage transparent20 et universel, capable d’abattre toutes les frontières culturelles. Or, en tant que sémioticienne, il nous semble au contraire que ce sont précisément les différences culturelles mises en scène et/ou cachées dans les textes photographiques qu’il faudrait étudier…
Pour le Barthes du Message photographique (1961), par exemple, la photographie incarne l’utopie du degré zéro de l’écriture parce qu’elle a la capacité de restituer le réel « comme il est ». Dans ce cas, c’est l’usage documentaire, érigé au rang d’essence unique de la photographie, qui a rendu une convention représentative de la photographie, à une certaine époque, tellement « transparente » et naturelle qu’elle nous a rendus aveugles à ses alternatives. Tout ceci dépend du degré de stéréotypisation de chaque représentation à l’intérieur d’une culture donnée car, comme le dit Goodman, la « relativité [culturelle] est masquée par notre tendance à omettre de spécifier le cadre de référence lorsqu’il s’agit du nôtre » (Goodman 1968, p. 62). Nous devons dès lors inverser les termes de la ressemblance nature-artefact photographique : souvent une photographie nous semble « naturelle » précisément parce qu’elle nous est présentée à travers des stratégies énonciatives auxquelles nous sommes culturellement habitués. La ressemblance et la capacité de faire illusion ne sont pas des critères constants et indépendants des pratiques représentatives et interprétatives, mais en sont plutôt les produits. À ce propos Bourdieu (1965) affirme que, conférant à la photographie un brevet de réalisme, la société ne fait que se rassurer dans la certitude tautologique qu’une image du réel conforme à sa représentation de l’objectivité est vraiment objective.
La critique de l’universalité de l’image envisage par contre l’iconicité comme un phénomène stratégique : « c’est à l’intérieur d’une culture, dans le cadre d’une économie des attitudes vis-à-vis des différents systèmes d’expression et de signification que peut se comprendre l’iconicité » (p. 28). L’iconicité doit se comprendre comme phénomène intraculturel et non universaliste ; chaque praxis énonciative localement acceptée et stabilisée se présente en fait comme une praxis naturelle, normale :
La représentation réaliste ne repose pas sur l’imitation, l’illusion ou l’information, mais sur l’inculcation. Toute image, ou peu s’en faut, peut représenter à peu près n’importe quoi ; c’est-à-dire que, étant donnés une image et un objet, il existe d’ordinaire un système de représentation, un plan de corrélation, relativement auxquels l’image représente l’objet […]. Si la représentation est une question de choix, et la correction une question d’information, le réalisme est affaire d’habitude (Goodman 1968, p. 63).
- Note de bas de page 21 :
-
Voir à ce propos Schaeffer (1987, p. 17 et note 4). Schaeffer distingue ici trois modes différents selon lesquels l’objet imprégnant peut opérer par rapport au dispositif : 1) l’empreinte par illumination directe où l’objet imprégnant est également la source du flux photonique qui produit l’image-empreinte : les photos du soleil et des étoiles en sont un exemple, mais aussi celles produites par les corps radioactifs. Très souvent il est impossible de distinguer celles à illumination directe de celles par reflet ; quoi qu’il en soit, ceci est un type d’images difficile à rencontrer dans la production journalistique par exemple, tandis qu’on la trouve plus facilement dans le domaine artistique ou scientifique ; 2) dans l’empreinte par reflet, l’objet qui s’imprime est différent selon la source lumineuse qui peut être soit naturelle soit artificielle et qui influe sûrement sur la pragmatique réceptive de l’image, étant donné qu’une lumière naturelle est lue comme véridictoire parce qu’incontrôlable par le scénario productif, tandis que la lumière artificielle, d’atelier (même si réalisée en plein air) est lue comme image qui construit le monde et non qui simplement le « reçoit » ; 3) l’empreinte « par traversée » est caractérisée par le fait que le flux de lumière passe à travers l’objet imprégnant avant d’atteindre la surface sensible : cela arrive en radiographie, mais aussi dans les photogrammes réalisés à l’aide d’objets translucides (Schaeffer nous offre l’exemple des photogrammes de feuilles d’arbre de Fox Talbot). Ici l’information transmise ne porte pas sur l’enveloppe de l’objet, mais sur la densité de la matière traversée.
Si on quitte brièvement les considérations épistémologiques et on s’approche des questions plus typiquement techniques, on retrouve les mêmes précautions face à des propositions qui envisagent la photographie comme langage neutre et a-culturel dans des pages de Schaeffer (1987) sur le dispositif photographique qui sont précieuses à cet égard. Elles font tout d’abord la distinction entre empreinte par contact et empreinte à distance précisant que pour cette dernière la lumière, le flux de photons, modulé par le dispositif photographique, fait office d’intermédiaire non innocent entre empreinte et imprégnant. Plutôt que d’être une représentation « correspondante », la photographie engage une relation de tension spatiale et de projection entre imprégnant et empreinte photographique ; il n’est donc pas possible d’affirmer que l’empreinte corresponde point par point à l’imprégnant, étant donné que la coïncidence totale est une limite idéale qu’on peut atteindre seulement dans l’image mathématique biunivoque21. Sur ces agents médiateurs entre « pré-photographie » et image-résultat Shaïri et Fontanille (2001) affirment :
Et parmi tous les discours visuels, la photo, de par l’apparente coïncidence « instantanée » […] qu’elle implique entre l’observé et son supposé référent, procure l’effet de vérité apparemment le plus immédiat : directement soumise au regard qui la sélectionne techniquement, elle tend à faire oublier la modalité sémiotique (le support, les contraintes de la surface d’inscription, le point de vue, le grain, etc.) dont elle dépend (p. 87).
L’affirmation selon laquelle la photographie « enregistre sans rien inventer » sous-entend par contre que le sens de l’image s’épuise dans le « rendu » des objets du monde, séparés, reconnaissables et nommables. Mais de cette façon, tout ce qui se trouve entre ces objets — cet espace interstitiel difficile à nommer qui renvoie tout d’abord aux choix énonciatifs des agents producteurs et ensuite, au niveau de l’image attestée, à la configuration plastique de la photo —, n’est pas considéré comme pertinent pour la sémantisation. Si on suit par contre la conception de Goodman affirmant que : « la théorie de la représentation-copie est donc condamnée à l’origine par son incapacité à spécifier ce qui est à copier » (1968, p. 37, nous soulignons), un pré-photographique serait même inconcevable : pas d’objet nommable et reconnaissable avant d’être encadré, imprimé et donc produit. Avec Prieto, on pourrait enfin affirmer que :
- Note de bas de page 22 :
-
Prieto définit le cadrage photographique comme une opération de montage qui renvoie à des stratégies de suppression et de raccord de morceaux du « paysage photographié ». Il s’agirait d’une certaine manière d’opérations rhétoriques. Voir à ce dernier propos Bordron (2010) et Dondero (2010c).
la photographie peut, avec le cadrage, créer le référent dans ce sens que c’est grâce à un tel cadrage que le référent est reconnu dans ses limites spatiales et apparaît ainsi comme un objet. Dans le territoire, par exemple, qui pour le promeneur défile sans solution de continuité dans la vitre de l’autocar, le photographe « coupe » un segment qui devient ainsi l’objet-référent constitué par ce beau paysage. C’est cette « création » du référent qui représente peut-être l’essence de la composition photographique (Prieto 1991, p. 152, note 23, nous traduisons)22.
0.3. L’inclassable promiscuité de la photographie
Les problèmes théoriques que l’on rencontre face au traitement du domaine de la photographie concernent surtout la diffraction de ses usages sociaux. Qui se trouve confronté à la tâche de retracer une histoire de la photographie se heurte à un double écueil qui empêche l’établissement d’une histoire homogène et cohérente : d’une part le « rapport de la photographie avec le réel » et, d’autre part, le rapport de l’image photographique avec un regard technologique non entièrement maîtrisable par le photographe. Durand (1995), par exemple, analyse le rôle qu’a eu le « rapport avec le réel » dans la formulation des théories photographiques de Baudelaire jusqu’à nos jours. Opposant la photographie au dessin et au travail de la main traçante et créatrice, Durand note que « la photographie renvoie toujours à quelque chose d’autre, à une autre scène » (Durand 1995, p. 36) et le fait qu’elle soit considérée comme un art mnémotechnique en fait précisément « un dispositif instable, un dispositif de captation et de projection d’images, dont les termes mêmes sont en variation constante » (ibidem). Pour Durand tout ceci démontre que le fait d’être reconnue comme pratique dont l’hétérogénéité dérive des possibilités infinies de capter différents états de choses, c’est-à-dire de son sujet, a rendu impossible une histoire « cohérente » de la photographie parce que chaque image est justement liée à différentes traces du réel et que les thématiques s’avèrent ainsi les plus disparates. En général, « la précarité » qui a été reconnue à la photographie renvoie à la multiplicité des objets du monde que celle-ci peut capter.
La même chose arrive si l’on pense, comme Dubois (1983), à la photographie comme à un « petit bloc de présent […] qui autorise toutes les lectures et relectures possibles » : on est obligée par conséquent d’exclure toute possibilité d’analyse tant historique que sémiotique, puisque l’image semble se réduire à un segment spatio-temporel, à un simple objet-trouvé qui n’acquiert aucune dignité d’artefact culturel et qui peut être lue selon les sentiments d’une fois à l’autre changeants des observateurs.
- Note de bas de page 23 :
-
« J’étais saisi à l’égard de la Photographie d’un désir “ontologique” : je voulais à tout prix savoir ce qu’elle était “en soi”, par quel trait essentiel elle se distinguait de la communauté des images » (Barthes 1980, pp. 13-14).
- Note de bas de page 24 :
-
Maintes théories sur la photographie, que l’on trouve chez des théoriciens (Baudelaire), romanciers (Bernhard, Bufalino, Calvino, Tournier), poètes (Cendrars), etc. décrivent la photographie comme un art misanthrope auquel on doit la déformation de la nature et de l’homme. Selon ces savants la photographie accorderait son intérêt non à la magnificence de la totalité, comme les autres arts, mais à la fragmentation de l’objet isolé. La photographie est donc considérée comme malsaine pour l’homme parce qu’elle fragmente la totalité dans laquelle il est immergé (la totalité intérieure et celle du monde et de la nature). On peut rapprocher la sensation de dégoût éprouvée par le protagoniste de Bernhard dans le roman Extinction à l’obsession d’Antonino Paraggi, célèbre photographe sorti de la plume de Calvino, qui en arrive à la folie par l’impossibilité de prendre en photo tous les aspects de sa vie, de les classifier et d’en faire une totalité analogue à son expérience sensible. À l’inverse de la circulation contrôlée des images picturales artistiques, « créations autonomes et originales », dans la vision de Bernhard, la composition spatiale des photographies, qui privilégie la coupe nette des objets, la ferait fonctionner comme des simulacres désordonnés et incomplets de l’expérience vécue. Cette théorie n’est pas à notre avis acceptable parce qu’elle délègue au manque d’ordre hiérarchique au sein de la composition spatiale de l’image le portrait existentiel de l’homme contemporain.
- Note de bas de page 25 :
-
Même la distinction entre Réalisme et Pictorialisme (que Barthes appelle esthétique) est réfutée par Barthes parce qu’ « extérieure à l’objet » (p. 14), applicable facilement à d’autres formes de représentation et donc ne résout pas le mystère du désordre de la photographie.
Le désir « ontologique » dont même Barthes est explicitement affecté dérive, comme il l’affirme lui-même, de la difficulté à analyser la photographie à cause du fait qu’elle dépende apparemment de l’objet photographié : « je n’étais pas sûr que la Photographie existât, qu’elle disposât d’un “génie” propre » (Barthes 1980, p. 14). Même pour Barthes, la photographie semble ne pas avoir de génie propre23, ou de champ propre parce qu’elle est envahissante en deux sens : d’abord, elle envahit nos regards dans tous les espaces de la ville contemporaine, en second lieu, elle semble pouvoir arriver à immortaliser rapidement tout ce qu’elle veut, toute l’existence : « Cette fatalité (pas de photo sans quelque chose ou quelqu’un) entraîne la Photographie dans le désordre immense des objets — de tous les objets du monde » (ibidem, p. 18). La reproductibilité technique et la circulation médiatique ont conduit à une visibilité ostentatoire des différentes facettes du monde : la difficulté à s’orienter dans le chaos du photographiable et du photographié et cette potentialité de rendre visible le « tout » du monde rendent le champ de la photographie de plus en plus précaire et fuyant à l’analyse24. Malgré cela, Barthes se pose le problème du catalogage des images – et tente depuis le début de son ouvrage d’établir certaines distinctions. La distinction entre paysages, objets, portraits, nus, par exemple, a un sens car la problématique du genre et de la textualité est dotée de pertinence, mais chez Barthes cette distinction ne tient encore compte des statuts de l’image : comme il est couramment admis, tant les portraits que les nus ou les paysages peuvent fonctionner très différemment selon les pratiques réceptives au sein desquelles elles sont insérées (artistique, scientifique, publicitaire, etc.). Bref, ces distinctions barthésiennes sur les genres ne nous portent pas beaucoup plus loin de la conception de la photographie comme ready-made, c’est-à-dire comme exhibition de l’objet25. Comment faire alors si la photographie continue à se soustraire à toute tentative d’inventaire ?
- Note de bas de page 26 :
-
Rappelons à ce propos la distinction de Floch (1986) entre photographie référentielle, mythique, substantielle et oblique qui n’a rien à voir avec une distinction par objet photographié, puisque, au contraire, elle concerne les « esthétiques photographiques » où le terme esthétique est à entendre comme un synonyme de style ou de praxis énonciative.
Selon un tout autre axe de lecture, plus typiquement sémiotique, et qui privilégie l’épaisseur énonciative de l’image, la photographie est à même de construire des genres visuels au gré de stratégies énonciatives différentes qui destituent par conséquent la pertinence exclusive de l’objet représenté – on peut par exemple construire des natures mortes à travers des architectures de visages (voir à ce sujet Dondero 2009a et en particulier § 7) et des natures mortes qui fonctionnent comme des portraits (voir à ce sujet Dondero 2009a et en particulier § 5). Quelle solution se profile alors ? Celle de ne pas travailler sur le seul « objet représenté », mais au-dessous et au-dessus de celui-ci : d’une part, à un niveau « local », en privilégiant la lecture plastique de l’image (Floch) et, de l’autre, à un niveau « global », en considérant le texte photographique comme construit par les genres d’appartenance, les pratiques et les statuts (Schaeffer 1987). C’est cette direction, comme nous le verrons, qu’empruntent de manière différente Floch et Schaeffer, lesquels tentent de trouver une logique des différents fonctionnements de l’image en partant de la diffraction d’esthétiques photographiques26 et d’usages, de pratiques et de statuts sociaux plutôt que de la multiplicité du représenté.
0.4. La photographie comme ready-made
L’idée que le sujet de la photographie « résiste » à la classification est une position théorique qui a limité l’entrée des images photographiques dans les musées et, poussée à l’extrême, elle peut arriver à nier totalement la pertinence de la construction énonciative de l’image. Le risque le plus dangereux que l’on court sur cette voie est, comme on l’a déjà signalé, de réduire la photographie à un ready-made.
- Note de bas de page 27 :
-
Chez Barthes cette opacité est expliquée par le recours au référent, comme quelque chose, précisément, de non domesticable par les règles représentatives. Sur l’intraitable de la photographie et du sujet, cf. Damisch (1982).
Dès les premières pages de La chambre claire, Barthes affirme que la « volonté » de la photographie est de donner à voir l’objet photographié : la photographie est « tout entière lestée de la contingence dont elle est l’enveloppe transparente et légère » (Barthes 1980, p. 16). On comprend aisément que cette affirmation barthésienne ait permis certaines filiations théoriques comme notamment celle de la photographie en tant que ready-made. Barthes affirme clairement que la photographie est invisible parce que ce n’est pas elle qu’on voit, mais ce qu’elle montre : la photographie est dans ce sens conçue comme privée d’une quelconque épaisseur énonciative et la relation intersubjective entre regardant et regardé apparait donc comme non analysable. Eloigné tant d’une lecture à ambition historico-culturelle que d’une lecture sémiotique de la textualité visuelle, Barthes propose de considérer la matière photographique comme « intraitable opacité hallucinatoire du référent » qui résiste à la représentation27. Non que Barthes ne sache pas que même dans la photo il existe « des codes sémantiques et rhétoriques, des choix stylistiques, des artifices techniques », mais ils ne sont pour lui qu’« un surplus qui ne rend pas compte de la véritable spécificité photographique » (Marrone 1994, p. 201, nous traduisons). Comme l’affirme encore Marrone :
Si la plupart des arts doivent généralement recourir à des codes très élaborés pour garantir l’effet de réel des œuvres, c’est-à-dire si entre l’objet représenté et son signe s’insère toujours la médiation du stéréotype, il arrive autre chose dans le cas de la photographie (ibidem, nous traduisons).
La photographie s’articule pour Barthes sur une pure monstration ostensive. En ce sens « la photo est un signe qui fonctionne comme une portion de réel qui, échappant à la sémiose, se propose à l’expérience de la même façon selon laquelle tout le réel s’offre à l’intervention de notre réseau sensoriel » (Marra 1990, p. 17, nous traduisons). Dans une telle perspective toute la production photographique fonctionnerait comme un ready-made : « l’illusionnisme pictural est un résultat linguistique tandis que le réalisme photographique est, pour ainsi dire, “déjà fait”, un ready-made précisément, dans lequel l’opérateur n’a pas de mérite particulier » (Marra 2002, p. 121, nous traduisons). Cette théorie implique que l’image photographique tout court fonctionne comme un espace non fictionnel. S’il en était ainsi, il n’existerait plus de distinction entre la dimension textuelle de l’image et la dimension expérientielle du regard. En outre, réduire la photographie à une identité absolue avec son référent et gommer l’épaisseur énonciative équivaudrait à affirmer qu’il serait possible de prendre deux photos identiques ; d’ailleurs c’est seulement dans la poétique de l’objet trouvé et du ready-made que les objets exhibés sont identiques à de nombreux autres objets. Le ready-made, contrairement à la photographie, n’a aucune aura autographique, de sorte qu’un porte-bouteilles physiquement égal à celui de Duchamp sera indiscernable de l’œuvre d’art. En fait, il n’y a que le statut artistique qui rende autographique le porte-bouteilles de Duchamp et donc « unique » et séparé de tous les autres — qui, pourtant, sont physiquement non distinguables. Mais, certes, même dans le cas du ready-made, nous ne pouvons oublier que l’ostension est déjà une production à l’aide de signes qui re-énonce et resémantise l’objet (ne fût-ce qu’en termes de valorisation) ; par conséquent le ready-made non plus ne peut échapper au filtre de la re-sémantisation et de la re-énonciation sémiotiques.
- Note de bas de page 28 :
-
Sur la désontologisation de l’image photographique « référentielle », réduite donc à une poétique parmi tant d’autres, cf. Floch (1986).
Si on poussait à l’extrême cette théorie de la photo comme ready-made, on finirait par dire qu’une photographie est artistique parce qu’elle met en scène une œuvre d’art. Tout ceci équivaudrait à confondre la théorie photographique tout entière avec la poétique locale du ready-made. La photographie comprise comme ready-made ne peut pas renvoyer à une essence du médium photographique, mais rend seulement compte d’une poétique — ou stratégie énonciative — parmi les nombreuses poétiques de l’image photographique28. La conception du ready-made peut être acceptée uniquement comme seuil du pensable, puisque la pure documentation sans énonciation est inatteignable.
0.5. Propositions
Le champ immense, généralement qualifié de chaotique, de la production et de la réception des images photographiques nous imposera dans cette étude d’examiner la photographie 1) en tant que textualité, 2) en tant qu’objet matériel, 3) en tant que pratique productive et interprétative qui engendre la formation de genres et de statuts dans lesquels sa sémantisation est fortement ancrée. Cette démarche tentera de faire dialoguer les études théoriques sur la photographie (qu’elles soient sociologiques, historico-artistiques, historiques ou anthropologiques) avec les développements actuels de la sémiotique post-greimassienne. Un des objectifs fondamentaux est de nous mesurer avec la problématique de la genèse de l’image rendue pertinente par les théories sémiotiques d’obédience peircienne. Ceci s’avère nécessaire pour rendre compte du fait que la spécificité de la photographie ne doive pas être considérée comme déjà donnée à partir de sa genèse physico-chimique, mais soit plutôt à construire moyennant une réflexion sur les traces du faire instanciateur (situé dans une situation ou dans une pratique récurrente) dont le texte porte mémoire (énonciation énoncée). Tout ceci a pour but d’envisager l’existence d’un territoire sémiotique spécifique de l’image photographique sans pour autant l’ontologiser à partir du médium. D’une prétendue spécificité génétique a priori on tentera de construire une spécificité du champ de la photographie a posteriori à partir de ses stratégies énonciatives d’une part (niveau textuel) et des pratiques interprétatives et réceptives ainsi que des statuts qui en ressortissent de l’autre (niveau des objets et des pratiques). L’objectif est en fait d’en distinguer, par scrupule épistémologique et méthodologique, les différents niveaux stratifiés de pertinence sémiotique : la textualité, sa matérialité objectuelle, le genre discursif d’appartenance, la pratique qui la sous-tend, le statut sous lequel elle circule dans le social et les parcours qu’elle accomplit en passant par plusieurs domaines sociaux.
Si en un certain sens l’approche sémiotique classique du texte et de ses stratégies énonciatives vise à construire des simulacres d’observateurs possibles, en revanche l’approche de la pratique se pose comme objectif de moduler le point de vue textualiste en montrant que les différentes pratiques réceptives – mais dans un certain nombre de cas également productives – déterminent différentes constitutions possibles du texte photographique lui-même et différents parcours interprétatifs. En effet, chaque image dérive son sens non seulement de la morphologie textuelle, mais du fait qu’elle est avant tout un objet culturel qui se construit au sein d’une négociation sociale qui dépend de la grammaire spécifique d’un domaine (art, science, religion, etc.). Pour cette raison le niveau global d’analyse (pratiques, genres et statuts sous lesquels un texte est assumé) apparaît comme le point de départ pour comprendre et identifier le niveau local de la textualité (texte seul, série, corpus, etc.), pour autant que cette dernière puisse ensuite, à son tour, resémantiser la situation perceptive et interprétative globale.
- Note de bas de page 29 :
-
La genèse d’un texte relève des pratiques technologiques qui le constitue, ses pratiques de production ; par contre la génération du sens d’un texte concerne la façon dont on peut analyser le parcours de formation du sens, du niveau plus profond du parcours génératif du contenu de Greimas (1983) jusqu’au niveau énonciatif (niveau de la surface discursive).
Les propositions de Floch dans Formes de l’empreinte (1986) sont à l’origine de plusieurs de nos réflexions, tant en ce qui concerne la distinction entre genèse d’une photo et génération du sens de cette photo29, que pour ce qui est d’une approche ouvrant sur les pratiques réceptives. L’ouvrage de Floch problématise deux niveaux de pertinence sémiotique, la textualité et la pratique, et devient, de fait, un point de départ incontournable surtout pour les prises de position épistémologiques d’orientation constructiviste en opposition aux positions référentialistes (ou, comme les appelle Floch, interprétatives). Dans son ouvrage Floch démontre le rôle crucial de la lecture plastique de l’énoncé visuel, laquelle acquiert, dans le cas de la photographie, une valence encore plus marquante, sans doute, que celle qu’elle revêt en peinture, précisément parce qu’elle permet de ne pas résorber la signification photographique en une théorie déproblématisée de la genèse indicielle qui est porteuse d’une lecture exclusivement référentialiste et orientée uniquement à l’identification d’un objet en tant que « traceur ». La sémiotique plastique permet à Floch de démontrer que l’image produit un effet de sens qui est lié plus aux formes de l’empreinte qu’au processus génétique qui les a inscrites.
- Note de bas de page 30 :
-
Cf. à ce propos l’analyse de Floch (1986) du Nu n°53 de Brandt où il met en relation l’« esthétique de la découpe » de Brandt avec celle de peintres comme Matisse et Cranach nivelant ainsi leurs différents supports et gestes d’inscription.
- Note de bas de page 31 :
-
Voir à ce sujet Dondero (2010a).
- Note de bas de page 32 :
-
La suture entre les deux espaces, textuel et expérientiel, médiatisée par l’assise énonciative du regard machinique, implique le passage de la préhension de l’espace instancié du texte à un parcours expérientiel qui accouple sujet et texte même. Ce parcours expérientiel est sous le signe de la co-présence du sujet devant un espace textuel : d’où, selon Fontanille, la mise en œuvre d’une appréhension cœnesthésique qui met littéralement en commun et regroupe simultanément plusieurs activations sensorielles (non seulement visuelles, mais relevant d’autres champs sensoriels) et une préhension kinesthésique relevant de la coordination de faisceaux polysensoriels entre la sensori-motricité du sujet et la manifestation temporalisée du plan de l’expression du texte.
Toutefois on sera obligée de remarquer que, quoique partant de l’analyse des formes du sensible et du langage plastique, Floch adhère à une théorie du discours qui prône la valorisation des formes du plan de l’expression, mais reste indifférente à la substance du plan de l’expression par rapport à la formation du sens du texte30. Même en récupérant une dimension fondamentale de la signification photographique (le plastique), la théorisation de Floch dans Formes de l’empreinte finit par avoir comme issue frustrante l’annulation de toute spécificité médiatique, à tel point que les observations analytiques menées sur les photos auraient pu être valables aussi pour d’autres substances visuelles, voire par exemple pour des images picturales. La question reste irrésolue chez Floch. Ce que nous proposons de faire dans les pages qui suivent c’est d’interroger ses prises de position, devenues « classiques » dans l’enceinte de la sémiotique structurale-générative, en les considérant en tout cas comme un point de départ tant pour l’étude des images photographiques, que pour la reconsidération théorique en général — ce qui semble du reste aller de soi, vu les récentes filières de recherche sur les pratiques dans le réseau post-greimassien (Basso Fossali dir. 2006, Basso Fossali 2008, Fontanille 2008). Si chez Floch l’instance énonciative, productive et interprétative était désincarnée et symétrique (dans le sillage de Greimas et Courtés 1979), les propositions de Fontanille (2004) réintroduisent la corporéité, qui doit être placée à la base de la sémiose en tant que moteur et ressort de l’énonciation. La sémiotique de l’empreinte de Fontanille (2004) rend pertinent le corps comme « responsable » de l’image, en amont et en aval de celle-ci. Cette théorie est en mesure de ventiler un faisceau de plusieurs perspectives de pertinences sur les images réintroduisant et reconnectant entre elles des problématiques qui étaient restées, en partie, étrangères à l’approche greimassienne, ou du moins mises en sourdine : voici alors que nous pouvons approcher les images en tant que : (a) corps (objets matériels), (b) phénomènes perceptifs (apparences sensibles), (c) événements (le fait qu’elles surviennent au sein d’un scénario pragmatique), (d) prolongements de notre corps, ou encore « prothèses et interfaces […], qui gardent la mémoire de leur origine et/ou de leur destination corporelles, et qui résultent de la projection des figures du corps sur le monde » (Fontanille 2004, p. 16). Une fois cette voie empruntée, il n’est plus possible de classifier ni d’approcher les images en faisant abstraction de leur médium instanciateur ou du canal récepteur31 ; si l’approche désontologisante de la photographie reste la même, il s’agit surtout de reconstruire les syntaxes figuratives qui traversent les différentes genèses des images. Les études sur la polysensorialité (Fontanille 1998, 1999b, 2004) en fait ne considèrent pas la syntaxe à empreinte comme « geste spécifique » de l’authentification photographique, étant donné qu’au sein de la production photographique d’autres syntaxes entrent constamment en ligne de compte, telle que la syntaxe sensori-motrice d’ailleurs typiquement picturale (pensons au « bougé » de l’instantané). Inversement, d’autres média peuvent fonctionner selon une syntaxe à empreinte : au sein de la production picturale ainsi que dans la gravure, une syntaxe à empreinte doit toujours être envisagée. Il s’agit donc d’interroger la co-implication entre sujet percevant et texte visuel32, ainsi que la mémoire discursive de l’acte instanciateur — ce qui, comme on l’a remarqué, ne se réduit pas à l’ontologisation de la genèse ni à la recherche d’une spécificité médiatique –, vu que la corporéité du sujet se construit et se reconstruit toujours en relation avec les stratégies textuelles tour à tour prises en compte. Mais voyons maintenant tout ceci de plus près.
1. De la genèse du texte à la génération du sens
Le parcours que nous voulons entreprendre ne vise pas à peser le pour et le contre des théories de la photographie au sens chronologique, mais plutôt à envisager les différentes approches à partir des problématiques que nous tenons pour « décisives », aussi bien en référence aux “théories de champ” de l’image photographique, que en rapport avec une théorie sémiotique du discours et des pratiques. L’enjeu d’une relecture de l’œuvre fondamentale de Floch (1986) est d’arriver à se demander de manière problématique si une sémiotique de la photographie peut être considérée comme autonome par rapport à la sémiotique de la peinture ou de l’image numérique par exemple. Dans l’affirmative, comment peut-on en arriver là, sans nécessairement reproposer une autonomie du champ photographique basée simplement sur une ontologisation du médium productif — comme il est d’ailleurs presque toujours advenu dans les histoires de la photographie et dans le domaine de la sémiotique de la photographie d’orientation peircienne.
1.1. Empreinte et formes de l’empreinte
- Note de bas de page 33 :
-
Sur la différence entre les théories de Floch et celles de Dubois d’un point de vue peircien, voir Louvier et Paquin (1990).
- Note de bas de page 34 :
-
À ce propos voir l’important article de Klinkenberg « Matière et lumière, peinture et photo. Le Groupe Quanta » contenu dans Klinkenberg (2010) où l’auteur explique les dangers non seulement de la théorie iconique de la photographie mais aussi la thèse de l’indice qui, tout en permettant de mettre l’accent sur la pratique de la prise, « peut occulter le fait que dans tout travail photographique, il y a bien production d’une image » (p. 36, nous soulignons).
Le fait que le texte théorique de Floch se construise comme une contre-argumentation par rapport aux théories du début des années quatre-vingts sur la Photographie (en particulier L’acte photographique de Dubois de 1983, mais aussi La chambre claire de Barthes de 1980) rend fondamental l’examen des oppositions entre la théorie sémiotique du discours de Floch, d’une part et celle du signe de Peirce33 et de Barthes, d’autre part. Floch nie toute validité théorique au « spécifique photographique » et aux théories taxinomiques et ontologisantes. Pour les théoriciens peirciens la photo se réduit en effet à tout ce qui n’est pas énoncé, c’est à dire à sa situation de réalisation, et de là au contexte psychologique et technique de la production, et au scénario référentiel dont il est trace34.
Ceci nous mène directement à la distinction fondamentale en sémiotique entre génétique et génératif : selon une perspective génétique (ou interprétative) tout texte est interprétable à partir de la genèse causale qui en est à la base, tandis que pour la perspective générative il est nécessaire de partir de l’explication des règles d’articulation du sens du texte lui-même. Dans cette dernière perspective, ce n’est pas l’empreinte comme condition de production (Dubois) qui est pertinente mais, précisément, les formes de l’empreinte. Dans un article de 2000 qui reprend l’analyse du Nu n° 53 de Brandt déjà publiée en 1986, Floch affirme très clairement que :
si d’un point de vue technique, l’image photographique peut être considérée comme une empreinte, ce sont les formes de l’empreinte qui rendent possible le fonctionnement de l’image en tant qu’objet de sens (Floch 2000, p. 170, nous traduisons et soulignons).
- Note de bas de page 35 :
-
Chez Barthes (1980), comme chez Dubois (1983), il n’y a pas de trace d’un souci « culturel » vis-à-vis de la photographie : si tous deux s’étaient intéressés aux usages sociaux de la photographie ils ne l’auraient pas théorisée comme « intraitable », mais ils auraient analysé les parcours de sens produits par les configurations textuelles, par les genres, par les statuts sociaux et par les pratiques réceptives.
Si Dubois et encore plus Barthes affirment que le noème de la Photographie est l’Intraitable, le ça-a-été de l’instantané, la sémiotique textualiste se penche en revanche précisément sur l’analysabilité des configurations textuelles. Dans ce cas deux conceptions de l’image photographique s’affrontent : l’une l’étudie comme totalité intraitable, non articulée, a-sémiotique35, l’autre comme une configuration discursive, modulation de valeurs orientée par une narration et une énonciation.
La critique de Floch est adressée surtout à ces classifications passe-partout qui servent à inventorier toutes les images sans en analyser aucune. Ces classifications généralisantes ne sont pas « mises à l’épreuve » sur des textes concrets, elles ne s’affinent pas grâce à une confrontation constante avec la variété des occurrences concrètes et avec des statuts divers. La construction théorique se révèle tout à fait indifférente aux textes attestés en tant qu’elle les surplombe et les contemple à l’avance comme « textes possibles » (et prévisibles !), lesquels de fait, étant « privés de situation [sont] donc dépourvus de sens » (Rastier 2001a, p. 98).
Que la théorisation de Dubois prenne en compte une photo quelconque, une photo moyenne, qui fasse « la moyenne » avec toutes les autres, un passage très éloquent de L’acte photographique en est une preuve irréfutable :
Une photographie « normale » — normalement prise et normalement regardée — c’est-à-dire une photographie « harmonieuse » (par exemple un paysage traditionnel), tire son « harmonie » de l’« adéquation », de l’« homologie », de ce que j’appellerai la congruence entre l’organisation interne de chacun de ces espaces [référentiel, représenté, de représentation, topologique] : l’espace référentiel est celui qui est ordonné de façon orthogonale, comme on le sait puisqu’on en fait partie ; lorsqu’un photographe se met à en découper une partie, il le fait de manière telle – restant droit et portant sur les choses un regard horizontal – que l’espace représenté dans la photo soit en parfait accord structural avec l’espace de représentation qui le capture […] ; enfin cette photo ordinaire et équilibrée, on la regardera normalement (Dubois 1983, pp. 193-194, nous soulignons).
- Note de bas de page 36 :
-
Comme propose également Lauzon (2000), il serait plus heuristique, pour la construction d’une authentique pragmatique de l’image photographique, de partir du sujet qui regarde et non de la production technique : « il est nécessaire de modifier l’ordre proposé par Philippe Dubois et de considérer que l’espace photographique se met en place au moment où quelqu’un se place dans la situation de regarder un signe photographique en vue d’entreprendre une négociation sémiotique » (Lauzon 2000, p. 90).
Dubois et les théoriciens d’obédience peircienne basent leur théorie sur l’empreinte « en général », ce qui ne permet pas d’analyser les textes photographiques, ceux-ci n’étant pas des formes de l’empreinte « en général ». Rien de plus éloigné de l’objet de la sémiotique de tradition structurale-générative que cette « image normale »36. Comment pouvoir penser à une stratégie énonciative unique pour toutes les images photographiques, et annuler ainsi la variété des esthétiques textuelles ?
- Note de bas de page 37 :
-
La notion de « réalité », dans la théorie greimassienne revoie au « monde du sens commun », à un « ensemble de qualités sensibles différemment découpées et articulées selon les cultures » (Floch 1986, note 4).
Si Dubois va à la recherche de l’« énonciation photographique » unique, Floch au contraire identifie quatre praxis énonciatives — qui pourtant ne sont pas spécifiques au discours photographique, mais à tous les discours, parce que la catégorie sémantique qui les articule est celle du rapport entre langage et réalité. Ainsi on peut rendre compte de plusieurs esthétiques photographiques à travers une distinction par fonction37 : l’opposition pertinente en l’occurrence est entre fonction interprétative du langage (le sens préexiste au langage et les discours cherchent à capter le sens des choses du monde) et fonction constructive (les discours construisent le sens des choses du monde). De là dérivent les quatre esthétiques photographiques de Floch qui peuvent décrire plusieurs constructions textuelles (voir schéma n° 1).
Schéma n° 1, Floch 1986, p. 20
Notamment, la photographie référentielle est théorisée sur base d’une conception interprétative des rapports entre langage et réalité : le sens est donné dans le monde et le langage photographique tente de le répliquer. Mais pour Floch cette référentialité ne renvoie pas du tout à une qualité intrinsèque de la photographie : elle est envisageable seulement comme une des esthétiques photographiques possibles, voire celle qui, à travers un effet de transparence énonciative, nie le fait qu’elle est sémiotiquement construite et s’exhibe stratégiquement comme instrument enregistreur visant à « céder la parole à l’histoire et au monde ».
- Note de bas de page 38 :
-
Floch n’est pas particulièrement satisfait de l’explication de cette esthétique ; étant donné qu’elle ne se superpose pas à la photo référentielle, elle doit être justifiée non en tant que retour au « réel », mais en tant que critique des thèses discursives typiques de la photo mythique. Elle ne peut pas viser un degré zéro de l’énonciation, mais une démythification des cadres des valeurs qui s’appliquent normalement à des scénarios figuratifs prototypiques. Aussi a-t-elle une propension métadiscursive (Basso 2008).
Outre la photographie référentielle, préposée à des stratégies informatives, Floch identifie à travers les opérations de contradiction et de contrariété internes au fonctionnement du carré sémiotique , trois autres esthétiques photographiques. La photographie oblique, qui nie la fonction référentielle, exhibant son opacité énonciative, contredit les fondements épistémiques de la référentialisation et se caractérise comme une photographie du paradoxe, qui privilégie le double sens, le déplacement, le jeu de figures rhétorique qui de-compétentialisent l’observateur et agissent contre l’évidence du sens déjà donné. La photographie mythique, en tant que contraire de la photographie référentielle, joue sur une articulation créatrice de sens qui valorise les relations et la médiation mythique entre des scénarios figuratifs différents et qui en fait ressortir « un discours second, en-deçà ou au-delà des éléments reconnaissables » (Floch, 1986, p. 22). La photographie substantielle, enfin, en niant cette dernière fonction, vise le « degré zéro » de l’écriture, tend vers le réel et refuse toute projection énonciative du photographe38.
Floch ne précise pas à quels statuts sociaux ces stratégies énonciatives pourraient appartenir, même si on peut bien sûr imaginer que la photographie mythique et la photographie oblique possèdent les caractéristiques des statuts artistique et publicitaire parce qu’elles mettent à l’épreuve la compétence de l’observateur et lancent des défis à ses habitudes perceptives en essayant d’élargir son territoire du possible. On y reviendra.
Pour Dubois en revanche, pour qui les statuts ne revêtent aucun intérêt, la photo s’explique définitivement par le fait qu’elle est une fois pour toutes « connexion et partage du signe avec son référent » (1983, p. 98). Cette classification a priori – à en croire Floch – ne peut satisfaire ni le sémioticien post-structuraliste, ni le simple amateur parce qu’une ontologie de la photographie ne prend en considération ni les formes signifiantes des images (sémiotique plastique), ni la diversité des esthétiques de la photographie (praxis énonciatives) et des pratiques d’utilisation et d’interprétation qui ont reçu une certaine institutionnalisation (statuts).
- Note de bas de page 39 :
-
Cf. Lauzon (2000), lui aussi convaincu que Dubois s’est occupé seulement d’une pragmatique de la production et non d’une pragmatique de la réception (p. 74). Pour une théorie pragmatique de la réception photographique voir Darras (dir. 2006) et notamment l’article de Darras (2006) qui se rapproche des techniques utilisées dans les instituts de sondage en évitant ainsi que le sémioticien-analyste expose lui-même ses interprétations singulières « en les faisant passer pour des interprétations universelles ». À ce sujet il affirme : « La participation des enquêtés à l’exploration de leurs parcours interprétatifs, leur engagement dans l’explicitation et la compréhension de leurs interprétations, puis la confrontation avec des options interprétatives différentes permettent l’approfondissement collectif et la participation à la dynamique de la sémiose. L’interprétation est ainsi affinée et généralisée, ce qui permet d’accéder à la sémiose publique et à ces différentes options. En effet, cette méthode d’enquête suivie d’une confrontation permet de mettre en évidence les stratégies et méthodes interprétatives personnelles et collectives : même si chaque individu suit un parcours interprétatif qui lui est propre, il existe des familles de parcours interprétatifs qui se développent dans la société et qui sont actualisées par des individus ou des groupes d’individus » (p. 66).
Les études comme celles de Dubois, qui se présentent comme des travaux de pragmatique de la photographie, ne s’intéressent qu’à une pragmatique de la production39 : preuve en est que Dubois, pour expliquer chaque acte photographique, fait appel à l’espace référentiel qui serait transféré dans l’espace représenté de l’image. Dubois affirme même que chaque image photographique nous rappelle que :
notre inscription topologique dans l’univers terrestre est définie par une structuration aussi simple que constitutive : nous sommes des êtres debout, verticaux, placés perpendiculairement en rapport à l’horizontalité du sol. Voici notre orthogonalité fondamentale. Ce type de définition spatiale de notre existence terrestre entre en ligne de compte à chaque fois que nous regardons une image puisque celle-ci met en correspondance l’orthogonalité de l’espace photographique et l’orthogonalité de notre inscription topologique (ibidem, p. 192).
Voici à quoi se réduit l’étude de l’image photographique : à un espace qui nous rappelle, en tous les cas, notre orthogonalité ! Mais il nous semble que cela vaut pour les images de toute sorte et pour beaucoup d’autres objets…
La sémiotique générative, en revanche, vise à expliquer les procès de signification construits et mis en branle par chaque texte photographique tour à tour analysé. Ce qui est focalisé par la pratique sémiotique greimassienne n’est pas le procès génétique du texte – ce qui reste en fin de compte exclu de ce texte – mais les configurations et les formes qui régissent la sémantisation du texte même, c’est-à-dire les conditions d’engendrement du sens. L’objectif des analyses sémiotiques est de parvenir à une description des parcours sémantiques activés par les différents textes et de construire par conséquent une validité intersubjective contractualisable des descriptions :
afin qu’on puisse donner une trajectoire minimalement définie aux procès de sémantisation activables par le récepteur […] [pour construire] un cadre descriptif pactisable comme fond intersubjectif tendu vers la commensurabilité de nos diverses interprétations (Basso Fossali 2003a, pp. 24-25, nous traduisons et soulignons).
1.2. L’image photographique entre approche génétique et approche générative
- Note de bas de page 40 :
-
Dubois (1983, p. 67), dans ce sens, affirme : « Avec Peirce on s’aperçoit qu’on ne peut pas définir le signe photographique au-delà de ses circonstances, on ne peut penser la photographie en dehors de son inscription référentielle et de son efficace pragmatique ». Comme on l’a déjà affirmé au tout début, cette conception pragmatique doit être distinguée des conceptions de l’énonciation en tant qu’instance discursive désincarnée (énonciation énoncée), toujours présupposée mais analysable seulement à partir de ses produits (et plus précisément des simulacres actantiels, spatiaux et temporels présents dans l’énoncé).
De manière générale, dans la littérature sur la photographie, lorsqu’on rencontre le terme d’énonciation, on entend toujours le moment et les circonstances de la prise d’image au sens référentialiste de la pragmatique et au sens des actes de langage en linguistique40. Epuiser de cette façon la problématique de la photographie empêche de prêter attention précisément aux différentes stratégies énonciatives des textualités photographiques (énonciation énoncée).
- Note de bas de page 41 :
-
Il en découle que la sémiotique greimassienne sous-tend que chaque texte soit une théorie incarnée de lui-même et/ou de son acte instanciateur — ou des actes instanciateurs d’autres média.
- Note de bas de page 42 :
-
Dubois affirme que « le peintre compose, tandis que le photographe découpe » refusant à celui-ci toute possibilité de composer, sélectionner, hiérarchiser la réalité : le découpage est – à en croire Dubois – irrémédiable ! Contre l’exaltation de l’instant et de l’instantanéité, et contre la stabilité du pôle temporel par rapport à l’extrême oscillation du pôle spatial dans les théories photographiques, voir les précieuses réflexions de Baetens (1998).
Dans Formes de l’empreinte Floch, pour déjouer la théorie qui part d’une prise de position a priori (avant l’observation des manifestations textuelles : c’est la perspective génétique — et générique) et celle qui émerge du texte-résultat (c’est la perspective générative — et caractérisante), analyse cinq photos parmi lesquelles Les arènes de Valence de Cartier-Bresson. Il l’analyse comme une sorte de contre-théorie visuelle41 de l’instantané. Floch renverse la conception génétique de l’instantané – qui n’explique rien de notre appréhension de la photo – à travers l’analyse de l’espace bipartite de l’image au niveau génératif (1986, p. 41). Dubois aurait parlé ici d’instantané, expliquant que le photographe a « arrêté le temps »42 à l’aide d’un geste d’ouverture et fermeture de l’obturateur. Ce qui, tout en étant correct au niveau génétique pour toute sorte de photo, n’explique pourtant pas qu’une photo précise puisse signifier discursivement tant une aspectualisation ponctuelle, comme c’est le cas ici, qu’une aspectualisation durative. Floch focalise ici l’attention sur le fait que l’image est bipartite (ibidem, p. 43) selon un procédé « japonisant » qui rompt avec l’usage de la mise en page unique et de la perspective occidentale : la photo de Cartier-Bresson (prise comme exemple de l’esthétique oblique de la photo), basée sur la déconstruction de la mise en page traditionnelle de la perspective albertienne, met en échec les habitudes de la lecture occidentale de la photo et décompétentialise l’énonciataire. Floch démontre qu’il n’est pas possible de parler d’instantané ou de « flagrant délit » au niveau de l’acte de la prise photographique (le déclenchement a duré un instant – observation purement tautologique), mais qu’il convient plutôt de parler d’« effet de flagrant délit » (ibidem, nous soulignons) ou de « flagrant délit composé » (ibidem, nous soulignons) au niveau génératif. Tout ceci car le flagrant délit est construit à l’intérieur du texte à travers des équilibres spatiaux complexes dus à la construction bipartite de l’image, voire à la construction d’une mise en relation de visions qui ne devraient pas se donner simultanément mais qui se retrouvent pourtant données comme simultanées grâce à la bipartition de la surface de l’image. Floch explique cette simultanéité comme une « construction plastique d’un récit virtuel de flagrant délit » (ibidem, p. 80) due au fait que le résultat de la vision et l’acte inspecteur de regarder sont présents l’un à côté de l’autre sur la surface de l’image ce qui permet de comprendre qu’une certaine action a été vue, découverte, de manière tout à fait inattendue… L’analyse textuelle de Floch invalide ainsi la théorie de l’instantané au niveau génétique en montrant ce que cela veut dire de construire l’effet d’instantanéité dans une image artistique précise.
Dans la confrontation entre formes sémiotiques du classique et du baroque selon Wölfflin, Floch démontre que les photographies L’entrepont et La barrière respectivement de Stieglitz et de Strand, tout en étant toutes deux au niveau génétique des « photographies directes » (Straight Photography), c’est-à-dire privées de retouches et artifices de laboratoire, peuvent produire deux effets « optiques » différents au niveau du texte-résultat, à savoir les optiques wölffliniennes du classique et du baroque : « un même parti pris technique n’empêche pas que deux photographes réalisent des œuvres selon deux “visions”, deux formes sémiotiques radicalement différentes » (Floch 1986, p. 109). Floch met en évidence le fait que deux photographes partagent des thèmes et des motifs, voire une certaine technique, mais que leurs esthétiques s’avèrent opposées : ceci prouve qu’une technique, des thèmes et des motifs semblables ne sont pas suffisants pour produire une « optique » coïncidente. À ce propos nous devons remarquer que le seul théoricien de la photographie qui, outre Floch, ne rabatte pas le résultat – en tant que configuration d’une optique sémiotique – sur le procédé technique est, comme déjà indiqué, Schaeffer (1987) :
Lorsqu’on analyse les différentes pratiques photogrammatiques, on constate très vite qu’elles se répartissent selon plusieurs versants qui n’ont guère de choses en commun, hors la technique, bien entendu. Fox Talbot, par exemple, s’en sert exclusivement pour faire ressortir des effets de trames et de nervures […]. Ainsi le photogramme de la planche VII [Feuille d’arbre dans Le crayon de la nature] est un précurseur des photographies botaniques de Blossfeldt plutôt que des « rayographies » de Man Ray. […] Ainsi, chez Moholy [Nagy], la parenté formelle des photogrammes avec la peinture de Kandinsky […] saute aux yeux (Schaeffer 1987, p. 60, note 1, nous soulignons).
Ce faisant, Schaeffer s’éloigne de la distinction par « spécifique médiatique » et rejoint une conviction de la sémiotique de Greimas qui postule l’existence d’esthétiques (selon Floch ou « optiques » selon Wölfflin) communes à différentes substances de l’expression, voire à des optiques transversales aux médias, dans ce cas photographique et pictural.
1.3. Formes sémiotiques et substance de l’expression
- Note de bas de page 43 :
-
Les premiers deux traits oppositionnels de la forme classique et de la forme baroque sont linéaire vs pictural (lignes vs. masses) : la vision classique se fonde sur des contours et isole les objets ; pour l’œil baroque par contre les objets sont reliés entre eux. L’un produit une structure stable et l’autre une apparition mobile, la prise sectionnée du monde, l’autre la compénétration des formes, l’un les valeurs visuelles et l’autres les tactiles. La seconde distinction concerne la catégorie spatiale des plans vs. la profondeur. La ligne-contour dépend en effet du plan, tandis que la profondeur construit un mouvement du regard en avant et en arrière pour éviter les figures juxtaposées et le parallélisme de plans. Si le classique préfère les plans distincts et frontaux, le baroque vise à « absorber profondeur et espace en un seul souffle » à travers la diagonale et la brusque réduction des grandeurs. La troisième distinction prend en considération la fonction du cadre : dans la forme classique les bords sont pensés comme des raccords et dans la forme baroque en tant que découpe fragmentaire du monde. La distinction entre unité multiple et unité indivisible concerne la distinction entre le « tout articulé » au sein duquel chaque partie reste distincte mais s’accorde à l’ensemble (classique) et l’unité absolue au sein de laquelle chaque partie a perdu son droit de vie particulier (baroque). La dernière opposition clarté absolue vs. clarté relative concerne, d’une part, le fait que la forme se révèle entièrement et, de l’autre, la contradiction entre forme et lumière, où la lumière construit des formes qui ne coïncident pas avec celles des objets.
Comme l’on vient de le dire, dans ses analyses Floch (1986) emprunte à Wölfflin (1915) la réflexion sur le classique et le baroque. Floch vise à ce propos à intégrer la photographie au sein des divers langages en les rendant réciproquement traductibles par le biais de leurs configurations énonciatives selon la leçon de Wölfflin et de Greimas. Floch emprunte donc les cinq catégories de Wölfflin pour légitimer certaines thèses d’une théorie du discours et montrer que les « optiques sémiotiques » fonctionnent transversalement par rapport aux substances de l’expression considérées séparément (picturale, photographique, etc.). Les deux formes sémiotiques du classique et du baroque sont, en effet, interdéfinies à partir de cinq catégories43 indépendantes des substances dans lesquelles elles se réalisent (précisément, peinture, sculpture, architecture, photographie), données comme relatives et sans valeur ontologique.
Un exemple de transversalité des formes sémiotiques par rapport aux substances médiatiques nous est fourni par le parallélisme que Floch (1986) trace entre le « procédé japonisant » choisi par Cartier Bresson dans Les arènes de Valence – auquel nous nous sommes déjà arrêtée – et le tableau « composition d’objets » de 1937 de Fernand Léger ou certaines œuvres de Toulouse-Lautrec : dans toutes ces images l’absence de séparation nette entre les plans (arrière-plan et plan en profondeur) et la bipartition de la surface de l’image qui remplace la mise en page classique unique (voire celle du point de fuite de la perspective) nient le sens de la profondeur. Ceci signifie pour Floch que « le procédé photographique n’implique aucune forme plastique particulière [qui puisse être comprise comme spécifique à la photographie] » (Floch 1986, p. 117) et qu’il n’existe aucune assise plastique typique de la photo, la photo pouvant assumer les assises plastiques les plus diverses – à l’instar de la peinture, du dessin et de la sculpture. Floch met ainsi en rapport les formes sémiotiques du Nu n° 53 de Brandt avec celles de deux peintres tels Cranach et Matisse – notamment les peintures-collages a tempera de Matisse des années 50, construites sur de forts contrastes chromatiques sans utilisation d’ombres portées. Celles-ci, comme le Nu n° 53 de Brandt, se baseraient sur une esthétique du découpage (ainsi que sur la ligne-contour, sur ses rigidités et ses sinuosités à la manière des décorations égyptiennes) en dépit des volumes, du modelé et de l’équilibre de la composition. La photographie de Brandt (considérée comme un exemple de la photographie mythique par Floch) se présente en effet comme la surexposition d’un visage à la lumière, et l’effet qu’elle provoque sur le spectateur est comme si, dans cette portion d’espace et de lumière, l’émergence de la figurativité n’était pas importante, contrairement à l’émergence de la rencontre entre un gradient de lumière particulier et une surface. Tant chez Matisse que chez Brandt le corps en tant que figurativité disparaît et seule l’empreinte eidétique demeure, abstraction de la corporéité, mettant en scène la valorisation de l’informateur plastique. De cette façon Floch met en parallèle et identifie des formes sémiotiques communes (la syntaxe visuelle du découpage, justement) au delà des diverses substances expressives (peinture d’une part, photographie de l’autre) à la suite de Wölfflin.
Si cette analyse est conduite de façon magistrale, il ne faut pas pour autant oublier, à un niveau plus général de la théorie sémiotique, que les formes classiques et les formes baroques seraient équivalentes en peinture et en photographie uniquement si nous considérions comme sémiotiquement pertinente la seule syntaxe « visuelle » des images – et non au contraire la syntaxe polysensorielle. Il faudrait à notre avis prendre en compte certaines « asymétries » des formes sémiotiques selon les différentes substances expressives qui les incarnent – tout en faisant évidemment foi à la prise de position, à laquelle on ne peut renoncer, qu’il n’existe pas de type d’énonciation spécifique pour chaque type de média. Il existe du reste des pratiques énonciatives cristallisées et des pratiques réceptives différentes dans la production artistique picturale et dans la production artistique photographique : par exemple, on n’obtient pas toujours l’effet-objectivité de la forme classique avec les mêmes moyens et selon les mêmes points de vue en photographie qu’en peinture. Ceci parce que l’image photographique et l’image picturale véhiculent des habitudes perceptives et interprétatives dérivées de différentes pratiques réceptives.
À ce propos, les études de Fontanille (1999b, 2004) sur l’autonomie de la syntaxe figurative corroborent une classification des différents discours non basée de façon apriorique sur la distinction entre média productifs. À l’encontre de la tradition greimassienne, Fontanille propose toutefois une différenciation par syntaxes figuratives qui renvoie à la constitution et à l’inscription des formes selon des tensions différentes entre support d’inscription et rythmes et matières de l’apport. L’accent sur les syntaxes figuratives vise à rendre compte de l’énonciation en acte et des effets de sens des substances expressives des textes – qui débouchent sur une théorie du visible et non du visuel :
Ce qu’on appelle la sémiotique « visuelle » obéit à des logiques sensibles bien différentes selon qu’on a affaire à la peinture, au dessin, à la photographie ou au cinéma : le graphisme et la peinture impliquent d’abord une syntaxe manuelle, gestuelle, sensori-motrice, et, en ce sens, ils se rapprochent de l’écriture. En revanche, la photographie n’implique nullement une telle syntaxe : comme le rappelle Jean-Marie Floch (1987), la syntaxe figurative de la photographie est d’abord celle de l’empreinte de la lumière sur une surface sensible […] De même, le cinéma, ce complexe d’empreintes lumineuses et de mouvement offre un simulacre du déplacement du regard, porté par le déplacement d’un corps virtuel ; il participe d’une autre syntaxe, de type somatique et moteur, et, en ce sens, il se rapproche plutôt de la danse. (Fontanille 2004, pp. 84-85).
- Note de bas de page 44 :
-
Voir à ce sujet Dondero (2008a) et (2009b).
Fontanille affirme que la sensori-motricité est à la base tant de la classe manuelle-visuelle (graphisme, écriture) que de la classe kinésico-visuelle (cinéma, danse). Le cinéma est associé à la danse parce qu’il présuppose un parcours entre plusieurs points de vue. Or, la construction syntaxique des icônes russes peut aussi reposer sur des points de vue simultanés et être donc semblable à celle du cinéma et de la danse. On démontre ainsi qu’il ne faut pas segmenter les discours par substances expressives, mais par syntaxes figuratives44.
Tentons maintenant de jauger la valeur heuristique de ces études fontanilliennes par rapport à notre propre projet de construire une autonomie non ontologique de la photographie.
1.3.1 Sémiotique du discours et spécificité médiatique
- Note de bas de page 45 :
-
Pour Rastier, qui critique résolument la théorie greimassienne du texte, il est important de rappeler que « les théories sémiotiques les plus connues, comme celle de Greimas, considèrent le niveau linguistique comme une variable de surface ; […] il devient de plus en plus difficile de défendre le principe d’une sémiotique discursivement autonome » (2001, p. 52, nous soulignons).
- Note de bas de page 46 :
-
Comme le souligne Valle (2003, p. 22) il existe dans la théorie sémiotique certaines contradictions entre la bipartition formaliste hjelmslevienne du langage et la substantialisation du contenu comme étant sémantique et de l’expression comme étant sensible : dans ces cas « l’expression devient alors une espèce de résidu non sémantisé ».
- Note de bas de page 47 :
-
Selon cette conception, il n’existerait donc pas le langage pictural, le langage photographique, etc., mais seule leur mise en scène, c’est-à-dire des degrés différents de transparence et d’auto-effacement du faire productif textualisé.
- Note de bas de page 48 :
-
L’introduction de l’ouvrage s’intitule en effet photographies au pluriel et avec une minuscule barre Photographie avec une majuscule au singulier.
Comme nous l’avons remarqué ci-dessus, l’ouvrage de Floch concerne non tant et seulement les études sur la photographie mais, presque en contradiction avec cela, il s’agit d’un des ouvrages fondateurs de la sémiotique du discours. En effet, à notre avis, l’intérêt pour les images photographiques est en un certain sens « fortuit » : Formes de l’empreinte, avant d’être un ouvrage sur l’image photographique, est un ouvrage de sémiotique du discours. Essayons de nous expliquer. Pour la théorie greimassienne classique il est possible d’affronter la problématique des images photographiques seulement si on l’englobe dans une théorie générale du discours45. Une rhétorique générale du discours ne classifie pas les différentes textualités selon les média productifs ni selon les canaux sensoriels à travers lesquels l’information textuelle est prélevée : en ce sens on ne pourrait proposer de scinder une sémiotique de la photographie de la sémiotique de la peinture, de la littérature ou du cinéma, puisqu’elle se révélerait le fruit d’un catalogage par substances de l’expression qui trahirait les prises de position de la sémiotique du discours, qui trouve dans le parcours génératif du contenu son fondement. En effet, le contenu d’un texte est défini par Greimas (1966) comme fond commun des différentes sémiotiques : la généralité du contenu trouve ensuite une correspondance dans la particularité de l’expression. Ainsi Floch (1985) affirme-t-il que l’étude de l’expression et l’étude du contenu sont possibles séparément puisque : « il n’existe pas de contenu spécifique en rapport avec un langage particulier » (p. 64), ce qui nous fait conclure que le contenu est déjà donné avant l’expression46. Ceci expliquerait le rapprochement de Floch entre la photo du Nu n° 53 de Brandt et les images picturales des Gouaches de Matisse : il est vrai, comme affirme Floch, que les deux images en question appartiennent à une « forme sémiotique » commune, mais le fait qu’elles soient produites par des gestualités instanciatrices différentes ne peut à notre avis être oublié. Floch, comme Greimas, vise à construire une théorie qui ne distingue pas ontologiquement les différents discours (verbaux et non) selon les substances de l’expression et les canaux sensoriels de réception : c’est la raison pour laquelle il ne répertorie pas les textes visuels en rendant pertinents les média de production, mais plutôt il les étudie en analysant des formes signifiantes et des logiques du sensible (analyse transversale par rapport aux média productifs)47. Malgré cela et presque en contradiction avec cette thèse, Formes de l’empreinte parvient à se profiler comme un ouvrage fondamental sur les photographies48 parce que, comme on l’a dit, il se positionne comme un contre-ouvrage par rapport à la prolifération des études sur la « Photographie avec la majuscule » du début des années 80, et donc contre la dérive ontologisante des théories sémiotiques sur la photographie, non seulement d’obédience peircienne, mais également barthésienne. La critique de Floch s’adresse en effet à tous ces essais qui répertorient les différentes manifestations photographiques sous un unique type qui renvoie au médium de production, ce qui équivaut à réduire à l’identique les diverses occurrences photographiques (tokens). Floch au contraire propose :
une recherche sur une typologie de discours aussi bien non-verbaux que verbaux qui, de fait, intégreraient l’histoire interne des formes de la photographie, et plus généralement de l’image, à celle de tous les langages, de toutes les sémiotiques. Un tel projet d’intégration est d’ailleurs tout à fait typique d’une sémiotique structurale et confirme une fois de plus l’antinomie entre cette dernière et la sémiologie des signes et de leur spécificité respective (Floch 1986, pp. 106-107, nous soulignons).
- Note de bas de page 49 :
-
Cf. à ce propos Fontanille (2004, p. 265) qui affirme que la sémiotique « classique » segmente l’image à travers une pertinence visuelle et non polysensorielle.
- Note de bas de page 50 :
-
Le choix de l’objet planaire comme unité pertinente est en effet plus prudent que celle du canal sensoriel.
Pour Floch l’unité pertinente de l’analyse sémiotique n’est donc pas le canal sensoriel par lequel nous recevons l’information, en l’occurrence le canal visuel49. Si le canal ne peut pas constituer l’unité théorique d’un champ de recherche50, elle pourrait d’autant moins être identifiée dans le médium photographique. Floch précise en effet :
- Note de bas de page 51 :
-
Je souligne « traversée par » parce que cela fait comprendre que les autres discours (pictural, cinématographique, etc.) peuvent partager avec l’image photographique les mêmes esthétiques et formes sémiotiques.
Selon nous, en effet, le meilleur service à rendre aujourd’hui à la photographie, c’est de l’intégrer au monde des images en général, et insister sur le fait qu’elle est traversée, si l’on peut dire, par de nombreuses esthétiques ou formes sémiotiques qui se prolongent aussi bien dans la peinture, le dessin ou le cinéma51 (ibidem, p. 115, nous soulignons).
- Note de bas de page 52 :
-
Voir à ce sujet Basso Fossali « Photos en forme de “nous” », infra.
- Note de bas de page 53 :
-
Cela revient à dire que pour Floch il n’est pas pertinent de savoir si la photo a été retouchée ou si elle est une image préfabriquée en studio qui mime la situation de plein-air. On verra ensuite comment, du côté de la réflexion sur les pratiques (§ 3) l’ouvrage de Beyaert-Geslin (2009) renverse cette approche sur la situation d’instanciation en essayant de lier l’acte instanciateur tel qu’il est retracé dans le texte avec la nécessité de rendre pertinents des documents extérieurs à ce texte-même qui puissent élucider l’acte d’instanciation en lui-même.
En outre, si pour la sémiotique greimassienne la phénoménologie instanciatrice de la textualité n’est pas pertinente à l’analyse, la genèse redevient signifiante lorsqu’elle est explicitement thématisée au sein de la textualité52. Si l’image problématise sa propre instanciation, c’est par le biais de l’analyse de la textualité que nous pouvons mettre en relation significative l’acte instanciateur de l’image avec les effets de sens produits par elle – qui sont spécifiques à chaque texte. Il s’agit donc pour Floch de se référer non pas à l’acte productif dans sa phénoménologie, qui comporterait également une prise en charge de la technique et des matériaux utilisés dans l’acte génétique, mais à l’acte instanciateur tel que le texte en porte témoignage53. Ce choix permet à Floch de ne pas ontologiser la genèse photographique par rapport à la genèse picturale, cinématographique, etc., même si cela peut comporter le risque de ne pas parvenir à expliquer les effets de sens des diverses textures et grains de l’image et des différentes pratiques perceptives et interprétatives qui sont en relation étroite avec l’acte d’instanciation, voire avec la constitution du plan de l’expression des textes. En effet, le parcours génératif du contenu a été pensé comme reconstructif des contraintes sémantiques de tout type de texte à tel point que :
la matière de l’expression des textes s’est avérée rester une donnée indifférente par rapport au modèle et en tout cas la méthodologie d’analyse qui en découle se veut valide pour toute forme de textualité et pour tout domaine d’afférence (Basso 2003a, p. 82, nous traduisons).
Si nous sommes bien décidée à nous tenir en dehors de la vieille diatribe sur le spécifique filmique, télévisuel, pictural et photographique, comme le fait la sémiotique du discours, par contre il ne nous paraît pas opportun pour autant de rabattre sur le niveau sémantique tout type d’instanciation. Comme l’affirme encore Basso Fossali :
c’est l’analyse des textes picturaux sous un angle greimassien qui a mené, par exemple, à reconnaître la capacité autonome propre aux traits de l’expression (niveau plastique) à supporter les contenus. […] Dans cette optique, l’importance cruciale du niveau plastique et de ses modalités spécifiques de signification, dont la modalité semi-symbolique, ont été remises au compte du modèle général de la théorie, et rendues pertinentes pour tout type de texte (2003a, nous traduisons, p. 82).
Quelle autonomie alors pour une sémiotique de la photographie (ou de la peinture, ou du dessin), si parler de « sémiotique de la photographie » est en contraste avec la forclusion du parcours génératif de la manifestation expressive spécifique ?
Si le parcours génératif se veut une reconstruction rationnelle des conditions de possibilité de la signification textuelle qui met de côté une phénoménologie de l’instanciation et de la réception des textes, comment pouvoir réintégrer dans ce système le fait que l’élaboration du sens ne puisse s’organiser en faisant abstraction d’un passage par le plan expressif des textes ? À en croire Fontanille (1995) il peut même y avoir narrativité quand on n’a que des transformations sur le plan de l’expression des textes, étant donné que c’est la perception du sujet de l’énonciation qui leur confère du sens et articule celui-ci.
1.3.2. Acte productif et mémoire discursive
- Note de bas de page 54 :
-
Pour Fiers, Floch introduit, déjà dans son travail inachevé sur la Trinité de Rublev, une approche sensorielle des langages visuels, en effet « son analyse permet de prendre en considération l’effet de présence corporelle dans la sémiose même » (Fiers 2003). Voir Floch & Collin (2009). Sur les fonctions liées à la corporéité qui constituent la textualité, cf. Marsciani (2001).
Floch, tant dans le cas de l’analyse de Les arènes de Valence de Cartier-Bresson, que du Nu n° 53 de Brandt, explique qu’on peut établir des vecteurs et des parcours perceptifs à partir des valeurs énergétiques des couleurs. Dans ce cas la lecture plastique de l’image ne rend pas pertinent un ensemble de formants « préétablis », mais un procès en devenir qui se rapporte à la corporéité et à l’ensemble de son activité motrice et sensorielle54. Si le plan de l’expression doit assumer l’importance qui lui revient au sein d’une pratique d’analyse des images, nous ne pourrons toutefois dans ce cas plus parler de formes sémiotiques indifférentes à la substance expressive – comme le fait Floch lorsqu’il ne problématise pas le fait que la photographie puisse être interprétée ou non par les mêmes instruments utilisés pour analyser la peinture. Pour Fontanille par exemple, si on veut construire une sémiotique de la photographie ancrée dans l’événement sensible, il est nécessaire : « d’identifier et de fixer d’abord le plan de l’expression, c’est-à-dire la manière dont les figures de l’expression prennent forme à partir d’un substrat matériel des inscriptions, et du geste qui les y a inscrites » (Fontanille 2004, p. 264).
- Note de bas de page 55 :
-
Cf. Floch (1985b).
La sémiotique de Floch aussi procède à la segmentation des textes et des images précisément pour isoler les figures du plan de l’expression55. Toutefois Floch le fait en mettant entre parenthèses le caractère corporel tant du substrat matériel d’inscription, que du geste d’énonciation :
l’image était segmentée au nom d’un principe de pertinence visuel, alors que le principe de l’empreinte obligerait à différencier par exemple les empreintes photographiques – dont le vecteur est un corps lumineux – et les empreintes picturales – dont le vecteur est un corps en mouvement (Fontanille 2004, p. 265).
Etudier les différents types de supports et les techniques de l’apport nous permet de rendre significative la substance de l’expression, et non seulement la forme de l’expression. Cette approche peut s’avérer heuristique si on sauvegarde la désontologisation de la genèse et si en même temps on parvient à rendre compte des traces du faire en tant que mémoire syntaxique de l’énoncé. Il s’agirait de maintenir l’immanentisme du texte greimassien et en même temps de chercher à rendre compte de comment sont inscrites au sein du texte les traces du geste productif, pour en étudier les rythmes instanciateurs et la temporalité de préhension du plan de l’expression. En ce qui concerne le cas de la peinture, par exemple, Fontanille affirme que :
Les formants plastiques du tableau, en effet, sont des figures dynamiques, constitutives de son plan de l’expression, qui résultent de la conversion des gestes du peintre. Au moment de la saisie sémiotique de quelque objet que ce soit, les procédés techniques qui l’ont fait tel qu’il est ne sont plus directement pris en compte. Et pourtant nous continuons à les percevoir à travers les formants plastiques. Et le caractère dynamique de ces perceptions (la couleur s’étale, recouvre, déborde ; le trait cerne, arrête, entoure, circonscrit, etc.) ne peuvent être pensés que comme des conversions de la gestualité sous-jacente, c’est-à-dire du modus operandi (Fontanille 2003, p. 86).
- Note de bas de page 56 :
-
Rappelons cependant que Fontanille ne parle pas de syntaxe à empreinte uniquement en ce qui concerne la praxis productive de la photographie, mais aussi celle de l’écriture, de la peinture, de la sculpture, etc.
Si la sémiotique de l’empreinte de Fontanille prête attention au modus operandi de la production textuelle, risquerions-nous pour autant de préfigurer le parcours vers une ontologisation de la photographie à travers sa genèse à empreinte ?56 Fontanille, contre l’ontologisation de l’empreinte, affirme que :
L’empreinte ne procure jamais une correspondance exacte et complète, justement parce qu’elle est soumise d’un côté aux propriétés du substrat matériel (il suffit de comparer pour cela une empreinte photographique, une empreinte gravée dans le bois ou le métal et une empreinte étalée sur une toile), et de l’autre au modus operandi (l’expérience et le type d’inscription) (Fontanille 2004, p. 265).
Si nous considérons la photo comme une mémoire signifiée, nous ne devrions pas du tout reparcourir historiquement le procès génétique, mais prendre en considération une mémoire reconstruite à partir de l’énonciation énoncée tout en expliquant comment désimpliquer de telles mémoires de gestes et de rapports entre support et apport, à savoir le modus operandi. Si l’importance de porter l’attention sur les « formes de l’empreinte » reste inchangée, il s’agirait toutefois d’examiner le plan de l’expression des textes photographiques (même dans la comparaison intersémiotique avec les œuvres picturales, les images de synthèse, etc.) et les traces de la relation entre rythmes de filtrage de la lumière et configurations du support, c’est-à-dire encore une fois d’examiner des formes (de l’empreinte) textualisées, mais en tenant en compte que celles-ci ont été produites par des relations particulières et des opérations entre différents traitements de la matière photosensible et de l’énergie lumineuse.
2. De la sémiotique du discours à la sémiotique de l’empreinte
2.1. Ordres sensoriels et modes du sensible
Selon la sémiotique de l’empreinte de Fontanille (2004) il n’est pas possible d’étudier les images photographiques et picturales en les considérant comme appartenant exclusivement au domaine du visuel puisque de cette façon on affirmerait que c’est le canal sensoriel, la vue, qui gouverne la saisie perceptive des textes, tandis que dans notre rencontre avec le monde c’est la synesthésie perceptive qui entre en jeu : celle-ci concerne en fait l’unité profonde de nos sens et l’impossibilité de distinguer et de répartir le sentir global entre divers canaux sensoriels. Pour Fontanille, donc, l’unité du canal sensoriel n’a rien à voir avec l’unité du langage. Il n’existe pas de coïncidence entre ordres sensoriels et propriétés du discours : notre sensorialité entière participe de la mise en œuvre de l’instance discursive. Comme précise Fontanille :
parler du rôle de la sensorialité dans la mise en forme des discours, ce n’est pas invoquer la substance de leur expression ; c’est encore moins faire appel au canal sensoriel par lequel sont prélevées les informations sémiotiques – au sens où on dit que les images relèvent de la sémiotique visuelle (Fontanille 2004, p. 84).
- Note de bas de page 57 :
-
Pour Fontanille (2001) la forme d’un objet en image s’avère donc comme le produit d’un différentiel de résistance entre une matière et son entour, produit par une objectivation (par débrayage) de l’expérience polysensorielle de résistance de l’exploration de cet objet. En identifiant le modelé comme effet d’un différentiel de résistance, le regard éprouve le même schéma sensori-moteur qui lui est procuré par l’expérience de l’objet même, comme du reste a fait, précédemment, le geste d’inscription de ce modelé. Tout ceci pour dire que la traductibilité entre vision et expérience polysensorielle peut advenir à travers l’étude de la sensori-motricité impliquée dans la production et dans l’observation, puisqu’elle permet l’ajustement hypo-iconique entre la sensori-motricité propre à l’expérience corporelle et la technique d’inscription. On postule donc que le dialogue entre activité visuelle et geste d’inscription soit assuré par la stabilité d’une même expérience sensori-motrice, celle de l’exploration de l’objet.
Il est nécessaire de distinguer entre canal sensoriel par lequel on perçoit un texte, par exemple le canal de la vue, et les propriétés du discours, à savoir les « modes sémiotiques du sensible ». Dans le sillage de la phénoménologie de Merleau-Ponty, Fontanille affirme que le tribut de la sensorialité à la syntaxe discursive (ou figurative) est polysensorielle et synesthésique en partant de la thèse selon laquelle le syncrétisme des modes du sensible et les termes complexes sont antérieurs aux formes simples, c’est-à-dire aux ordres sensoriaux spécifiques. Tant face à une peinture que face à une photographie, ou à des œuvres architectoniques ou sculpturales, ou encore au sein d’espaces virtuels, le regard, constitué par le corps-enveloppe et par le corps-mouvement (Fontanille 2004), fait participer toutes les configurations sensorielles, selon différents degrés d’intensité, à la perception et à la signification du « regardé ». Les rares analyses menées en cette direction, surtout dans le cas d’exemples picturaux (Fontanille (1995) et Fiers (2003)), mais aussi de décoration sur vase (Fontanille 1998), visent à rendre l’acte productif pertinent à l’analyse pour expliciter le rapport entre le système sensori-moteur et la gestualité du producteur, d’une part, et la gestualité de réception du spectateur57, de l’autre.
Si, comme l’affirme Fontanille, la sémiotique greimassienne a considéré l’espace visuel comme existant « indépendamment » des opérations qui le constituent, comme si cet espace était immédiatement et naturellement visible et intelligible, il devrait être maintenant possible de considérer les formes comme encore « imprégnées » de l’art du faire et d’une activité corporelle, et de présager le déplacement épistémologique de l’attention exclusive portée à la réception textuelle vers la production, à savoir de la synchronie du texte (son achronie présente) vers une diachronie qui retrouve « le contact avec l’acte créateur » (Fontanille 1998, p. 45). Alors le pari de la sémiotique pourrait être celui de modéliser le sujet affecté par l’expérience des formes sensibles. Par conséquent, on appréhenderait les figures textualisées « comme des corps et non comme des entités logiques et formelles » (Fontanille 2004, p. 263) et les transformations figuratives non tant comme :
des changements entre états figuratifs, comme le passage d’un élément naturel à un autre […], [mais en tant que] opérations [qui] sont des formes du déploiement de l’énergie (intense ou diffuse, directionnelle ou pas, notamment), et [qui] portent sur des structures matérielles dotées en particulier de propriétés de résistance, de compacité, de fluidité et de cohésion (ibidem, pp. 262-263).
Les figures sont ainsi conçues comme des « mémoires » des interactions de force qui les ont produites. Dans ce sens, on peut parler de mémoire discursive : la figure entendue comme corps possède une structure et une enveloppe qui maintiennent les traces de son instanciation. De cette façon, il n’est plus possible de neutraliser les variations sur le plan de l’expression en considérant les articulations du contenu comme indifférentes par rapport à la modélisation des figures de l’expression : dans l’analyse il est nécessaire de partir de la signification du support matériel des inscriptions et des configurations énergétiques de la gestualité qui les y a inscrites. Dans ce sens, la sémiotique du visible formulée par Fontanille vise à rendre compte des mécanismes perceptifs produits par les traces du faire productif – au delà de leur constitution en formants susceptibles d’être lus en tant que support de contenus. Il ne s’agira donc pas seulement de « mesurer » ce qui est placé visuellement devant nous, mais d’évaluer de quelle façon les caractères du visuel émergent du visible, c’est-à-dire d’une perception synesthésique.
2.2. L’hétérogénéité du visuel en peinture et en photographie
- Note de bas de page 58 :
-
Sur la relation entre acteurs humains et non humains, cf. Latour (1991), et pour la photographie Tisseron (1996).
- Note de bas de page 59 :
-
A ce propos, dans l’analyse des deux photographies iraniennes, Shaïri et Fontanille (2001), rendent pertinente la sensori-motricité : « L’échange des regards, entre la photo et son spectateur, devient un dialogue entre deux corps-enveloppes et deux corps-mouvements : le regard, soumis aux conditions cœnesthésiques et kinesthésiques, entraine avec lui dans le flux énonciatif tous les modes du sensible, aussi bien ceux du contact, des surfaces et des volumes, que ceux du mouvement et de la sensori-motricité » (p. 93).
- Note de bas de page 60 :
-
En outre Fontanille établit une comparaison entre, d’une part, la transformation du fonctionnement d’un ordre sensoriel et les perturbations sur l’ensemble des modes sensibles à l’œuvre à l’unisson dans la perception et dans la signification et, d’autre part, la simple commutation d’un trait pertinent élémentaire et ses répercussions en chaîne sur la signification d’un discours entier. Il plaide dès lors en faveur de la dissociation entre champ sémiotique d’un mode sensoriel et stimulation de ce même canal, et avance que la sensation est un système de forces au sein duquel la transformation d’une d’elles en redessine toute la configuration syntaxique.
Une grande part de la littérature sur la photographie prétend que la peinture et la photographie se différencient à travers la genèse productive : dans le cas de la peinture, il s’agit d’un faire manuel, tandis que pour la photographie d’un faire mécanique – en oubliant ainsi que l’appareil photo et le corps du photographe construisent un dispositif actantiel unique au sein duquel les différentes compétences, humaines et machiniques, sont échangées58. La théorie de la syntaxe figurative de Fontanille, en revanche, ne rend pas pertinente la genèse productive en général, qui assigne un « mode » a priori pour la peinture et un autre pour la photographie, mais met en avant l’analyse des traces des rythmes de la production. Fontanille affirme que la syntaxe sensori-motrice est typique de la peinture, mais également de l’écriture, par exemple, tandis que celle à empreinte est typique de la photographie, mais ni l’une ni l’autre ne peuvent se définir comme exclusive et spécifique d’un médium donné. La syntaxe sensori-motrice – typique du faire pictural – peut être, par exemple, prise en charge par la photographie59. De cette façon nous parvenons à expliquer que notre rapport avec les textes visuels, c’est-à-dire notre saisie perceptive d’une image, ne se limite pas au simple fonctionnement de la vision, mais qu’elle implique d’autres modes sensoriels, comme la sensori-motricité ou la tactilité. En effet, la dimension figurative a son autonomie par rapport à la distinction des ordres sensoriels et des différentes substances de l’expression à travers lesquels l’information textuelle est transmise60 : l’image peut se charger de syntaxes hétérogènes, comme celle du toucher, de l’odorat, de l’ouïe. Les parcours d’un champ sensible s’autonomisent par rapport à leur substance sensorielle, se libèrent de celle-ci pour devenir caractères « codifiants » d’un autre sens. Il ne s’agit donc pas d’un passage entre un sens et l’autre, ni de substitution de substances sensorielles, mais il s’agit plutôt de substitution de syntaxe discursive, voire de la syntaxe d’un certain champ sensible (par exemple la syntaxe envahissante à enveloppes successives de l’odeur) qui codifie un autre champ, par exemple celui de la vision : une « image envahissante » fonctionne selon la syntaxe de l’odeur en codifiant la substance visuelle.
- Note de bas de page 61 :
-
« Les principes d’organisation de la syntaxe sensorielle peuvent être dégagés à partir de tel ou tel ordre sensoriel, mais sont de droit indépendants de la substance sensorielle examinée ; ainsi, nous venons d’examiner, à partir du toucher, un principe de contact fondamental, qui définit un champ transitif élémentaire (la “présence pure” et la distinction entre le propre et le non-propre), mais ce principe n’appartient exclusivement à aucune substance sensorielle » (Fontanille 1999b, pp. 31-32).
- Note de bas de page 62 :
-
Ces traces peuvent du reste également viser à mentir, c’est-à-dire à renvoyer à une genèse différente de celle qui a matériellement eu lieu.
- Note de bas de page 63 :
-
Fontanille affirme en effet : « On pourrait tout aussi bien caractériser, suivant le même principe, la nature de l’empreinte dans le masque, le texte verbal, la décoration sur poterie ou sur tissage, les traces laissées par un animal en fuite, etc. » (Fontanille 2004, p. 265).
Comme on l’a déjà dit dans le chapitre précédent, la peinture et la photographie peuvent donc obéir à des logiques du sensible qui appartiennent à des champs sensoriels différents de celui lié à la vue61. La sémiotique visuelle, qui relèverait de la peinture, de l’image numérique, du dessin ou de la photographie, n’est donc pas homogène comme le voudrait une conception biologique de la perception – qui ne distingue guère entre canal sensoriel de réception et syntaxe sensorielle du discours. La théorie de la syntaxe figurative de Fontanille montre que la photographie et la peinture, tout en étant appréhendées toutes deux à travers la vue, peuvent relever de syntaxes figuratives différentes : comme on l’a dit précédemment, le graphisme et la peinture impliquent avant tout une syntaxe manuelle, sensori-motrice, tandis que la syntaxe figurative de la photographie est avant tout celle de l’empreinte de lumière sur une surface sensible. Mais ce qui est intéressant pour nous, c’est que la distinction de Fontanille entre photographie et peinture ne concerne pas tant les matériaux de la seule production, que les traces de la syntaxe productive : il ne s’agit pas de distinguer une fois pour toutes entre deux différents modes de faire sens des images, photographiques et picturales, en en réifiant la genèse. Fontanille vise plutôt à mettre au jour les effets des traces de la genèse62 et donc à schématiser et fournir un modèle selon lequel reconstruire, à partir des formes représentées, les forces et les rythmes de la production. Dès lors, c’est en analysant l’image à partir du plan de l’expression que nous pouvons la saisir comme la trace d’un processus dont nous pouvons déduire les rythmes, les relations entre les apports (coups de pinceau, lumière, etc.) et les supports (toile, papier photosensible, etc.). De cette façon on met en avant le caractère corporel, et non seulement visuel, tant des matières qui reçoivent les inscriptions, que des gestes de production. Tout ceci nous amène jusqu’à affirmer que la genèse de n’importe quel texte autographique renvoie toujours à une empreinte et, d’après Fontanille, il s’agit donc de distinguer les gestes productifs et les surfaces d’inscription de la photographie de ceux qui relèvent de la peinture, de l’écriture ou du cinéma63. La photographie ne doit pas être ontologisée à partir de sa genèse à empreinte, étant donné que tout texte autographique (Goodman, 1968) peut être considéré comme une empreinte, même s’il faut distinguer entre l’empreinte picturale, scripturale, etc. par quatre variables : « 1) la structure matérielle du support, 2) le type d’événement, de geste ou de technique qui assure l’inscription, 3) l’intensité et l’étendue de ces derniers, 4) la densité et la quantité des correspondances » (Fontanille 2004, p. 265).
Moholy Nagy (1967), par exemple, distingue l’image picturale de l’image photographique par le biais d’une opposition généralisante : « De la peinture à base de pigments [on passe] aux jeux de lumière à travers la réflexion ». Or cette distinction ne tient pas compte de la façon dont la couleur se configure en photographie et la lumière en peinture – mais également en littérature, au cinéma, etc. —, comme le démontrent les analyses de Fontanille (1995). Si Zinna (2001), à la suite de Moholy Nagy, distingue la pratique picturale de la pratique photographique suivant l’unité minimale, qui en peinture est la couleur et en photographie la lumière, il nous paraît plutôt que l’intérêt de l’analyse sémiotique résiderait dans le fait d’identifier les syntaxes figuratives à l’œuvre transversalement aux différentes substances expressives des images. Si pour Zinna la distinction pertinente se situe entre pigment de la peinture et lumière de la photo, voire à partir des instruments de production et de la matière employée, Fontanille en revanche rend pertinents les syntaxes, la relation entre apport et support au sein des actes productifs et à ce qui en ressortit en termes de « résistance » entre l’expérience d’un objet par rapport à son environnement d’une part et sa représentation de l’autre : pour lui, l’unité d’énonciation du visible, produit par le débrayage énonciatif, est donc d’abord « la peau », la « surface d’inscription » et ses « empreintes », et non les traces lumineuses et les colorèmes pris isolément.
- Note de bas de page 64 :
-
Sans doute que les configurations lumineuses, au lieu d’être placées a priori comme unités minimales de la genèse de la photographie, peuvent occuper une place privilégiée au niveau du métalangage : la lumière est précisément la thématique préférée de la photographie artistique, et le regard photographique sélectionne certaines configurations de celle-ci, pour rendre par exemple les effets du diaphane et du transparent ; de même que le geste pictural est souvent thématisé au sein des images picturales moyennant la texture.
- Note de bas de page 65 :
-
Cf. à ce propos Fontanille (1995), en particulier l’analyse de l’ombre dans Éloge de l’ombre de Tanizaki.
Le pigment est certainement l’unité minimale de la production picturale, mais pour rendre compte des effets de sens de la textualité picturale il est nécessaire de se demander comment le pigment est traité au cas par cas et mis en relation tant avec le rythme du geste créatif qu’avec la surface sur laquelle ce travail rythmique trouve un lieu d’inscription. À en croire Fontanille, il est impossible de placer d’une part la lumière et de l’autre la couleur sans problématiser précisément leur rapport tensif au sein de chaque texte, qu’il soit photographique ou pictural. Du reste, la lumière n’est pas ontologiquement liée à l’empreinte photographique64, puisque la lumière est plus généralement l’actant source de la vision modulé par toutes les images – mais aussi par les textes littéraires par exemple65. En ce qui concerne les images, la condition a priori de leur apparition est la lumière et son contraire, à savoir l’ombre produite par ses obstacles. La lumière est la condition invisible de la possibilité du visible : la photographie a choisi la lumière comme son objet privilégié. Photographier la lumière « obstruée » veut dire la moduler. C’est comme si l’image photographique travaillait « per via di levare » comme dans la sculpture de Michel-Ange, car elle construit des images par soustraction de lumière. On voit bien ici que la photographie peut travailler selon la syntaxe figurative qui est typique d’une certaine technique sculpturale, ainsi que la peinture peut travailler selon la syntaxe de l’empreinte photographique, comme le fait par exemple l’artiste contemporain Yves Klein.
Un autre exemple significatif me parait celui des icônes russes : si on suit le théologien et philosophe Pavel Florenskij (1995), les icônes russes ont été les premières images à se servir ante-litteram du mécanisme photographique de renversement du négatif en positif pour signifier l’incarnation du divin. L’acte de tirage du négatif en positif, produit par des techniques qui font « émerger » les formes sur la surface photosensible à travers une modulation chimique de la lumière, se rapproche de l’émergence des formes tout au long du processus d’instanciation des icônes russes. Les icônes russes sont conçues non pas comme des tableaux mais comme des empreintes, des images prises par contact d’après la révélation originaire. La répétitivité normative des modèles des icônes vise à garantir une relation d’empreinte et de contact avec une image primordiale de la Sainte Face qui a été inscrite naturellement dans l’esprit et dans les yeux des Pères de l’Eglise. Les icônes russes sont effectivement des peintures, mais la syntaxe figurative qui en résulte, à savoir la manière à travers laquelle les formes se stratifient, se stabilisent et se manifestent n’est pas tout à fait « typiquement » picturale. Dans les icônes, même si les matériaux productifs appartiennent à la tradition de la peinture, la manière dont les formes émergent n’apparaît pas comme le résultat d’une sensori-motricité manuelle qui procède par touches de couleurs. Les formes de l’icône émergent progressivement d’un fond impénétrable comme si leurs contours devenaient de plus en plus visibles et concrets, comme si elles survenaient des ténèbres — comme il arrive lors du développement du négatif photographique. Comme l’affirme magistralement Florenskij lorsqu’il décrit la délicate instanciation de l’icône comme un processus d’impression de la vision sur la toile :
Quand sur l’icône future s’annonce la première tangibilité, à savoir la lumière d’or, les contours blancs de la figuration iconique atteignent un premier degré de tangibilité. Avant, ils n’étaient que des possibilités abstraites de l’être [...]. Il s’agit de remplir l’intérieur des contours de l’espace avec la couleur, pour faire ainsi que l’à-plat abstraitement blanc devienne plus concret ou, mieux encore, que le contour coloré devienne concret. Pourtant, celui-ci n’est pas encore couleur, au vrai sens du terme, seulement il n’est plus ténèbres, il est juste non-ténèbres, il est le premier reflet de lumière dans les ténèbres ; la première manifestation de l’être provenant de l’inexistence. [...] Dans la peinture d’icône il ne serait jamais possible d’utiliser le coup de pinceau, étant donné qu’il n’y a ni des demi-tons ni des ombres : la réalité émerge, par degrés successifs, mais elle ne se compose pas de parties (1995, pp. 156-158 nous traduisons et soulignons).
Florenskij affirme ensuite que quand la base a séché, les contours du visage, à l’intérieur et à l’extérieur, doivent être refaits avec la couleur, pour que le visage passe de l’abstraction au premier degré de visibilité : le visage reçoit de cette manière un premier degré d’animation (ibidem, p. 160). Les formes de l’icône se précisent comme si elles provenaient d’un espace confus : elles apparaissent par degrés successifs, et non par parties juxtaposées. Le peintre d’icône procède du ténébreux au lumineux, de l’obscurité à la lumière. Dans l’icône, les formes émergent comme toujours plus évidentes, toujours plus marquées, comme cela advient lors de l’acte de révélation du développement photographique du négatif en positif : les formes s’éclaircissent, elles se distinguent par la manifestation toujours plus précise de différences, d’approfondissement des contours, de remplissages, etc. Tout moment de la production est pris à l’intérieur d’une syntaxe d’émergence des formes par couche et non par parties (comme c’est le cas par contre dans la peinture occidentale), comme si l’iconographe était face à la manifestation d’une vision qui émergerait de l’intérieur de la toile, quelque chose qui se manifeste graduellement par degrés successifs de netteté. La temporalité de l’instanciation de l’icône veut signifier le surgissement de plus en plus clair et « compréhensible » de la vision d’un au-delà et pour cela elle doit s’appuyer sur la syntaxe figurative du développement photographique qui fait surgir les formes graduellement de la lumière, et non comme éclairées par une source de lumière. La préparation de la toile, les adjonctions de matériaux spécifiques, la procédure non pas par touches de pinceau, mais par remplissage des à-plats prédéterminés par des contours, visent à signifier l’expérience de l’émergence de la vision de Dieu à la perception des Pères de l’Eglise et des saints qui peuvent enfin en témoigner à travers l’icône elle-même. Il existe enfin, à notre avis, une forte relation entre la syntaxe figurative de l’icône et la syntaxe figurative de la photographie dévotionnelle qui rend commensurables l’instanciation de l’icône et l’acte de développement/révélation photographique. La relation entre le développe-ment photographique et la syntaxe figurative de l’icône se révèle être bien plus profonde que la relation entre l’icône et le tableau de la Renaissance, même si dans le cas de l’icône et du tableau il s’agit de l’utilisation (quasiment) des mêmes matériaux : encore une fois, ce sont les syntaxes de la manifestation des formes de leurs supports (syntaxe figurative) qui comptent pour interpréter les images de manière heuristique, et non les matériaux (genèse).
Pour résumer enfin les positions qu’on a examinées dans ces deux derniers chapitres, avant de passer à l’examen de la sensori-motricité en photographie, voici un petit schéma qui résume les positions de Dubois, Floch et Fontanille :
|
Auteur |
Relation entre technique et textualité |
Relation entre plan de l’expression et plan du contenu |
|
DUBOIS |
La technique détermine le sens de chaque image |
Le plan de l’expression est donné comme inarticulable et il n’est pas lié à un contenu spécifique |
|
FLOCH |
La signification de l’image dépasse la spécificité technique |
Le plan du contenu est en relation avec la forme de l’expression et non pas avec la substance de l’expression |
|
FONTANILLE |
La signification est donnée par la mise en relation des configurations visuelles de la photo et le rythme du faire photographique qui l’ont constituée |
Le plan du contenu est en relation avec la forme et avec la substance de l’expression |
Schéma 2
2.2.1. La syntaxe sensori-motrice dans les images photographiques
Chaque technique est une « technique du corps ». Elle représente et amplifie la structure métaphysique de notre chair (Merleau-Ponty)
Nos organes ne sont en aucun cas des instruments, ce sont plutôt nos instruments qui sont des organes ajoutés (Merleau-Ponty)
Le photographe est essentiellement témoin de sa propre subjectivité, c’est-à-dire de la façon de se placer comme sujet devant un objet. Ce que je dis est banal et bien connu. Mais j’insisterai beaucoup sur cette condition du photographe, parce qu’en général elle est refoulée (Barthes).
- Note de bas de page 66 :
-
Cf. à ce propos Dondero (2007a) et Dondero (2007b).
Dans Le mystère de la chambre claire. Photographie et inconscient (1996) le psychologue Tisseron prend en considération la sensori-motricité du geste photographique et son inscription dans les textes. À la différence du dessin « qui emprisonne l’image du monde dans le geste qui le fixe, la photographie emprisonne le geste de fixer le monde dans la matière de son image » (Tisseron 1996, p. 175, nous soulignons). Le véritable objet de la photographie pour Tisseron est donc le geste par lequel le photographe prend position entre les objets lumineux : le geste du corps du photographe construit un champ perceptif autour de soi dont l’image rend compte. D’ailleurs, la photographie est énoncée par un corps qui a pris position dans le monde, un sujet polysensoriel. Pour Tisseron il est nécessaire de s’interroger sur l’ensemble formé par l’appareil photo et le photographe, liés l’un à l’autre pendant toutes les opérations qui mènent à la réalisation d’une photographie66 qui met en scène la sensori-motricité du photographe dans l’acte machinique de la prise.
- Note de bas de page 67 :
-
Comme l’affirme Fontanille (2004) le mimétisme corporel ne procède pas par « comparaison », mais par « adaptation » et « recouvrement » de la sensation de contact de la part du mouvement corporel.
La prise d’image peut ainsi être décrite comme une expérience de corps à corps : « Le photographe n’est jamais un sujet désincarné face à un objet maintenu à distance, mais un sujet-corps pris dans une situation intramondaine dont il est un des éléments » (Schaeffer 1997, p. 25, nous soulignons). Chaque texte photographique est le résultat d’une prise de position du corps dans le monde – et non du seul acte du déclenchement. Il existe toujours une adaptation hypo-iconique67 du corps du photographe à l’appareil photo et au monde regardé à travers le viseur :
L’opération de cadrage mime en quelque sorte celle de l’accommodation visuelle d’un objet. Mais le cadrage n’engage pas seulement le regard. Pour cadrer un fragment du monde il faut se sentir d’abord pris dans le monde. Ce sont souvent des composantes sensorielles non visuelles qui mobilisent le désir de photographier un événement (Tisseron 1996, p. 168).
La photographie n’est pas seulement une façon de prendre possession du monde, mais aussi de laisser un signe de soi-même dans le monde. Le photographe se reconnaît, et se rend reconnaissable, à travers l’empreinte de soi laissée dans la configuration entière d’une photographie. Le photographe laisse la trace diffuse de sa sensori-motricité dans les zones et dans les gradients de lumière et d’ombre de l’image, qui est une façon de « se posséder en image » : « Bien plus qu’un “ça a été” de l’objet, la photographie atteste un “ça a été vécu” par le photographe » (ibidem, p. 60).
- Note de bas de page 68 :
-
Cf. a ce propos Dondero (2006b).
- Note de bas de page 69 :
-
Un autre cas d’authentification de l’image photographique est celui du regard machinique dans la photographie documentaire qui devient ainsi une photo testimoniale. Il existe une relation entre le regard productif qui déclenche la photographie, et le regard textualisé au sein de l’énoncé qui produit une référencialisation énonciative. Le regard qui rencontre notre regard dans une photographie est une énonciation débrayée qui renvoie à l’énonciation globale de la prise de la photographie même, qui fonctionne de façon bien différente d’un regard débrayé en littérature, par exemple : dans le cas de la photographie, en effet, la référentialisation mène à l’authentification : « quand l’énonciation déléguée est de même nature que l’énonciation de référence, le redoublement de la modalité sémiotique (verbale/parole ; visuelle/regard) ajoute à cette relation de référence une valeur d’authentification » (Shaïri et Fontanille, pp. 90-91, nous soulignons).
- Note de bas de page 70 :
-
Cf. à ce propos la belle analyse de Beyaert-Geslin (2006) sur la photographie journalistique et son important ouvrage sur le reportage de guerre (2009).
Si Benjamin (1936) considère la photographie sous l’angle d’une image mécanique déliée irrévocablement de l’aura de l’original et donc de la corporéité du geste du producteur, la photographie s’avère au contraire pour nous un art autographique à objet multiple (Goodman 1968) non seulement au cas où elle serait manipulée ex-post – et donc « touchée » par la main sacralisante de l’artiste68 —, mais également et surtout grâce aux marques laissées dans le texte par l’acte sensori-moteur productif : exemple évident, le flou. L’« effet-flou » est un cas d’authentification de l’image photogra-phique69 selon une appropriation sensori-motrice grâce à laquelle le texte photographique conserve l’acte vibratoire de sa production : le photographe fixe non seulement l’objet, mais le mouvement de son propre acte. L’effet de flou met en scène la sensori-motricité en tant que durée et rythme du mouvement producteur, au moment même où il trouble la stabilisation figurative du monde70. Le floutage est une stratégie énonciative qui « mime » notre proprioception, à savoir :
répond à l’(évident) manque constitutif de proprioceptivité du dispositif par des stratégies énonciatives spéciales qui cherchent à la signifier. […] La signification de telle proprioceptivité, telle qu’elle est imputable à l’observateur énonciatif, responsable de l’instanciation même de l’image, passe par la textualisation d’expériences qui ne correspondent en aucun cas aux nôtres, mais qui ne parviennent pas moins à articuler des valeurs anthropiques (Basso 2003a, p. 59, nous traduisons).
Il faut préciser par ailleurs que, dans les cas de textualités visuelles comme la photo et le tableau, la sensori-motricité corporelle est convoquée quant à une spatialité débrayée, une sensori-motricité hypothétique et non effective – qui est autre quant à l’espace de présence réalisé. Ce qui change dans le cas de la photo par rapport au tableau c’est la sensori-motricité instauratrice : celle de la peinture est une gestualité itérative, récursive (que nous retrouvons d’ailleurs également dans les cas des photos expérimentales des années ’20 construites par surexpositions successives), par contre la sensori-motricité instauratrice de la photographie peut se décrire comme événement unique qui laisse une trace de la scansion, de la clôture ou ouverture de l’obturateur. Si aux débuts de la production photographique, l’intervalle pour ouvrir et fermer l’obturateur était produit par un geste manuel sensori-moteur, l’automatisation actuelle semblerait neutraliser la sensori-motricité, même si celle-ci peut être produite par défaut : si l’ouverture en automatique est très longue, l’impossibilité de neutraliser la sensori-motricité réapparaît, et on obtient en effet une photo bougée.
La sensori-motricité est à prendre en compte même au niveau du mouvement de la personne du photographe par rapport au pré-photographique. Par exemple, dans la série de « clic » à très brève distance, la sensori-motricité est gardée en mémoire dans la sérialité de certains reportages de mode : le sens de la frénésie et de la fougue photographiques est donnée par le voisinage des prises et chaque prise, dans la succession, garde en mémoire la rapidité du déclenchement tandis que leur fréquence indique le rythme de scansion.
- Note de bas de page 71 :
-
Voir à ce propos Dondero (2007a).
Enfin, même le cas du déclencheur automatique renvoie à une sensori-motricité parce que dans l’intervalle de temps qu’il faut entre le cadrage de la part du je-photographe et mon « être photographiable » il y a eu un échange de rôles, à savoir j’ai nécessairement dû me mouvoir. Mais même si je me photographie moi-même sans déclencheur automatique, une partie de mon corps ou de mon visage sont tendus dans l’effort vers la coordination sensori-motrice et dans l’action de tenir l’appareil ou d’utiliser le miroir : tout ceci est gardé en mémoire dans le texte71.
3. De la textualité photographique aux statuts de la photographie : les pratiques
Le temps historique de la réception s’enracine dans la compétence socioculturelle du spectateur, mais s’ancre également dans la situation spécifique chronotopique qui contextualise la pratique réceptive par rapport au temps historique de l’instauration du texte : pratique d’instauration et pratique de réception sont toutes deux soumises à un temps historique spécifique, chose qui au cours de la donation du sens comporte le croisement des pertinences historiques comme dans des espèces de ciseaux, où les branches à anneaux sont gouvernées par la réception […], tandis que les lames pointues aux autres extrémités sont fonction de la pratique d’instauration qui mobilise et interroge le temps d’appréhension de la pratique de réception. Le texte est l’axe des ciseaux ; et la simple signification textuelle n’est autre qu’un découpage de la culture dans la stratification de ses sédimentations (Basso Fossali).
3.1. Pour une désontologisation de la photo : les pratiques contre l’Intraitable médiatique
- Note de bas de page 72 :
-
Au contraire, une étude historique qui se base exclusivement sur les usages sociaux de la photographie, sans prendre en compte les formes textuelles, ne peut faire autre chose que reléguer l’image à une fonction de support et de simple illustration de l’histoire sociale des coutumes et des goûts.
Comme on vient de le dire dans les chapitres précédents, la tradition théorique de l’image photographique s’est caractérisée par la recherche de l’essence du médium (le type photographique), auquel on assujettirait les différentes textualités (occurrences photographiques). Pour démanteler ce système théorique qui se fonde sur le rapport type/token, il est nécessaire de partir d’une approche des pratiques de production et de réception des images ainsi que de classement institutionnel. Pour réaliser une désontologisation de la photo, il est nécessaire de rendre compte de la diversité des textes, des genres et des statuts qui rendent illusoire une ontologie unique. La textualité photographique est à considérer en tant qu’énoncé-résultat des pratiques d’énonciation. Pourtant, elle est analysable non pas « en soi » mais à partir de ses pratiques de réception72 qui se stabilisent en des statuts divers (artistique, scientifique, publicitaire, etc.) et qui lui permettent d’acquérir une identité à l’intérieur non seulement d’une généalogie d’images du même genre (par exemple le portrait, la scène d’actualité politique, la scène d’action dans la photo de guerre, etc.), mais aussi à l’intérieur d’une série de fonctions liées à des domaines sociaux (de l’art, de la science, du droit, de la religion, de l’économie, du marketing, etc.).
Si, selon Floch, le champ de la photographie ne possède aucune territorialité médiatique spécifique au sein des études sémiotiques, nous pouvons affirmer que, certes, une sémiotique photographique ne doit pas se donner « par décret » à savoir par spécificité génétique, mais elle peut et doit être construite, et pour ce faire elle doit suivre deux voies : la première est celle qui vise à analyser les caractéristiques de son plan de l’expression à travers les traces de la production, comme on l’a dit dans le chapitre précédent, l’autre se donne en raison de la stratification énonciative des genres et des pratiques, à savoir de ces cristallisations de la parole qui construisent un minimum de territoire spécifique dans l’espace des inter-domaines sociaux. Si jusqu’à présent on s’est occupée de la première voie en mettant en comparaison la sémiotique classique de Floch et les propositions de Fontanille sur la syntaxe figurative (chapitres 1 et 2), ce troisième chapitre vise à se confronter avec les genres, les pratiques réceptives et les statuts de l’image photographique, ce qui, plus que la genèse (spécificité a priori), peut construire une spécificité sémiotique de la photographie a posteriori.
Comme le veut Halliday (1978), il ne s’agit pas de penser la textualité comme une structure abstraite tour à tour modulée par les différents contextes de situation (les pratiques et les statuts) ; une sémiotique des cultures doit plutôt assumer la sémantique des pratiques comme hiérarchiquement supérieure à la sémantique linguistique : dans ce sens ce sont les pratiques qui construisent tour à tour la textualité et les parcours possibles du sens en son sein. Cela ne veut pas dire que l’objectivité des configurations textuelles est mise de côté ou refoulée, mais simplement que chaque pratique la constitue en anamorphosant ses formes et ses textures à travers des pertinences différentes. L’exemple du flou est très éclairant à ce propos : il peut fonctionner comme expérimentation métalinguistique à l’intérieur des pratiques artistiques du début du XXe siècle, comme témoignage de la prise de risque du reporter dans le cadre d’un reportage de guerre pour la presse, ainsi que comme la révélation d’un être transcendant dans le cadre de la photo spirite du début du XXe siècle ou de la photo artistique de Duane Michals, comme une erreur dans la photo touristique ou de famille, ou encore, comme un défaut dans la photo de police. À chaque fois la relation entre formes et substances de l’expression et formes du contenu changeront en accord avec les différents paramètres de sémantisation rendus pertinents par les statuts auxquels la photo appartient.
Le niveau de l’analyse de la pratique stabilisée en statut ne doit pas être délié du niveau de l’analyse textuelle. Comme l’affirme Rastier, le sens n’est pas immanent au texte, mais à la pratique d’interprétation (2001a, p. 92) : c’est l’interprétation qui conditionne la description. Il n’existe pas d’abord des textes, et ensuite des évaluations sociales, tout comme il n’existe pas d’objets séparés que l’on pourrait distinguer des phénomènes perceptifs ou interprétatifs que ceux-ci produisent. Le statut social de l’image a une position déterminante au sein du « cercle herméneutique » :
En effet, de simples précisions philologiques sur la date, le genre, l’auteur et les destinataires d’un texte conditionnent au sens fort sa compréhension et au sens faible son interprétation : le parcours de l’interprétation part de ces conditions herméneutiques pour reconstituer les formes sémantiques du texte, puis fait retour de ces formes vers ces conditions, pour soumettre leur pertinence à un examen critique (Rastier 2001a, p. 58).
C’est la pratique qui propose les limites du texte : ce dernier il n’est pas déjà construit. Cette conception vise à porter remède à une autre conception qui, comme l’affirme Marsciani (2001), considère la textualité comme quelque chose de définitivement « déjà donnée » :
- Note de bas de page 73 :
-
Sur la difficulté phénoménologique incontournable de la « résistance des pertinences », Marsciani (2001) affirme : « Les lignes de fuite qui m’obligeront à convoquer des éléments hétérogènes seront infinies, et mes efforts pour contrôler la résistance des pertinences devront nécessairement être reportés à l’évidence à chaque instant, en m’imposant de retourner constamment sur moi-même pour vérifier la cohérence et l’homogénéité de mes choix analytiques […]. Mais, question phénoménologique : comment puis-je me fier de moi-même en chair et en os ? Quelle place finis-je par occuper dans cette tension descriptive qui participe d’une instance de connaissance tellement ancrée, tout comme le texte que j’ai en face de moi, dans les données mondaines objectives ? » (p. 83).
Le fameux postulat de la clôture du texte, condition structurale de son analysabilité, a profité pendant longtemps de certaines formes de l’objectivité donnée apparemment évidentes, et ceci surtout grâce à l’acceptation de critères empiriques et extra-sémiotiques de définition d’objet. Dans le monde des choses, est texte tout ce qui est reçu pragmatiquement comme tel. Le critère est limpide, mais cache seulement le problème de la constitution de l’objet […]. Où arrêterai-je mon texte ? Comment en reconnaîtrai-je les frontières ? En d’autres termes : comment pourrai-je le constituer ? (Marsciani 2001, pp. 82-83, nous traduisons)73.
- Note de bas de page 74 :
-
Fontanille reparcourt ici l’histoire récente de la sémiotique et notamment le passage d’une sémiotique du signe à une sémiotique du texte pour ensuite y mettre en relation les recherches contemporaines sur les objets, les pratiques et les formes de vie.
Tout ceci met en lumière la possibilité d’étudier les différents niveaux de pertinence sémiotique, depuis celui de la textualité jusqu’à celui des pratiques en considérant chaque niveau (celui de l’objet notamment, qui se situe entre celui du texte et de la pratique) comme étroitement lié et rapporté à l’autre – et dont on a déjà fait mention lors de notre sous-chapitre des « propositions » contenu dans l’introduction. Les pertinences de l’analyse (et donc également les limites de la textualité) découlent à chaque fois de la relation entre les différentes niveaux sémiotiques pris en examen. Voici le schéma proposé par Fontanille (2008)74 sur l’enchaînement entre niveaux de pertinence sémiotique :
|
Type d’expérience |
Instances formelles |
Interfaces |
|
Figurativité |
Signes ↓ |
|
|
Formants récurrents |
||
|
Cohérence et cohésion interprétatives |
Textes-énoncés ↓ |
Isotopies figuratives de l’expression |
|
Dispositif d’énonciation/inscription |
||
|
Corporéité |
Objets ↓ |
Support formel d’inscription |
|
Morphologie praxique |
||
|
Pratique |
Scènes prédicatives ↓ |
Scène prédicative |
|
Processus d’accomodation |
||
|
Conjoncture |
Stratégie ↓ |
Gestion stratégique des pratiques |
|
Iconisation des comportements stratégiques |
||
|
Ethos et comportement |
Formes de vie |
Styles stratégiques |
- Note de bas de page 75 :
-
Selon Fontanille, dans le cas des signes, la dimension à analyser est celle des unités minimales (les signes ou les figures) et dans le cas des textes, celle des « ensembles signifiants » et des textes-énoncés : « il s’agit, dans le premier cas, celui du signe, de sélectionner, d’identifier, de reconnaître des figures pertinentes, des formants qui les composent, et des traits qui les distinguent. […] Dans le second cas, celui du texte-énoncé, on tente de saisir une totalité qui se donne comme un entier composé de figures, sous la forme matérielle de données textuelles (verbales ou non-verbales), et on s’efforce de l’interpréter : il ne s’agit plus alors d’identifier et de reconnaître, mais d’attribuer une direction signifiante, une intentionnalité. […] Si on sélectionne en effet comme niveau de pertinence celui des unités signifiantes élémentaires, signes ou figures de représentation, tous les aspects sensibles de l’image sont alors renvoyés à la substance, voire à la matière du plan de l’expression, et relèvent alors d’une étude de l’histoire des techniques et des pratiques picturales […]. Mais le passage au niveau de pertinence supérieur, celui du « texte » et du « discours », intègre tout ou partie de ces éléments sensibles dans une « dimension plastique », et l’analyse sémiotique de cette dimension textuelle peut alors lui reconnaître ou lui affecter directement des formes de contenu, des axiologies, voire des rôles actantiels. En somme, les éléments sensibles et matériels de l’image ne deviennent pertinents d’un point de vue sémiotique qu’au niveau supérieur, c’est-à-dire au moment de leur intégration en « texte-énoncé » » (pp. 19-20). En ce qui concerne les autres trois niveaux, Fontanille décrit les « objets » comme une instance intermédiaire entre les textes-énoncés d’un côté, et les situations de l’autre ; d’une part, dans leur configuration d’objets-supports, ils procurent aux premiers une surface ou un volume d’inscription, qui leur impose un cadre, une disposition et une syntaxe, d’autre part, ils permettent aux textes et aux images de jouer un rôle dans les situations, et d’y figurer comme des instances énonciatives incarnées, en interaction avec les autres corps-actants qui participent à la situation même. De même, pour les scènes prédicatives et les stratégies, selon Fontanille, il faudra distinguer d’un côté leur rôle à l’égard des objets et des textes, qui consiste, en les insérant dans des pratiques signifiantes, à leur procurer une structure actantielle et modale explicite, et d’un autre côté leur rôle à l’égard des formes de vie, qui consiste à développer des stratégies d’ajustement entre pratiques signifiantes, ces ajustements facilitant ensuite la mise en cohérence des formes de vie. Quant aux « formes de vie » elles-mêmes, elles constituent l’instance englobante qui recueille les tendances et les identités qui se dégagent des situations regroupées en séries ou en classes homogènes ; les formes de vie ainsi constituées forment alors les configurations pertinentes pour la caractérisation des cultures.
Schéma n° 3 (Fontanille 2008, p. 34)75
- Note de bas de page 76 :
-
Voir à ce sujet l’analyse des affiches et des affichages (Fontanille 2004, § IV).
Dans le cas de la photographie, les signes équivalent aux formes reconnaissables d’une image (sémiotique figurative), les textes-énoncés correspondent aux photos dans leur intégralité en tant que configuration de formes attestées (et donc non seulement les formes reconnaissables comme faisant partie d’objets du monde naturel mais tout aussi le système de traits qui participent d’une sémiotique plastique) et encadrées par des limites et des frontières. L’objet concerne par contre la matérialité, voire le corps de la photo (par exemple nous pensons à la photo du Jardin d’Hiver, cartonnée et aux coins mâchés, valorisée par sa patine et décrite par Barthes 1980), la scène concerne le rôle actantiel et modale de l’image photo dans une pratique en cours (par exemple le rôle d’un album lors d’une réunion de famille, ou de la photo montrée à la télé lors de la discussion d’un fait-divers, etc.)76. Le niveau de la stratégie concernerait l’ensemble des utilisations de la photo dans un cadre actantiel unique mais non pas forcement dans un cadre spatio-temporel unique : ce niveau peut concerner aussi la biographie d’une série de photos qui changent de lieu dans le temps, ou bien d’autres pratiques photographiques ou d’autre genre qui s’imposent en se posant en compétition avec la pratique photographique « principale » ; enfin les formes de vie concernent de plus près ce qu’on a appelé les statuts au sens où certaines photos peuvent être étudiées par rapport au rôle qu’elles jouent dans la formation des communautés de goût, des idéologies et des cultures plus en générales.
Rastier, de son côté, plaide depuis longtemps pour la prise en considération non seulement des contraintes textuelles qui modèlent un observateur possible (ce qu’on appellerait énonciation énoncée), mais aussi de trois types de pratiques relatives à la constitution de la textualité :
Tant au cours de l’énonciation que de l’interprétation, le sujet n’est pas ou pas seulement un manipulateur de catégories transcendantales. Il est triplement situé : dans une tradition linguistique et discursive ; dans une pratique que concrétise le genre textuel qu’il emploie ou qu’il interprète ; dans une situation qui évolue, à laquelle il doit s’adapter sans cesse (Rastier 2001a, p. 48-49, nous soulignons).
- Note de bas de page 77 :
-
Rastier la définit comme une : « série non fermée de réécritures qui sont autant de nouvelles lectures : réécritures et lectures qui dépendent de la pratique dans laquelle elles se situent et obéissent à des finalités éthiques, esthétiques et cognitives » (Rastier 2001a, p. 408).
Ces trois types de pratiques, de la plus grammaticalisée et institutionnalisée à la moins stabilisée, chez Rastier sont fortement liées entre elles : la tradition linguistique institutionnalisée en ce qu’on appellerait des statuts se rattache à une pratique interprétative stabilisée dans les genres discursifs77, de même que cette dernière se rattache à une pratique en acte, voire à une situation précise dans laquelle le sujet et le texte photographique se confrontent à travers des actions plus ou moins programmées par la pratique institutionnalisée, ou plus ou moins imprévisibles et dépendantes d’un ajustement progressif (la scène dont parle Fontanille qui peut se complexifier en des stratégies).
Essayons de résumer ce que l’on vient de dire à partir d’une perspective énonciative (qui détermine la relation du plan de l’Expression et du plan du Contenu — relation qui est ré-établie à chaque niveau de la hiérarchisation) qui puisse tenir compte des théories qu’on vient d’examiner :
|
STATUT |
Pratiques d’usage et d’interprétation stabilisées |
Configurations de styles énonciatifs non directement observables (forme de vie de Fontanille) |
|
SITUATION |
Pratique en cours |
Énonciation en acte / perception en tant qu’action et remémoration (scène ou stratégie de Fontanille) |
|
GENRE |
Pratiques textuelles |
Praxis énonciative / mémoire perceptive et sémantique |
|
TEXTE |
Morphologie |
Énonciation énoncée (texte de Fontanille) |
Schéma n° 4
- Note de bas de page 78 :
-
Voir à ce propos Bertrand (2000 et spécialement § 3 et § 4). En ce qui concerne la sémiotique visuelle voir Dondero (2009a), Beyaert-Geslin (2009) et le dossier Beyaert-Geslin, Dondero, Fontanille (dirs, 2009) ainsi que Hénault et Beyaert (dirs, 2004).
1. Commençons par l’explication du niveau de l’énonciation énoncée. Comme on l’a déjà dit, par énonciation énoncée on entend le fait que dans chaque texte, par exemple dans une photo, on peut étudier le simulacre d’un rapport intersubjectif entre le producteur et le spectateur de l’image ; il s’agit en somme de faire l’analyse des relations entre les marques de l’énonciateur et celles de l’énonciataire pour arriver à identifier comment l’observateur peut s’accorder aux dispositions textuelles pour en avoir une saisie idéale. Il s’agit d’étudier ce qui est objectivé dans l’énoncé et qui porte les marques d’une énonciation78, marques qui peuvent d’ailleurs être mensongères par rapport au « vrai » geste d’énonciation.
- Note de bas de page 79 :
-
Rastier rappelle que Kaiser, in Das sprachliche Kunstwerk (1948), distinguait entre le je du genre lyrique, le tu du genre dramatique et le il du genre épique. Cf. Rastier (2001a, p. 353). De la même manière nous ne pouvons pas épuiser l’analyse des genres en affirmant, par exemple, que le paysage est un genre afférent au il, tandis que le portrait le serait à la relation je-tu.
- Note de bas de page 80 :
-
Sur la question, cf. Rastier (2001a, § « Les genres et l’énonciation », en part. note 23, pp. 396-397).
- Note de bas de page 81 :
-
Rastier (2001a) se réfère en particulier à l’école française de l’Analyse du discours, à Jean Dubois et à Guespin dont les études visent à remonter du texte aux déterminants sociaux et idéologiques qui l’ont produit.
- Note de bas de page 82 :
-
Sur la théorie de l’énonciation comme théorie qui prend seulement en compte un sujet transcendant, cf. Violi (2005). Pour combattre le concept de sujet transcendant et de langue générale Rastier montre que chaque texte est connecté à la langue par un discours grâce à la médiation d’un genre. Il en vient même à affirmer que c’est le genre qui détermine la langue, alléguant par exemple le fait que le genre et le discours religieux ont imposé le latin, celui de l’aéronautique l’anglais, etc. Ainsi, les langues s’apprendraient dans les genres.
2. En ce qui concerne la praxis énonciative dans le cadre de la stabilisation des genres visuels, on pourrait la définir comme la relation entre des configurations textuelles stratifiées dans la mémoire sociale d’une part et les attentes des récepteurs constituées à travers des opérations de mémoration/préfiguration perceptive et sémantique de l’autre. L’analyse de l’énonciation énoncée se révèle en fait comme insuffisante pour caractériser un genre, tant visuel que littéraire. Rastier aussi nous défie de pouvoir formuler une théorie des genres qui repose exclusivement sur la théorie de l’énonciation énoncée, sur les déictiques et sur les pronoms79. En effet, un historien peut dire « je » autant qu’un romancier, de même que Camus peut utiliser le passé composé80. Pour Rastier le sujet de l’énonciation81, reste une instance déconnectée des pratiques sociales et l’activité discursive reste conçue comme expression pure d’un sujet transcendant82. Le genre d’un texte serait donc selon Rastier cette partie de son contexte qui peut être construite comme commune entre ce texte-ci et d’autres textes : c’est ce que nous appelons dans notre schéma les pratiques textuelles ; dans ce sens, le genre instituerait ainsi un système de normes immanentes et non transcendantes au texte. Selon Rastier chaque texte, à travers son genre, se situe dans une pratique. Le genre est en fait ce qui permet de relier le contexte et la situation, étant donné que c’est en même temps un principe organisateur et un mode sémiotique de la pratique en cours.
- Note de bas de page 83 :
-
Très souvent, comme il arrive dans le cas d’Amstrong (2001), les théoriciens de la photographie ne distinguent pas entre passage d’un statut à l’autre et passage d’un genre à l’autre – comme s’il existait un genre artistique et un genre documentaire.
- Note de bas de page 84 :
-
« A chaque type de pratique sociale correspond un domaine sémantique et un discours qui l’articule » (Rastier 2001a, p. 228).
Si nous suivons la perspective théorique de Rastier, le genre s’avère donc un des horizons préliminaires à l’aune duquel toute production et interprétation textuelle sera réalisée. Le genre s’impose comme une de ces conditions herméneutiques qui permettent au parcours de l’interprétation de reconstruire les formes sémantiques du texte pour ensuite revenir de ces formes vers ces mêmes conditions, soumettant ainsi leur pertinence à un examen critique. Pour cette raison il est intéressant d’interroger la relation de la textualité photographique non seulement aux pratiques productives et réceptives, mais aussi au genre auquel ces textualités appartiennent83, qui fait office de niveau de médiation entre texte et pratique, entre usages linguistiques et normes socialisées84.
- Note de bas de page 85 :
-
Les instruments pour l’étudier échappent encore à mon sens à la sémiotique, qui n’a pas les instruments ni la conscience critique pour conduire une ethnographie des pratiques, voire l’observation des pratiques en acte ; elle peut pour le moment, dans les meilleurs de cas, étudier les pratiques récurrentes comme l’a fait Floch (1990) ou les pratiques décrites dans des romans comme l’a fait Fontanille (2008).
3. Par énonciation en acte on entend des relations actantielles entre sujets de l’interaction : situation en acte ou entre sujets et objets qui se développent en temps réel85 : Fontanille l’a décrite dans Pratiques sémiotiques — et plus précisément dans le chapitre « Efficience et optimisation des pratiques » — comme une dialectique entre programmation et ajustement qui amène directement à la construction de formes récurrentes qui caractérisent une scène. Fontanille affirme en fait :
Nous avons déjà noté que la forme syntagmatique des pratiques [la situation en acte] implique une activité et un contrôle interprétatifs, permettant, notamment, d’afficher l’identité distinctive de la pratique en cours, par rapport aux autres qui lui sont concomitantes ou apparentées. Ce contrôle interprétatif (et donc l’effet méta-sémiotique qu’il induit) opère notamment sur l’accommodation stratégique aux pratiques concomitantes et/ou concurrentes. […] le contrôle d’accommodation du cours des pratiques est en même temps et par principe une construction du sens de ces pratiques. […] le processus adaptatif est le lieu même où se forge la signification de la pratique en cours, le lieu de la « quête du sens » en acte […] cette quête du sens étant ipso facto une quête et une construction de la valeur des pratiques, elle doit s’accompagner de divers actes ou procédés de valorisation / dévalorisation (pp. 141-142).
- Note de bas de page 86 :
-
A ce sujet voir l’analyse exemplaire des affichages (Fontanille 2008, § « Etude de cas : l’affichage »), où les campagnes publicitaires concurrentes — et absentes de l’espace d’affichage — sont également prises en compte.
Fontanille considère le niveau supérieur à celui de la scène pratique, à savoir les stratégies, comme un niveau d’analyse en soi : la stratégie ne prend pas seulement en compte une pratique isolée, mais les relations entre pratiques concomitantes dans le même espace et temps, ainsi qu’en d’autres espaces et temps86 — mais tout de même liées d’un point de vue culturel, commercial, etc. (et donc apparentées sur le plan des fonctions actantielles dans un cadre sociétale). Par contre pour nous les pratiques et les stratégies se situent sur le même niveau de pertinence sémiotique de la pratique en cours (scène prédicative), même si, comme le dit Fontanille, il s’agit, avec les stratégies, de prendre en compte plusieurs pratiques en cours, concomitantes et apparentées ‑ tout en ayant des retombées sur d’autres pratiques futures et lointaines dans l’espace. Ce qui pour nous signifie un saut de niveau c’est leur stabilisation dans des pratiques institutionnalisées qui nous permettent de comprendre le fonctionnement des statuts des textes (en l’occurrence des photos) à l’intérieur des différents domaines sociaux.
Mais avant de passer aux statuts et aux styles énonciatifs, voyons comment Fontanille poursuit son raisonnement en liant la question des pratiques à l’énonciation, processus qui permet les stabilisations provisoires des plans de l’Expression et des plans du Contenu tout au long des pratiques et de leur adaptation / interprétation concomitante :
Si cette hypothèse est valide, la description de tels processus doit conduire à l’identification de sémiotiques-objets stricto sensu, constituées par la réunion d’un plan de l’expression (les formes d’accommodation syntagmatique) et d’un plan du contenu (les systèmes de valeurs). En somme, après avoir postulé que le processus d’accommodation construisait la signification de la pratique, il nous faut en apporter la preuve en montrant comment il construit peu à peu la relation sémiotique entre un plan de l’expression et un plan du contenu. Si nous acceptons plus généralement que l’énonciation soit définie comme l’ensemble des processus sémiosiques, les processus qui établissent la relation expression / contenu, alors nous sommes conduits à considérer le processus adaptatif des pratiques comme étant le ressort même de leur énonciation. L’énonciation des pratiques, c’est donc principalement leur processus adaptatif (2008, pp. 141-142).
L’énonciation en acte est donc définissable, si l’on suit Fontanille, comme la relation en acte entre les enchaînements de formes d’actions et leur adaptation/valorisation. L’adaptation, qui pourrait appartenir au plan de l’Expression, est pourtant déjà en même temps une interprétation.
- Note de bas de page 87 :
-
Je remercie Pierluigi Basso Fossali pour avoir discuté ensemble de ces questions.
4. En ce qui concerne les styles énonciatifs, ils ne sont à mon sens que partiellement superposables avec les formes de vie, étant donné que les formes de vies sont transversales aux domaines sociaux, tandis que les statuts qui ressortent des pratiques institutionnelles stabilisées sont dépendants des domaines sociaux. On pourrait peut-être affirmer qu’à l’intérieur de chaque domaine on peut identifier des formes de vie transversales aux différentes pratiques. En tout cas les statuts peuvent se concevoir à la fois comme des indications socialement stabilisées d’interprétation des textes mais ils peuvent aussi être inscrits directement dans la « surface » des textes eux-mêmes87 (pensons aux photos qui prescrivent une réception documentaire en inscrivant sur leur surface la date et l’heure de l’effectuation de la photo tout au long d’un reportage de guerre).
Quittons maintenant les considérations sur les quatre types d’énonciation pour faire un pas en arrière et voir de plus près comment la tradition théorique de la sémiologie barthésienne consacrée à la photographie a traité la relation entre texte et pratique pour passer ensuite à des chercheurs qui ont articulé davantage la question des pratiques : Floch et Schaeffer.
3.2. Pratiques de réception : à partir de Barthes
L’objectivité des sciences de la culture se constitue dès lors grâce à la reconnaissance critique de la part de subjectivité qui est en elles (Rastier).
- Note de bas de page 88 :
-
Dans d’autres cas, Barthes distingue de façon heuristique entre plusieurs statuts et genres photographiques. Sur la différenciation entre photographie de reportage et photographie artistique, cf. Barthes (1981, p. 345).
Le questionnement sur les différents statuts et sur les genres que la photo hérite de la peinture (ou qu’elle construit de façon autonome), se place aux antipodes de certaines déclarations barthésiennes : « La photo me touche si je la retire de son bla-bla ordinaire : “Technique”, “Réalité”, “Reportage”, “Art”, etc. : ne rien dire, fermer les yeux, laisser le détail remonter seul à la conscience affective » (Barthes 1980, p. 89)88.
- Note de bas de page 89 :
-
Sur la relation entre intraitable et sacré dans le champ de la photo voir Dondero (2009a).
Il est nécessaire par contre de refaire signifier ce « bla-bla » autour de la photo si on vise à outrepasser « la science impossible de l’être unique » (Barthes). Revisiter la théorie de Barthes a pour objectif de reconsidérer la conception de la photographie en tant qu’objet indicible et intraitable et montrer qu’une partie du travail de Barthes préfigure la réflexion sur les différentes pratiques de réception de la textualité, et que seules certaines images, liées à un récepteur spécifique et à un certain type de rapport affectif, peuvent se considérer comme intraitables89.
- Note de bas de page 90 :
-
Voir à ce sujet Zilberberg (2008).
- Note de bas de page 91 :
-
« Le punctum est donc l’événement énonciatif au tempo le plus vif, le “coup” » (Shaïri et Fontanille 2001). La revisitation des concepts barthésiens en termes de structure tensive formulée par Fontanille et Zilberberg (1998) ne serait pas de grand bénéfice si elle ne mettait pas en lumière une plus grande variété d’événements par rapport à l’opposition barthésienne dont elle rend compte : les variations de tempo sont infinies. Shaïri et Fontanille poursuivent : « Dans La chambre claire, Barthes n’envisage qu’un seul des modes d’enchaînement entre les deux types qu’il définit : celui où le punctum perturbe le studium ; pourtant, on sait bien que les modes aspectuels de la rencontre entre les différents types de l’advenir sont innombrables : interruption, parallélisme, collusion, bifurcation, hésitation, etc. » (p. 95).
- Note de bas de page 92 :
-
Barthes tente de cette façon de construire « une science par objet », une science qui relève des réactions que ces images provoquent en lui, arrivant à la fin non tant à une science nouvelle par objet, mais à une « ontologie affective » des images photographiques : « je tenterais de formuler, à partir de quelques mouvements personnels, le trait fondamental, l’universel, sans lequel il n’y aurait pas de Photographie » (1980, p. 22, nous soulignons).
- Note de bas de page 93 :
-
Cette opposition en calque d’autres formulées dans le domaine philosophique, comme celle de Ricœur (1967) entre explication et compréhension, où dans le premier cas l’analyse prendrait en considération une morphologie textuelle objectivée qui domine et guide le regard de l’interprète, tandis que dans le cas de la compréhension c’est l’interprète, mieux l’herméneute, qui ramène la textualité à soi. Ricœur déclare toutefois que l’opposition traditionnelle entre explication (linguistique ou sémiotique) et compréhension à la lumière d’une herméneutique ne peut tenir : si on envisage l’analyse structurale comme une étape nécessaire entre une interprétation ingénue et un interprétation critique, alors il paraîtrait possible de resituer explication et interprétation sur un arc herméneutique unique et intégrer les attitudes opposées de l’explication et de la compréhension dans une conception globale de la lecture comme reprise du sens (Ricœur 1986, p. 151, nous soulignons). Le modèle structural est donc repris par Ricœur comme médiateur entre l’approche objective (paradigme de l’explication et du studium) et le rectificatif de l’approche subjective (paradigme de la compréhension et du punctum). Si toute manifestation se donne toujours pour un sujet phénoménologique situé à l’intérieur de pratiques, nous devrons distinguer le studium et le punctum comme deux régimes différents d’observation de l’objet et de la pratique du sens de la part du récepteur. À ce stade il nous paraît nécessaire de poser le problème de la différence entre explication, compréhension et appropriation. Il s’agit de distinguer entre 1) analyse du texte à partir d’un point de vue « abstrait », 2) assomption du texte à partir d’un point de vue incarné, situé, comme document historique, ou comme œuvre d’art, etc. et enfin 3) appropriation de celui-ci en le confrontant aux valeurs du sujet, à la manière barthésienne – c’est-à-dire ramener le sens des textes au sens du vécu.
Trop souvent la tradition des études concernant le champ de la photographie a malheureusement hypostasié l’événement photographique décrit par Barthes à travers la notion de punctum sans prendre en compte le fait que le punctum décrit justement un événement au sens de Zilberberg90 et non pas une pratique qui puisse se constituer en habitude et être institutionnalisée – et devenir ensuite le modèle d’une modalité réceptive médiatique généralisée. Ce qui amène Barthes (1980) à la théorisation du punctum est un « événement » corporel qui survient sur une compétence « encore à construire »91. Les images choisies par Barthes pour mener à bien sa théorisation sont « déterminées » par l’expérience sensible : seul ce qui existe pour lui mérite d’être analysé – » j’ai toujours eu envie d’argumenter mes humeurs » (Barthes, 1980, p. 36)92. Barthes prend pour guide de la théorie photographique la « conscience de son émoi » et l’image photographique est considérée comme un corps : certaines images renvoient « à un centre tu, un bien érotique ou déchirant, enfoui en moi-même » (ibidem, p. 34). Le régime du punctum est quelque chose qui rompt les pratiques réceptives confirmées, qui ôte à la Photographie ses fonctions sociales parce qu’il isole l’image de sa circulation sociale, des pratiques interprétatives et des pratiques d’usage consolidées et reconnues. C’est plutôt le studium qui peut se caractériser comme une pratique : punctum et studium décrivent en fait pour Barthes (1980) deux différentes relations entre observateur et image photographique : la première ramène directement l’objet perçu au sujet du regard et englobe l’image photographique dans un vécu de signification intime, la seconde en revanche relève d’une perspective « détachée » et partageable par une communauté93. Les images photogra-phiques en effet peuvent nous plaire ou nous laisser indifférents (régime du studium), mais peuvent également agir sur nous comme des corps qui nous attirent et nous transforment (régime du punctum) : « je sentais […] que la Photographie est un art peu sûr, tout comme le serait (si on se mettait en tête de l’établir) une science des corps désirables ou haïssables » (ibidem, p. 36). Si le studium « a l’extension d’un champ » (ibidem, p. 47), et fait fonctionner la photographie comme document, il se caractérise par son extension spatiale et temporelle, tandis que le punctum par son intensité affective. Du reste, dans le cas de l’interprétation selon le studium, notre sensibilité n’est pas touchée parce que tout semble s’épuiser dans l’économie de notre compétence pratique. Si le studium sous-tend un modèle de photographie en tant qu’« étendue homogène » sans seuils ni ruptures, le punctum est précisément ce qui rompt la symétrie de cette étendue culturelle indifférente à l’affection.
- Note de bas de page 94 :
-
Sur le regard en surplomb et le regard situé, cf. Marrone (2001), en particulier le § 6. « L’agir spatial ».
- Note de bas de page 95 :
-
La relation entre studium, punctum et énonciation temporelle a été attentivement examinée par Shaïri et Fontanille dans leur étude : « Le studium et le punctum sont deux avatars différents du même avènement énonciatif, deux événements de tempo différents […] Sujet à la plus ample extension, sans intensité l’événement énonciatif [du studium] appartient à un tempo tout au plus soutenu, et donc au type “procès” ou “état” ; sans éclat, mais plutôt de caractère informatif, et est susceptible de se déployer dans l’extension des chaînes figuratives homogènes […] Le second est essentiellement affectif et passionnel et débute par une vigoureuse sollicitation sensorielle et corporelle », p. 94.
- Note de bas de page 96 :
-
Barthes en vient même à affirmer, dans un entretien de février 1980 : « Je crois qu’à l’inverse de la peinture, le devenir idéal de la photographie, c’est la photographie privée, c’est-à-dire une photographie qui prend en charge une relation d’amour avec quelqu’un. Qui n’a toute sa force que s’il y a eu un lien d’amour, même virtuel, avec la personne représentée. Cela se joue autour de l’amour et de la mort » (Barthes 1981, p. 333).
- Note de bas de page 97 :
-
Dans le cas de l’image qui lui « révèle » le noème de la Photographie, celle du Jardin d’Hiver, Barthes dépasse la simple reconnaissance du visage de la mère, mieux il la retrouve. Dans le cas des portraits, Barthes rapproche la simple ressemblance à l’extension d’une identité et l’air à une intensité affective : « Au fond, une photo ressemble à n’importe qui, sauf à celui qu’elle représente. Car la ressemblance renvoie à l’identité du sujet, chose dérisoire, purement civile, pénale même ; elle le donne “en tant que lui-même”, alors que je veux un sujet “tel qu’en lui-même” (Barthes 1980, p. 160, nous soulignons). A l’encontre de la ressemblance, qui est calculable, mesurable, « l’air d’un visage n’est pas décomposable », c’est quelque chose qui ne peut être décomposé et dès lors quantifié. Ce n’est pas une analogie comme l’est la ressemblance, l’air est plutôt « un supplément intraitable de l’identité », trace de la non-séparation de la personne de soi-même : le masque de la ressemblance disparaît pour céder la place à l’air comme un reflet des valeurs de vie : l’air est le règne du possible. Cf. à ce propos Dondero (2006a).
La relation de ces deux modes d’existence de la photographie dépend aussi de la temporalité rythmique de notre rencontre avec l’image. Barthes a le mérite, à ce propos, de mettre en relation deux points de vue épistémologiques – comme celui du studium et du punctum, qui renvoient l’un à la vision détachée (regard en surplomb) et l’autre à la vision phénoménologique (regard incarné et relation de « corps à corps » entre texte et sujet) – avec la description de deux micro-gestualités qui mettent en œuvre deux différentes manières de pratiquer la textualité94. Si le studium renvoie à une lecture lente et durative, le punctum relève d’une ponctualité selon laquelle l’image blesse le spectateur95. Barthes décrit donc les différentes pratiques de lecture en prenant en considération la gestualité rythmique de la réception : la pratique de sémantisation selon le studium instaure un type de lecture lente, un rythme cadencé du feuilletage sans doute distrait et nonchalant, ou bien pressé, mais en tout cas opposé à celui du punctum, tendu et fulgurant. À la différence du studium qui rend les images pertinentes comme documents historiques qui nous aident à en savoir plus, dans le cas du punctum la photographie ne sert à rien, elle ne nous informe sur rien. Il est le contraire de la Fascination : en effet, si la fascination porte à l’hébétude et à la passivité du spectateur, à l’institutionnalisation du goût, le punctum est en revanche quelque chose qui « fait vivre » d’une vie nouvelle le spectateur : « [elle est] plutôt une agitation intérieure, une fête, un travail aussi, la pression de l’indicible qui veut se dire » (ibidem, p. 37, nous soulignons). Ce type de photo est défini comme un travail sur nous-mêmes, une action qui creuse et transforme, une pression qui arrive à nous toucher et à nous surprendre. Elle est définie comme une aventure, quelque chose qui nous permet de nous aventurer en elle et par conséquent en nous. C’est donc à l’occasion de notre rencontre avec la photographie que l’aventure se produit ; cette dernière ne dépend pas des configurations textuelles de l’image, ni de nous, mais advient dans l’acte de regarder : « telle photo, tout d’un coup, m’arrive ; elle m’anime et je l’anime » (ibidem, p. 39). La photo donc n’est pas seulement, dans ce cas, simple témoignage de quelque chose qui a été, mais témoin en acte de toutes nos réactions à ce qui a été96. Dans le régime du punctum ce qui « a été » est rendu maintenant présent – c’est-à-dire au moment où nous sommes en train de regarder une photographie donnée (régime de l’énonciation en acte). De la perspective du « ça-a-été » à celle du punctum, on passe de la certitude du contrat véridictoire, répétable et mesurable, à l’effet de vivacité, qui nous frappe ici et maintenant ; de la reconnaissance on passe aux retrouvailles97. Le témoignage va bien au-delà de la documentation ou de l’effet-vérité : pour Barthes l’effet-vérité peut rester lié au studium, à la banalité de la photographie, à la ressemblance, à l’œil purement historico-documentaire. Le témoignage nous rappelle à l’ordre en tant que corps : ceci n’implique ni la ressemblance de la trace par rapport à cette origine, ni sa vérité. Témoigner ne signifie pas forcément remémorer le passé mais plutôt authentifier une présence.
Si pour Barthes le noème de la Photographie est l’Intraitable, à savoir le fait qu’une chose ait réellement été là dans ce lieu et dans le passé — » il y a double position conjointe : de réalité et de passé » (Barthes 1980, p. 120) —, le niveau textuel de l’image serait dépourvu de toute valence, défini précisément comme non pertinent à cause de son caractère intraitable. Or nous savons bien que ce qui est intraitable, c’est plutôt le regard du sujet : davantage que le texte photographique, c’est le regard du sujet sous le régime du punctum qui est « sans méthode ». Si la photographie atteste sans équivoque que quelque chose a existé, elle le fait grâce à notre façon de la regarder, à l’intensité du regard. D’ailleurs, toutes les photographies, bien qu’étant génétiquement des empreintes, n’ont pas le même pouvoir de témoigner une présence pour tout le monde : Barthes le démontre en prenant comme photographie-modèle de sa théorie personnelle la photo de sa mère petite au Jardin d’Hiver, photo qui ne nous est délibérément pas montrée parce que pour nous « elle ne serait rien d’autre qu’une photo indifférente, l’une des mille manifestations du “quelconque” » (ibidem, p. 115). Toutes les photos, tout en étant des empreintes, ne suscitent pas forcément cet effet : cela arrive seulement pour ce genre de photos qui présentifient, pour un certain observateur doté d’un certain état d’âme, l’essence de la personne aimée. Ce ne serait alors pas la configuration énonciative qui déciderait du régime réceptif de l’image, comme c’est le cas en revanche dans l’approche greimassienne, mais c’est le sujet regardeur « à un moment donné » de son expérience existentielle. Marrone affirme aussi que selon Barthes : « il faut analyser – davantage que les structures internes à l’image – la série des relations émotives que le sujet éprouve devant elle » (Marrone 1994, p. 200, nous traduisons et soulignons). Barthes, ne nous montrant pas la photo de la mère au Jardin d’Hiver, qui est la plus porteuse de liaisons émotives, semble vouloir nous communiquer que, pour accéder à la plénitude affective d’une image, il est nécessaire qu’elle disparaisse. Dans un certain sens, la magie produite par la photographie de la mère de l’auteur est exprimée devant nous lecteurs par le fait que ce soit l’unique photo décrite et non montrée : « c’est à son mutisme qu’elle doit son intensité » (Grojnowki 2002, p. 328). La lecture affective mène, dans sa limite extrême, à l’aveuglement, à un point aveugle ; la textualité devient invisible : il n’y a que l’objet-photo qui compte, l’objet matériel qui manifeste à travers sa patine les empreintes du temps.
- Note de bas de page 98 :
-
Malgré cette approche « personnaliste » de l’image, Barthes dans La chambre claire conçoit l’image photographique comme textualité. Si chez Barthes c’est la prise de position du sujet qui détermine de type de régime réceptif de l’image, cette prise de position doit toutefois trouver dans le texte quelque « appui ». Le punctum est en fait aussi décrit à partir d’une perspective textuelle et se configure comme un événement ponctuel produit à partir des « points sensibles » au sein de l’image, point aigus, « imprévisibles ».
Dans un certain sens le studium et le punctum sont respectivement le prolongement à l’infini du champ, à travers lequel on voit « tout », mais où rien ne semble à première vue ramener à nous, et le rétrécissement du champ de vision qui se rabat vers nous jusqu’à un naufrage dans la subjectivité : dans ce dernier cas, c’est l’invisible dévorant la subjectivité qui témoigne de la présence affective98.
Barthes fait en l’occurrence de sa théorie une herméneutique, si par herméneutique nous entendons une théorie du particulier dont il n’est pas possible de reconstruire une procédure puisque chaque interprétation doit être considérée comme unique. Dans ces conditions il n’est donc pas possible d’assumer, en tant que noème de la Photographie, la relation produite par la rencontre entre plaque photographique et Référent car, à en croire Barthes lui-même, cette relation se rend significative seulement dans des cas bien précis, où le lien entre le sujet photographié est de nature affective et notamment d’amour et de deuil.
3.3. Valorisations et assomptions de la textualité : à partir de Floch
Si l’ouvrage de Barthes peut nous faire réfléchir sur deux modes de réception de la photo, qui ne peuvent pas se définir comme des véritables pratiques, l’ouvrage de Floch (1986) peut nous aider à élargir la perspective et à mieux caractériser quatre types de pratiques réceptives de la photographie. Floch vise en effet à faire éclater l’idée d’une conception unique de la photographie en identifiant quatre esthétiques textuelles (voir supra) et quatre pratiques réceptives.
À partir de Bourdieu (1965), Floch identifie quatre pratiques réceptives (pratique, utopique, critique et ludique) qui peuvent être comprises comme différentes attitudes de la réception des textes photographiques. Cette différenciation des pratiques réceptives trouve son origine dans l’opposition banale, mais efficace une fois articulée sur le carré sémiotique, de la photo valorisée comme document servant à la démonstration et aux témoignages historique ou sociologique d’une part et comme œuvre d’art d’autre part.
- Note de bas de page 99 :
-
Floch considère Bourdieu (1965) comme un livre avant-coureur sur la problématique des pratiques photographiques. Bourdieu dénonce en effet à l’avance toute découverte d’une nature indicielle de la photographie qui serait à envisager comme la simple théorisation d’une des conceptions possibles de la photographie, comme une mythologie parmi les autres (Floch 1986, p. 12). Evidemment Floch critique également Barthes qui échafaude une mythologie individuelle : sa conception personnelle de la photographie est seulement « un des modes d’investissement de la photographie comme objet de valeur […]. Elle fait comprendre certaines pratiques de la photographie mais ne saurait être érigée en approche sinon scientifique du moins théorique, si l’on entend par là une approche qui puisse rendre compte de la diversité des pratiques et des idéologies de la photographie » (ibidem, p. 14).
- Note de bas de page 100 :
-
Nous devons remarquer également la grande adresse de Floch : en décrivant les pratiques, ou valorisations, selon lesquelles les textes photographiques peuvent être assumés, Floch ne les met pas du tout en communication univoque avec les esthétiques de la photographie, c’est-à-dire avec les esthétiques référentielle, mythique, oblique, et substantielle. Je crois que, même s’il est suggéré que les images artistiques qu’il a analysées sont pour la plupart des exemples de photographie mythique (le Nu de Boubat) ou oblique (Les arènes de Valence de Cartier-Bresson), il est absolument correct de ne pas affirmer de façon apriorique que certaines esthétiques renvoient dans tous les cas à certains types de pratique, ce qui l’aurait amené à affirmer que ce sont les esthétiques textuelles qui décident d’un certain type de pratique réceptive ; ce faisant, la photographie référentielle et substantielle aurait appartenu au domaine de la documentation historique ou technologique et la photographie mythique et oblique aux pratiques artistiques (utopiques et ludiques). Ce qui aurait porté à écraser la pratique réceptive sur la textualité, sur la stratégie énonciative désincarnée et dé-située.
Floch part donc d’une vieille distinction entre moyen et fin99 — dans les termes de Floch, entre valeurs d’usage (la photo fonctionne comme document, preuve et souvenir) et valeurs de base (beauté). En projetant cette catégorie sémantique sur le carré sémiotique on identifie quatre positions interdéfinies, quatre conceptions de la photographie (voir schéma 5). De l’opposition entre valeurs d’usage (valorisation pratique) et valeurs de base (valorisation utopique), on obtient d’un côté une valorisation ludique qui nie les valeurs d’usage et exalte la gratuité et le plaisir, et de l’autre une valorisation critique qui conçoit la photographie comme technique plutôt que comme art : on renverse la perspective de la photographie-œuvre d’art et on obtient celle de preuve100.
Schéma 5 (Floch 1986, p. 17)
Cette articulation des différentes conceptions de la photographie est d’une importance capitale puisque, contrairement aux études théoriques sur la photographie qui ontologisent le médium et la genèse productive, ici il n’y a aucune ontologisation du médium, ni des textualités « en soi », mais bien une ouverture sur comment un texte photographique peut être utilisé dans des pratiques différentes et par des acteurs différents. Reste à savoir quelles sont les contraintes qui rendent impossibles certaines combinaisons entre des textualités, des genres, des usagers et des pratiques. Il est par exemple possible qu’un portrait puisse être assumé à travers des pratiques ludiques d’amateurs (il s’agirait dans ce cas de photographies de famille ou de photographies de voyage) aussi bien que par des pratiques artistiques qui du portrait ne rendent pas pertinent l’identité de la personne représentée mais de caractéristiques liées plutôt au cadrage, aux jeux de modulation entre lumière et ombre, etc. On pourrait peut-être affirmer le même pour le genre du paysage. Plus improbable serait de concevoir le genre de la nature morte, qui est né en peinture et appartient aux pratiques artistiques en tant que genre qui met en scène la caducité de la vie et des choses humaines, assumé par des pratiques ludiques. D’ailleurs la nature morte est très utilisée par la photographie publicitaire commerciale qui pourrait être entendue comme typique d’une pratique ni gratuite (amateurs) ni esthétique (artistes), à savoir une utilisation propre aux bricoleurs qui peut aussi impliquer une utilisation informative et testimoniale mais en tout cas hétéronome par rapport à la valorisation de la photo en tant que telle. La pratique des bricoleurs valorise en fait la photographie comme instrument utile pour d’autres objectifs qu’elle-même (utilisation technique). On y reviendra.
L’enjeu d’une sémiotique des pratiques de réception de la photo est finalement de rendre compte non seulement de la pratique réceptive inscrite dans la textualité, sous forme d’énonciation énoncée, mais des valorisations en tant que ré-assomptions et ré-énonciations du texte au sein des différentes situations de la vie quotidienne. Chaque pratique singulière met en perspective le texte : ces valorisations dépendent de l’assomption du texte comme document, œuvre, etc., ou encore, les différentes pratiques peuvent rendre pertinentes dans le même texte des configurations plastiques et valorielles différentes.
Ce qui a toujours été fait en sémiotique structurale-générative est d’expliquer, à partir du texte, comment la morphologie et les stratégies énonciatives peuvent en guider la réception — et prévoir un observateur-modèle ; elle a moins étudié comment les pratiques réceptives peuvent rendre pertinents, dans un même texte, des isotopies et des parcours de sens différents. Malgré que Floch propose quatre types de parcours de sens, les exemples d’analyse contenus dans Formes de l’empreinte traitent seulement la photographie subsumée sous un statut artistique ; Floch n’approfondit pas la question qu’un même texte puisse signifier différemment selon qu’il est considéré comme texte esthétique ou comme texte informatif. En fait, les mêmes images, à des moments différents de leur existence, peuvent être interprétées sous des statuts différents. Si les historiens, par exemple, rendent pertinents plutôt les aspects thématiques et figuratifs de l’empreinte photographique, les artistes valorisent davantage des syntaxes plastiques de l’image, ou les configurations méta-textuelles qui rendent pertinentes les frontières du représentable par l’empreinte photographique, bref toutes les configurations visuelles qui semblent forcer les caractéristiques syntaxiques d’un médium jusqu’au détournement des propriétés qui en font la spécificité.
Avec Floch on inaugure donc au sein de la sémiotique greimassienne la réflexion sur les pratiques réceptives de la photographie en prenant en considération la problématique des régimes de sémantisation – dans le but de rendre compte des diverses interprétations sociales des images photographiques.
Mais il faut faire attention à certaines ambigüités du travail de Floch à ce sujet. En fait, quoiqu’il vise à analyser de façon autonome le versant des pratiques, qui déterminent la ré-énonciation pratique d’un texte et non seulement le niveau de l’énonciation énoncée, lorsque Floch reprend cette distinction entre valorisations pratiques et utopiques, dans Sémiotique, marketing et communication (1990) et dans Identités visuelles (1995), il combine — sans la problématiser — la conception de la valorisation en tant que pratique de ré-assomption du texte (niveau de la pratique et de l’énonciation en acte) avec la valorisation comprise comme enjeu énonciatif (niveau du texte et de l’énonciation énoncée). En effet, dans les analyses publicitaires contenues dans ces deux ouvrages, l’automobile ou le bijou est valorisé au sein du texte comme ludique ou utopique, etc., et ce n’est pas le texte publicitaire lui-même qui est assumé comme ludique ou utopique. Dans un cas, Floch avance clairement que le niveau global de l’analyse est celui de la pratique de valorisation et le niveau local, déterminé par cette pratique, celui de la textualité ; dans l’autre, le niveau global pertinent à l’analyse semble rester celui de la textualité et de ses stratégies énonciatives qui déterminent le niveau local, c’est-à-dire l’objet de valeur représenté dans les publicités analysées. On revient ainsi au niveau classique de l’analyse, celui de l’énonciation énoncée.
- Note de bas de page 101 :
-
Comme affirme également Rastier, entre texte et situation un « cercle vertueux » de sélections de pertinences réciproques doit s’instaurer.
Il faudrait par contre essayer de combiner les deux points de vue en considérant que les pratiques réceptives ont au moins autant le pouvoir de transformer la textualité que la textualité celui de guider la pratique réceptive : texte et récepteur se constituent dans leur relation réciproque, c’est-à-dire que le texte est valorisé par la pratique du récepteur, mais que, en retour, c’est le texte qui a le pouvoir d’orienter le récepteur vers une certaine pratique101.
3.4. Pour une pragmatique de la réception : à partir de Schaeffer
Un autre chercheur qui prend en compte les pratiques d’interprétation et d’usages des photos dans une orientation sémiotique et en allant contre l’ontologisation de l’image photographique est Jean-Marie Schaeffer. Schaeffer (1987) se propose d’interroger le niveau de circulation sociale « virtuelle » de l’image photographique, à savoir sa logique pragmatique. Dans ce sens le philosophe analyse l’image photographique au sein des pratiques et des conduites dans lesquelles elle est impliquée. Schaeffer veut envisager l’image photographique non tant comme « représentation », ni comme « expression d’un message » :
L’aspect le plus irritant, mais aussi le plus stimulant, du signe photographique réside sans doute dans sa flexibilité pragmatique. Nous savons tous que l’image photographique est mise au service des stratégies de communication les plus diverses. Or, ces stratégies donnent lieu à ce que je propose d’appeler des normes communicationnelles, et qui sont capables d’infléchir profondément son statut sémiotique (Schaeffer 1987, p. 10).
- Note de bas de page 102 :
-
Voir à ce propos aussi Lefebvre (sans date) : « Évidemment quand on parle de la photo comme d'un indice, on a en tête le rapport entre la photo et l'objet photographié – ce qui n'est qu'un seul des nombreux rapports qui unissent existentiellement la photo au monde –, et il ne fait pas de doute que tant qu'il s'agit de photo traditionnelle (c'est-à-dire non soumise à des transformations numériques, par exemple), un tel rapport existe selon lequel la photo est toujours un signe indiciel en puissance (mais cela vaut aussi pour tout ce qui existe dans notre monde). Il ne le devient effectivement que lorsqu'il est interprété de la sorte, c'est-à-dire lorsque dans l'usage il sert à faire connaître le monde en fonction principalement de ce rapport » (nous soulignons).
- Note de bas de page 103 :
-
A ce sujet voir le questionnement de Beyaert-Geslin (2009) sur la photographie de reportage et l’authenticité et authentification de la trace de la scène.
Par cette affirmation, qui suppose le statut multiple et instable de l’image photographique, Schaeffer prend ses distances par rapport à une théorie généralisante de la photographie. Schaeffer affirme que le statut de l’image photographique, précaire et sujette aux transformations, doit être interrogé dans sa phénoménologie sociale. Pour rendre compte de la vie sociale des textes photographiques, Schaeffer aborde l’image photographique également à partir de sa genèse, de son dispositif particulier de reproduction de la vision, et affirme qu’aucun discours sur la photographie ne peut ignorer que sa spécificité est la production physico-chimique et son (possible) statut d’empreinte. En effet, les différents statuts et les pratiques réceptives de l’image peuvent rendre plus ou moins pertinentes les caractéristiques de ses pratiques productives : dans ce sens Schaeffer n’est pas intéressé par la genèse de l’empreinte de façon abstraite et dans l’absolu ; la signification indicielle est pertinente seulement en relation avec certaines pratiques interprétatives, voire elle doit être renvoyée à ce que Schaeffer appelle la construction pragmatique de l’image. La matérialité de l’image n’intervient donc pas dans l’interprétation avant que celle-ci ne devienne significative au niveau de ses statuts réceptifs (l’image peut fonctionner comme empreinte dans certains cas). La photographie est toujours une trace, mais ne fonctionne pas toujours comme empreinte102 : l’empreinte n’est pas une condition a priori de chaque image photographique, mais un effet de sens de celle-ci qui est rendu pertinent dans certains statuts de l’image photographique. Il est nécessaire que durant l’acte interprétatif on dispose d’un savoir qui concerne le fonctionnement du dispositif photographique génétique : l’image photographique devient un indice (ou une empreinte) quand le statut sous lequel elle est pratiquée rend pertinent à la signification qu’elle soit l’effet de radiations qui proviennent de l’objet ou de la scène « proto-photographique »103. Cet argument est d’autant plus prégnant de nos jours que nous sommes face à l’indécidabilité – à partir de la seule observation de la textualité – entre photographie analogique, photographie numérique, image de synthèse. Un savoir extra-textuel est nécessaire pour pouvoir au moins décider de quel type de sémantisation un certain texte est passible : rappelons nous à ce propos que même pour les images picturales il est nécessaire, comme le relève Goodman (1968), de connaître l’histoire de leur production pour pouvoir distinguer entre le tableau original et le faux, indiscernables à l’œil nu. Certes le savoir que nous possédons sur la genèse photographique ne doit aucunement écraser la signification textuelle des différentes images. Pour garder distinct le savoir sur la genèse et la règle communicationnelle Schaeffer distingue, dès le début de son ouvrage, entre la matérialité de l’image (et sa genèse) et son statut sémiotique (normes communicationnelles impliquées) : Schaeffer affirme qu’au niveau de la matérialité photonique l’image doit être comprise comme digitale (l’image « physique » est matériellement discontinue), tandis qu’au niveau de la vision, elle doit être comprise comme analogique. Lorsqu’il parle de matérialité de l’image, Schaeffer rend pertinente la production, tandis que quand il parle d’image photographique en tant que textualité construite, il rend pertinentes les normes de sa réception.
- Note de bas de page 104 :
-
Voir à ce sujet Dondero (2010f et 2011a) et Dondero (2009c) où ce type d’image est appelé visualisation (au sens où elle peut être manipulée selon différents paramètres, filtrée, etc.) pour la distinguer justement des images qui stabilisent une iconographie et ainsi un objet scientifique institutionnalisé et livré à la vulgarisation.
Schaeffer illustre les divers statuts de l’image, testimoniale, artistique et scientifique : cette dernière surtout relève de l’image comme empreinte chimique, c’est-à-dire comme résultat d’un dispositif technologique. Il y a donc pour Schaeffer des cas de « réception digitale », où la reconstruction de la genèse photographique est essentielle pour son interprétabilité — pensons à l’astrophotographie. Dans ce cas pourtant on n’est pas face à une image pratiquée comme photographie, comme on l’entend communément, mais plutôt à une image pratiquée comme texte photonique, autrement dit, on la rend pertinente exclusivement comme résultat d’un procès physico-chimique et non pas comme vision construite par des subjectivités. Cela revient à dire que l’image en astrophysique est considérée comme visualisation de données : on pourrait même dire que le terme de digital utilisé par Schaeffer peut être entendu comme synonyme de « allographique » selon Goodman (1968) voire comme image qui donne des informations qui se rendent manipulables et répétables, bref une image qu’on peut déconstruire et reconstruire : il s’agirait en somme d’une image mathématisable qui n’est pas pertinente pour son iconographie (toujours modifiable) mais pour sa fonction de « terrain de travail », c’est-à-dire de lieu contrôlable d’expérimentation104. On reviendra sur cette question dans l’étude ici contenue intitulée « La photographie scientifique : entre trace et mathématisation ».
Lorsqu’on passe du statut qui rend pertinente l’image en tant que visualisation digitale-photonique (scientifique) au statut analogique (tous les autres statuts), la relation entre les corrélats purement physiques de l’impression et de l’empreinte deviennent des corrélats entre des signes visuels qui informent d’une vision anthropomorphe. On se met donc à analyser « le tracé des mouvements [qui rendent pertinente] la figuration des objets » (Schaeffer 1987, p. 18) et non plus seulement les zones imprégnées par les différents degrés d’intensité lumineuse. Schaeffer affirme que dans le passage du photonique au photographique on passe de la pertinence de la technologie à visée scientifique, à une image comprise comme résultat d’une lecture culturelle et d’une interprétation sociale largement partageable. Pour Schaeffer la trace, c’est-à-dire le niveau photonique de l’image, relèverait de simples tracés de mouvement, donc d’une syntaxe pas encore figurative – au sens d’analogue à la corporalité humaine –, tandis que l’image en tant que vision relèverait d’une interactantialité et d’une commensurabilité avec notre expérience (tout aussi corporelle).
- Note de bas de page 105 :
-
Sur la photographie spectrale des étoiles, cf. Schaeffer (1987, pp. 75-76).
Cette distinction de Schaeffer vise à critiquer le traitement de l’information analogique de la photographie en termes de perspective digitale et cybernétique. Sur le plan de la matérialité de l’image photographique nous nous trouvons indéniablement face à une codification binaire discontinue. Les grains d’halogénure se présentent en deux états, sensibles ou non, et la trame de l’image n’est autre qu’une série de bits, dont dérive la facilité à la traduire dans le système binaire des images mathématisables. Au niveau de la structure photonique, l’image peut être étudiée comme système fermé, canal d’information où l’input (le rayonnement lumineux) et l’output (l’empreinte formée par les grains d’argent transformés) peuvent être quantifiés et mis en équation ; de même on peut l’étudier comme codification énergétique définie par la discontinuité des quanta d’énergie, ce qui équivaut à adopter une perspective mathématique105. L’approche cybernétique permet donc une quantification de l’information photographique.
- Note de bas de page 106 :
-
Pour une proposition de traduction entre les divers systèmes informationnels, qui vise à réduire l’information humaine à l’information photonique, cf. Moles (1981) ; sur son concept de communication intentionnelle, cf. les observations de Schaeffer (1987, p. 77).
- Note de bas de page 107 :
-
Van Lier (1983) à son tour affirme qu’un commun dénominateur minimal des photographies est qu’il s’agit toujours d’empreintes lumineuses, de photons venus de l’extérieur qui ont empreint une pellicule sensible : « Il y a eu un événement, l’événement photographique : la rencontre de ces photons et de cette pellicule. Cela a certainement été. Quant à savoir si à cet événement physico-chimique en a correspondu un autre, un spectacle d’objets et d’actions, dont les photons empreints seraient les signaux en tant qu’émis par eux, c’est beaucoup plus problématique et demande à être soigneusement précisé. Vois-je la réalité de choses et d’actions passées ? Ou seulement un certain nombre de photons émis par elles selon un système de sélection sévère et artificiel ? Toutes les inexactitudes dans les théories de la photographie viennent de ce que l’on est passé un peu précipitamment sur le statut bizarre des empreintes lumineuses, empreintes très directes et très assurées de photons, mais empreintes très indirectes et très abstraites d’objets (Van Lier 1983, nous soulignons, p. 15) ». Dans ce sens, le travail de Van Lier, comme celui de Schaeffer, vise à éviter de rabattre la valence sociale d’une image sur la valence génétique et physico-chimique. Schaeffer ne fonde pas sa théorie sur le dispositif, mais plutôt sur le fait que « cette spécificité physico-chimique est prise en compte (ou n’est pas prise en compte) au niveau de l’image comme signe analogique […] : ce qui m’intéresse, ce n’est pas de construire une théorie photographie “pure”, mais de décrire son fonctionnement effectif » (1987, p. 28) et donc sa pratique sociale et communicative.
Au niveau analogique, c’est-à-dire de la sémantisation sociale étendue, les informations physiques sur la surface moléculaire des corps, l’information cybernétique digitale et discontinue ne sont pas déterminants, vu que dans ce cas nous rendons pertinentes seules les formes continues et globales106. En même temps, en passant de la trace à l’image, voire du photonique au photographique, nous nous déplaçons non pas de deux types différents de textualité, mais de deux divers types d’assomption. La première concernerait une assomption scientifique, tandis que la seconde une préhension analogisante (qui peut comprendre le statut artistique, publicitaire, etc.)107. En effet il n’existe pas d’images qu’on puisse rendre pertinentes ontologiquement comme photoniques ou comme photographiques a priori : même l’astrophotographie devient une « vision photographique » lorsqu’elle passe d’un statut scientifique à un statut artistique, par exemple. La même astrophotographie n’est plus pertinente à cause de son pouvoir être « mesurable » et reproductible : les combinaisons des traits plastiques se reconfigurent afin de construire de nouvelles combinaisons eidétiques pour un public et un cadre d’exposition différents. De surcroît, ces combinaisons eidétiques nouvelles prendront d’autres significations selon les séries d’images artistiques à l’intérieur desquels elles s’inséreront. Il importe à Schaeffer en fait de remarquer que ces distinctions ne concernent pas des classes d’images diverses, mais les régimes de sémantisation qui les subsument. Pour Schaeffer, en somme, ce qui est nécessaire à l’interprétation c’est la prise en compte d’« un savoir latéral déjà constitué, permettant d’insérer le signe qui “survient” dans un ensemble de stimuli et de savoirs organisés : la manifestation “originaire” d’une galaxie ne fonctionne comme telle que dans le cadre du savoir de l’astrophysicien et non pas dans l’absolu (ibidem, p. 55) ».
3.4.1 Le savoir sur la genèse
Ne pouvant pas étudier dans le cadre de cette étude les pratiques en acte, on se consacrera aux différentes normes communicationnelles qui appartiennent à chaque pratique réceptive institutionnalisée. Chaque image photographique est un texte qui vaut au sein de et pour une situation et un statut donnés. Dans ce sens alors chaque interprétation et chaque pratique en acte, qu’elle soit instanciatrice ou réceptive, est réglée par la remémoration et par l’anticipation :
l’énonciation comme l’interprétation prennent pour objet, non le rapport entre la chose à dire ou à comprendre et son expression, mais le rapport entre le déjà dit, déjà entendu — ou déjà écrit et déjà lu — et ses suites prévisibles (Rastier 2001a, p. 49).
En effet, une image ou un corpus d’images peuvent devenir incompréhensibles s’ils sont depuis trop longtemps soustraits à une tradition interprétative :
le sens d’un texte n’est clôturable que par l’arrêt de ses lectures, qui appartiennent alors au passé ; il quitte alors ainsi la tradition et la vie, et cette clôture témoigne plutôt d’une fermeture que d’une plénitude, car un livre fermé n’a plus de sens (ibidem, p. 278).
- Note de bas de page 108 :
-
La vérité authentique de la scène représentée par exemple n’est pas fondamentale dans le cas de la photo artistique, comme elle l’est dans le cas de la photographie de reportage. D’ailleurs, comme le fait remarquer Beyaert-Geslin (2009), la photographie de reportage est soupçonnée de mensongère si elle propose des sujets trop beaux et des poses avec des ambitions esthétisantes. À ce sujet voir aussi Forentint, Edwards et Duganne (dirs, 2007), Fiorentino (2004), Pezzini (2008) et Sontag (2002). Mais il faut pourtant remarquer que la beauté a beaucoup d’importance dans la sélection des images dans la vulgarisation scientifique savante, où on est bien conscients qu’une certaine harmonie de couleurs et de formes, un cadrage symétrique, etc. sera plus convaincante dans le cas du genre discursif de la vulgarisation ; elle ne le sera pas forcement dans le cas du compte-rendu de laboratoire, où l’effet de non-fini peut avoir son efficace persuasive pour signaler la difficulté du processus d’expérimentation. Pour une discussion sur les paramètres de jugement de l’image artistique et scientifique voir Beyaert-Geslin et Dondero (dirs, 2011).
De même, la lecture d’un livre a un sens parce qu’il en existe une pratique stabilisée qui renvoie l’objet à un récepteur : la photographie ne peut être désincarnée de la pratique culturelle de prendre des photographies et de les utiliser de façon extrêmement variée. La photographie existe à partir de la pratique qui l’englobe, étant donné qu’elle est une institution culturelle comme le livre, et ne peut être pensée en dehors de la pratique qui l’a fondée, sous peine la perte de valeurs anthropiques. Par conséquent, l’information sur la genèse de l’image devient pertinente au sein de maintes pratiques de sémantisation et de réception. Quand la photographie est née, on croyait que chaque image définie et « réaliste » était inévitablement une photo, c’est-à-dire congruente par rapport à une réalité existante documentée ; en revanche, de nos jours, à une époque où des représentations hautement définies peuvent être des mondes possibles construits ad hoc à travers une syntaxe d’éléments figuratifs retraités de façon numérique, le récepteur trouvera son crible épistémique tout à fait indécidable. Mais pour peu qu’on soit au courant du processus de production, alors l’image peut à nouveau être interprétée : le savoir sur la production d’une image modifie les effets de sens ou, du moins, par rapport à certaines genèses productives, certains effets de sens ne sont plus passibles de réalisation108.
- Note de bas de page 109 :
-
Sur la connaissance extratextuelle, cf. Bernhardt (2001, pp. 21-30). L’approche de Schaeffer (1987) est plus approfondie et heuristique lorsqu’il distingue l’importance du « savoir latéral » sur l’image non pas à partir de l’idée de « preuve », mais à partir de la valence du « statut d’empreinte » de la photographie au sein des différentes pratiques réceptives, en particulier le témoignage. Nous y reviendrons.
Certes, nous ne pouvons pas nous dispenser de remarquer que, si nous considérions également le « savoir sur la production » sous l’angle d’un texte, dont il faut se fier ou pas, nous pourrions commettre la périlleuse dérive des contextes. Si nous savons par un autre texte que ce que nous sommes en train de regarder est réellement une photographie, nous aurons tendance à renforcer une sémantisation plutôt qu’une autre mais, à la fois, comme l’information sur le texte photographique nous est arrivée par le truchement d’un autre texte, nous devrons le passer au crible épistémique. Et ainsi de suite. La dérive montre qu’à la fin, vu l’impossibilité de certitudes, nous sommes contraints de parier sur les textes. Dès lors, nous étudions un texte ou une série de textes parce que nous savons qu’il y a des conditions pour que nous puissions parier sur tel texte ou telle série, ou que en tout cas tout texte documentaire à l’appui ne pourrait que nous conforter ou non dans le parcours de sens que nous avons actualisé, mais jamais le certifier entièrement109.
Dans ce sens, une image photographique sémantisée en tant que texte testimonial tel qu’une photo de reportage de guerre doit être considérée comme autographique (Goodman, 1968) parce que ses effets de sens et son efficace sont liés à l’histoire de sa production : la trace d’une co-présence originelle entre espace de l’énonciation perceptive et espace de la région du monde perçue consent une activation tacite d’un contrat de véridiction et une relative croyance épistémique. La trace, qui fait fonction de cadre veridictoire, transforme le photographe et l’observateur de l’image en témoins. Différemment, savoir que l’image que nous sommes en train de regarder est un photomontage ou une image de synthèse, entamera le contrat communicationnel de témoignage : c’est dans cette optique que la textualité est interprétable à partir des pratiques et que l’aspect génétique se remet à compter, surtout dans le cas du statut des photographies documentaires et de leurs circuits culturels. Si dans le cas de la documentation les éléments extra-textuels sont pertinents voire indispensables pour révéler la production de l’image, dans le cas de la photographie artistique le savoir sur le dispositif peut ou non avoir de l’importance.
- Note de bas de page 110 :
-
Cf. à ce propos Basso (2003a).
- Note de bas de page 111 :
-
Par exemple, en temps de guerre, on ne tire pas directement sur les photoreporters parce que leur statut est médiatique et non belliqueux, mais au cas où interviendrait une pratique de prise d’otages, celle-ci transformerait les caractères institutionnels du scénario. De sorte qu’on pourrait dire que la dépendance de la pratique de la situation n’existe qu’en termes de caractères normatifs qui devraient la conditionner, ce qui ne signifie pas que la situation locale ne puisse pas s’émanciper de la normativité institutionnelle de la pratique et repositionner le cadre inter-actantiel et les axiologies valides. Ceci signifie que chaque photographie reproduite est ramenée à l’exercice d’une situation, à ses conditions d’exercice et d’adaptation à la trajectoire sémantique d’une pratique.
Les pratiques interprétatives qui donnent sens à l’image photographique sont donc fortement liées aux pratiques productives. Si le fait qu’une pratique s’effectue ou non dépend de la situation que nous pourrions définir comme un scénario inter-actantiel minimalement institutionnalisé110, en même temps la pratique a le pouvoir de redessiner la situation locale111.
En ce qui concerne, par exemple, le cas de la photographie de reportage, sur lequel on reviendra de manière plus approfondie dans les prochaines pages, l’étude de sa pratique montre que la photo est témoignage d’une pratique dont l’exercice a été possible. Ce « pouvoir avoir été » de la pratique est fonction de certaines conditions qui dépendent de la situation et des restructurations possibles de la situation par la pratique.
- Note de bas de page 112 :
-
Comme l’affirme Rastier : « Il [le texte] est produit dans une pratique sociale déterminée : c’est là un principe d’écologie. Bien que non suffisante, la connaissance (ou la restitution) de cette pratique est nécessaire, ne serait-ce que parce qu’elle garantit la délimitation du texte » (2001a, p. 21, nous soulignons).
Si nous prenons un autre cas, celui des photogrammes extrapolés de la caméra cachée, nous devons encore mettre en jeu la pratique même, sinon la photo n’a pas de sens112 : la photo d’une personne au bain, dans un lieu où il est interdit de regarder, montre que la pratique de la caméra cachée peut restructurer les interdits. Il y a des effets de sens qui dépendent des conflits et des adaptations entre scénario institutionnel-normatif de la pratique et déroulement de la situation. L’utilisation de la caméra cachée montre un conflit entre les axiologies convoquées par la pratique de la vie privée et les nouveaux axes de valorisation qui sont constitués localement par la situation en acte. Symétriquement, si les valeurs assumées comme normatives sont contredites ou éludées, la caméra cachée a la possibilité d’exercer un pouvoir pour les réaffirmer. Dans ce sens, il existe une performativité des valeurs en acte dans la situation parce que des conditions et des conséquences existent par rapport à leur observance ou leur inobservance.
3.4.2. Le cas du photojournalisme entre production et réception
- Note de bas de page 113 :
-
Au sujet du photojournalisme comme voie médiane entre la pratique auxiliaire documentaire et la pratique artistique voir Saouter (2007).
- Note de bas de page 114 :
-
Voir à ce sujet aussi Van Ypersele (2007) qui discute des photographies appartenant au photojournalisme en montrant des exemples d’images prises dans le feu de l’action et d’autres dont la mise en scène est réalisée a posteriori à l’aide d’acteurs et de figurants. L’auteure discute aussi de l’emploi d’exemples d’images anciennes pour illustrer un nouvel événement à l’aide de nouvelles légendes (pp. 141 et sq).
- Note de bas de page 115 :
-
Cf. Freund (1974, p. 155).
- Note de bas de page 116 :
-
Dans des cas de ce genre c’est le témoignage du photographe qui vaut comme preuve car, quoique sa photographie sorte du rayon de son domaine interprétatif – l’image étant sémantiquement autonome de l’intention de son producteur – il peut avoir une valeur juridique.
- Note de bas de page 117 :
-
Sur la description verbale de l’image photographique comprise comme méta-discours non innocent, cf. Baetens (1994).
La théorie de l’objectivité de l’image photographique dont on a tant discuté et dont on continue à discuter présuppose que l’image photographique doive fonctionner, du moins au sein de certaines pratiques, comme preuve irréfutable de son imprégnant. Dans le genre, très vaste d’ailleurs, de la photo de presse, qui se définit par l’insertion d’images dans des articles qui mettent en scène des faits d’actualité ou à teneur historique, l’image devrait fonctionner comme preuve de ce qui est raconté par le journaliste dans l’article en regard. Cette affirmation est contredite par de nombreux exemples. En fait le cas du photojournalisme, qui est le fief où l’image est surtout utilisée à des fins éthiques de témoignage113, montre l’« arbitrarité » de l’image photographique même dans ce domaine : comme le montre la théoricienne et photographe Freund dans Photographie et société (1974), une même image peut être valorisée de façon très diverse par des en-têtes différents, voire inféodée à des idéologies politiques opposées114. Une même photo prise par Freund dans les années ‘70115, qui met en scène des agents financiers de la bourse de Paris, a été utilisée par diverses en-têtes journalistiques qui en valorisent des possibilités de signification diverses, voire opposées116. Les différentes interprétations dont est passible l’image sont dues non seulement à l’activité judicatrice de l’interprète, mais aussi à l’insertion de didascalies. En fait, toute assertion référée à l’image117, du moins si elle est compatible avec celle-ci, a tendance à être acceptée comme véridique : le discours verbal se présente comme « dérivé » des images qui prouvent un événement donné, légitimé par la trace indicielle. Mais les exemples de Freund démontrent au contraire que l’unique contrainte que l’image puisse imposer au discours est celle de la compatibilité avec l’écrit – et non celle de la détermination.
La croyance du lecteur en l’adéquation entre référence réalisée par le récit journalistique et renvoi indiciel de l’image n’est pas seulement due à une bonne stratégie rhétorique du récit, mais à une norme constitutive du témoignage qui veut qu’on identifie le dit avec le montré : la véridicité intrinsèque du dit est postulée par l’accompagnement de l’image photographique. C’est comme si le discours journalistique déléguait au statut indiciel de l’image photographique et au savoir du dispositif toute responsabilité éthique. Mais, réciproquement, une photographie devient un témoignage uniquement si elle est insérée dans une stratégie communication-nelle précise : une image amputée de son récit verbal redevient hautement précaire et peut alors par exemple être valorisée pour d’autres qualités entre autres formelles si elle assume un statut artistique.
Si, surtout dans le photojournalisme, les légendes qui accompagnent une photo ont le pouvoir de transformer le sens de façon radicale, nous serions tenté d’affirmer que c’est seulement au niveau photonique que l’image peut se dire « preuve » du représenté, puisque c’est le seul niveau par rapport auquel une relation quantifiable et calculable peut s’établir entre l’imprégnant et l’empreinte. Mais la valeur de témoignage d’un reportage journalistique, tout en se basant sur la connaissance du dispositif, ne se réduit pas à celle-ci. Schaeffer nous propose de dissocier l’auto-authentification qui concerne la fonction indicielle de l’image et l’information analogique : la fonction indicielle ne peut garantir aucune interprétation sociale de l’information analogique. Il est en effet important de distinguer entre assertions référentielles (liées à la thèse d’existence de la fonction indicielle) et assertions descriptivo-interprétatives : tandis que les premières dépendent du savoir sur le dispositif, les autres dépendent des pratiques de sémantisation. Il faut donc distinguer le niveau où l’image est une « preuve d’existence » (niveau photonique) du niveau où elle est considérée comme un témoignage (niveau photographique). Si la spécificité de l’image photographique est d’être « affectée » par l’objet qu’elle met en scène, la relation indicielle n’est cependant pas suffisante pour expliquer le fonctionnement de l’image photographique au niveau de la réception et des normes communication-nelles, ni d’ailleurs de sa « vérité » éthique comme le dirait Beyaert-Geslin (2009).
3.4.3. Sur l’intentionnalité productive
Si le sens des images ne dérive pas exclusivement de leur technique de production, il ne s’enracine pas non plus dans l’intention du photographe qui les a produites. En effet, l’espace de la réception est un « espace fluctuant » (Tisseron 1996, p. 111) au sein duquel le sens d’une image peut varier et acquérir des significations même opposées par rapport aux intentions du producteur. Comme l’affirme Rastier : « Un modèle de l’intention ou de la production ne peut passer pour un modèle du texte, du moins tant qu’il n’est pas articulé à un modèle linguistique ; et, même alors, l’intention demeure un conjecture (2001a, p. 15) ».
Si la lecture d’une photographie se limitait à aller à la recherche des intentions productives, on épuiserait le sens d’un texte dans sa cause. Un exemple intéressant reporté par Tisseron à ce propos est celui de l’œuvre photographique de Marc Garanger Femmes Algériennes 1960. Ces clichés étaient destinés à régulariser la situation des femmes algériennes par rapport aux autorités françaises d’occupation et à être utilisés sur les cartes d’identité. Or ces images, faites pour obéir à un ordre militaire, sont lues, à l’opposé, pour leur force de dénonciation de cette même guerre et utilisée contre le gouvernement français. En leur temps chargées d’une force dénonciatrice ignorée par le public français, elles assument de nos jours même un statut artistique et sont exposées dans les musées.
Freund (1974), comme on vient de le voir, insiste sur le fait que les mêmes images puissent devenir compatibles avec des didascalies très diverses, voire opposées, ou que les mêmes photos, accouplées et juxtaposées de façon diverse, puissent construire des relations et des isotopies antithétiques et servir sous diverses en-têtes journalistiques à des fins politiques opposées à celles prévues par le photographe. D’autres exemples toutefois, qui ne visent pas à invalider ceux-ci, et qui dérivent de l’expérience d’autres chercheurs, veulent cependant nous avertir qu’il ne faut pas sous-évaluer le pouvoir de l’intention productive sur l’interprétation : de nombreux cas historiques montrent combien et comment l’intentionnalité du producteur se manifeste ouvertement à l’intérieur de la morphologie de la textualité photographique. Dans de nombreux cas la configuration textuelle témoigne du fait qu’elle est explicitement construite par le photographe à certaines fins. Barthes (1957), par exemple, établit une forte opposition entre les photographies qui montrent une intentionnalité claire et presque insolente du photographe qui veut émouvoir et persuader et celles qui en revanche ne se plient pas à l’intentionnalité rhétorique du photographe et qui apparaissent comme plus libres de codes et de stéréotypes et paradoxalement plus efficaces. Dans ces cas, Barthes explique que l’intentionnalité affectée du photographe se manifeste dans les symétries portées à l’excès et dans l’évidence des stéréotypes ou dans la construction parfaite de la photo qui se veut choquante, tandis que ce sont précisément les photos d’agence, celles qui sont « visuellement diminuées, dépossédées de ce numen que les peintres de composition n’auraient pas manqué de leur ajouter » (Barthes 1957, p. 100) qui nous touchent en profondeur :
Privé à la fois de son chant et de son explication, le naturel de ces images oblige le spectateur à une interrogation violente, l’engage dans une voie d’un jugement qu’il élabore lui-même sans être encombré par la présence démiurgique du photographe (ibidem) ».
Le sémioticien italien Volli (1992) interroge également cette problématique. En s’arrêtant sur la photographie théâtrale, il montre que l’usage future des images – celles destinées aux books des acteurs et celles à usage de la presse – peut orienter fortement la mise en scène photographique :
Payée directement par les journaux, ou par les compagnies comme frais de promotion, la photographie théâtrale est destinée à être reproduite dans une forme ou dans l’autre. Cette destination n’est pas sans conséquences techniques et esthétiques. Sur le plan technique la photo pour les journaux doit pouvoir résister à la manipulation à laquelle elle sera sujette : par exemple à la télétransmission, au tramage, à l’impression sur du papier de mauvaise qualité. Par conséquent, l’image « acceptable » doit être toujours très lisible, privée d’ambiguïtés et de nuances excessives, bien rendue et sans surimpressions ni trop de détails qui pourraient disparaître. Même les formats, la mise en page verticale ou horizontale mais non oblique de l’image sont conditionnés par ce destin médiatique (Volli 1992, p. 120, nous soulignons et traduisons).
Volli explique la configuration textuelle de l’image (« sans trop de détails », privée de nuances, etc.) à partir de l’intentionnalité médiatique, voire des passages auxquels celle-ci devra se soumettre, et montre que toutes les configurations textuelles ne sont pas « bonnes » pour tous les usages communicatifs. D’ailleurs, c’est peut-être l’occasion de rappeler ici que la configuration de l’énonciation énoncée d’une image de reportage peut fonctionner aussi grâce à des dispositifs liés à l’énonciation éditoriale et vice-versa. Beyaert-Geslin (2009) analyse à ce sujet un reportage d’Anthony Suau publié dans le Monde 2 (4 octobre 2008, pp. 34-41) sur la crise des subprimes et ses conséquences pour des Américains modestes de Cleveland et met en évidence le rapport entre le point de vue de la prise photographique et la mise en page de la photo. L’auteure remarque une forte coïncidence du modèle de construction des images et des pages : l’encombrement des pages par des petites images corrobore celui des images qui sont encombrées par des objets. Il y a une correspondance entre l’encombrement d’objets sur l’image et l’accumulation d’images sur la page (elles sont petites, accommodées en enfilade et construites sur le mode de l’exploration, de l’investigation policière presque) et le fait que la grande image qui ouvre le reportage — et qui est focalisée sur un seul personnage, une petite fille qui a perdu sa maison —, est en pleine page. « La stratégie éditoriale procède à la densification d’images déjà saturées tout comme elle dédensifie les images désaturées » (ibidem, p. 36). Beyaert-Geslin remarque aussi que, si dans le cas de la grande image un rapport personnel « je-tu » se développe entre le sujet photographié et l’observateur, donc une ouverture au dialogue intime et à l’introspection de l’observateur, dans le cas des petites images en série règne le profil et un rapport à la troisième personne entre le regardant et le regardé : il s’agit d’une fermeture par rapport au regard intime de l’observateur qui avait été sollicité au début du dossier par la fillette et qui maintenant ne peut que suivre l’action de cette enquête policière. Si d’un côté il règne la suspension du regard intime en pleine page, de l’autre la page paraît se multiplier en une série de frames comme dans un film d’action où c’est l’accélération et la multiplication de points de vue qui construisent une totalité éditoriale fragmentée. Ce cas exemplaire nous montre très clairement que non seulement toutes les configurations textuelles ne sont pas « bonnes » pour tous les usages communicatifs, mais que toutes les configurations textuelles ne sont pas bonnes pour toute mise en page. En outre, l’analyse de l’énonciation éditoriale est une bonne stratégie d’accès pour l’étude de la relation entre image et texte verbal.
3.4.4. Les normes communicationnelles : à partir de Peirce
- Note de bas de page 118 :
-
Cf. Schaeffer (1987, § « Image normée »). Pour une relecture des règles communicatives de type constitutif et normatif cf. Eugeni (1999, pp. 43-44) : « À partir des systèmes activés et des modalités de leur combinaison se greffent les règles (constitutives et normatives) d’approche au texte. Dans ce sens c’est la nature systématique du texte visuel qui émerge : il constitue un système de configurations de savoir, qui convergent vers son dedans et à son extrémité nouent des relations spécifiques et multiples » (ibidem, p. 44, nous traduisons). Nous pourrions donc avancer l’hypothèse qu’un même corpus d’images est en un certain sens « recréé » quand il passe du statut documentaire au statut artistique et vice-versa. Ce qui le recrée ce sont les exigences interprétatives engagées par les diverses pratiques au sein desquelles le corpus se situe. Dans ce sens, vu que l’interprétation s’insère toujours dans une pratique sociale, elle obéit aux objectifs et aux normes définis par cette pratique. Il ne peut donc pas y avoir d’interprétation définitive d’un texte, étant donné que les objectifs et les normes des différentes pratiques définissent les éléments considérés tour à tour comme pertinents par la même textualité : « l’interprétation d’un texte, en effet, change en même temps que les motifs et les conditions de sa description » (Rastier 2001a, p. 192, note 2).
Ce qui distingue l’usage des catégories peirciennes faites par Schaeffer des autres auteurs tels Dubois et Krauss est le fait que pour le théoricien de L’image précaire les fonctions du signe ne décrivent pas des qualités ontologiques des images, mais des configurations interprétatives qui permettent de faire éclater le savoir sur le dispositif génétique dans une myriade de diverses pratiques sociales qui le rendent pertinent de manière à chaque fois différente. Schaeffer illustre, à travers les différentes règles communicationnelles qu’il identifie (normatives, constitutionnelles, etc.)118, les pratiques réceptives qui concernent la photographie dans tous ses champs d’application (reportage, photo de famille, etc.), dans ses statuts (scientifique, artistique, etc.) et dans son rapport avec l’image picturale et numérique. En un certain sens, alors que Floch opposait à l’empreinte (c’est-à-dire à l’ontologisation de la genèse) les formes de l’empreinte, Schaeffer oppose à son tour à l’idéologie de l’indice et de l’icône, le statut indiciel (empreinte photonique) et le statut iconique (vision anthropomorphe) à travers lequel l’image est modulée socialement.
- Note de bas de page 119 :
-
Schaeffer ne consacre que peu de pages (pp. 105-108) à l’expérience personnelle de l’observateur, impossible à maîtriser de façon scientifique. Au contraire, les normes communicationnelles sont liées à des contextes institutionnels spécifiques et donc facilement objectivables.
- Note de bas de page 120 :
-
Voir à ce sujet Beyaert-Geslin (2009).
- Note de bas de page 121 :
-
Pour l’explication de ces notions je m’appuie sur les écrits de Fisette : « un signe est le fait de l’interaction de trois termes […] et qui correspondent au principe des trois grandes catégories phanéroscopiques, suivant leur ordonnancement : le representamen (ou fondement), l’élément premier qui se définit comme une qualité matérielle ; il porte, en quelques sorte, le signe ; deuxièmement la relation du signe à son objet (fonction abrégée sous la dénomination d’objet), ce dernier terme renvoyant autant à un référent qu’à une référence : en fait, il s’agit de l’existant dans le monde qui force le signe à naitre (et donc à parler de lui) et qui simultanément, constitue ce dont parle le signe. L’interprétant désigne une fonction qui agit, d’abord à l’intérieur du signe, assurant la cohésion entre les deux premiers constituants ; puis qui se faisant, confère au signe une valeur de généralité ; enfin agissant à l’extérieur du signe, l’interprétant lance le signe vers sa vie ultérieure pour en marquer la réalisation, suivant un mouvement de sémiose qui, théoriquement, se poursuivra indéfiniment (2004, p. 103).
Face à la difficulté de décrire les pratiques interprétatives de la photographie, Schaeffer est à la recherche des états discontinus au sein du champ tensif tendu entre la valorisation indicielle et la valorisation iconique119, comme apparaît dans le schéma n° 6. Schaeffer vise ainsi à identifier les règles normatives en acte dans la pratique de réception de l’image photographique. Dès que les textes sont saisis « en action » ou sont interprétés selon des contextes de réception différents, les connexions intertextuelles et les pertinences des traits textuels se diffractent. Il n’empêche que la phénoménologie des infinies interprétations locales de chaque compétence individuelle puisse être ramenée à une grammaire culturelle qui informe les différentes sémantisations, constituant un fond qui leur garantit un minimum de commensurabilité. Ces règles de réception normatives guident l’interprétation, voire « délimitent les champs de recevabilité des différentes manières d’aborder une image photographique » (ibidem, p. 109). Dans ce sens, dans une exposition photographique muséale il est peu pertinent de focaliser l’attention sur les degrés de véridicité des objets et des faits représentés, mais on valorise plutôt la composition ; tandis qu’il est normal de prêter attention à l’événement représenté si nous sommes face à des photographies de reportage. Dans ce cas, l’analyse plastique sera également pertinente, mais cette fois non pas pour en valoriser une esthétique du regard mais bien pour évaluer par exemple les valeurs éthiques impliquées120. Ces règles communicationnelles sont décrites sans ambition d’exhaustivité en nombre de huit par Schaeffer, qui tient à préciser que : « l’image, donc le signe dans ses trois faces [objet, representamen et interprétant], ne précède pas la dynamique réceptive, elle est cette dynamique » (ibidem, p. 129, nous soulignons). En effet, l’objet en soi n’existe pas comme donnée originaire qui déterminerait du dehors representamen et interprétant, mais au contraire devient objet à travers le representamen et pour un interprétant121.
La « ligne continue bipolaire tendue entre l’indice et l’icône » (Schaeffer 1987, p. 101) qui décrit les règles communicationnelles de l’image photo-graphique comprise comme « construction réceptive », est présentée dans le schéma de Schaeffer suivant :
Schéma n°6 Schaeffer (1987, p. 72)
Comme on le voit dans le schéma, pour Schaeffer le témoignage se différencie de la description parce qu’il a comme objet non des entités mais des événements. Bien qu’il n’existe de témoignage sans valorisation du fonctionnement indiciel et donc de la thèse d’existence, ce n’est pas la temporalité qui domine dans ce cas, mais la spatialité, c’est-à-dire le statut de l’icône, puisque la narrativisation typique du témoignage est liée davantage à la simulation d’un champ « quasi perceptif » qu’à une datation.
La dénomination de photo-souvenir, par exemple, n’identifie pas pour Schaeffer une classe d’images, mais un point de vue : celui de l’observateur qui, tout en étant spectateur de l’image, est aussi sujet représenté – ou le sont sa famille et ses proches – dans une image qu’il est en train d’observer. La même classe de photographies a pour un étranger en effet le statut de témoignage et rien d’autre. Dans le passage d’un statut à un autre il s’agit d’abandonner le monde privé pour le monde public. Dans le premier cas il s’agit non seulement de recevoir des informations de la photo, mais de pouvoir réactiver une mémoire, personnelle ou familiale. Dans le second cas, celui du témoignage, l’observateur reçoit simplement des informations sur le monde d’autrui. Dans le cas du souvenir, il ne s’agit pas seulement d’un mécanisme de reconnaissance analogique, de superposition de formes qui permettent d’identifier une image-artefact avec une image mentale, sa valeur dérivant plutôt du fait qu’elle soit en relation avec le monde intime et affectif de l’observateur.
Dans le cas du souvenir la tension sur le plan spatial (régime de l’icône) est minime, tandis que sur le plan temporel (régime de l’indice) elle est haute, puisqu’elle creuse l’écart entre l’observation de l’image et la prise de l’empreinte, entre le présent de l’observation et l’impossibilité de réactualiser le moment du déclenchement. Schaeffer (pp. 106-107) affirme aussi qu’il existe pourtant deux types différents de savoir latéral sur les photographies personnelles : celui qui sature les aspects indiciel et iconique, et celui qui concerne en revanche une saturation indicielle accompagnée d’une indétermination partielle de la matérialisation iconique : dans ce second cas, l’image montre l’observateur représenté très différent de comment il se voit ou de comment il s’attendait à être « en photographie ». À ce propos le sémioticien des médias Tore (2006) affirme que la photo-souvenir doit être analysée à partir de la prise de conscience de soi-même de la part de l’observateur et même comme expérimentation de ce qu’il peut avoir été, être, devenir :
le sens pratique de la photo-souvenir n’est pas celui d’“allumer” un souvenir, voire de réaliser un virtuel, faire revenir à ce qui a été. Le sens de la photo souvenir ne se donne pas dans un “ça a été”, mais plutôt dans un “ça, peut-être bien”, voire la potentialité d’un actuel. La photo, dans un certain sens, étend le corps propre du sujet, son actualité, en la rendant variable, en la déclinant, en rendant possible toute une série ouverte de manifestations (ibidem, p. 65, nous traduisons).
Tore poursuit ainsi :
lorsque [l’observateur] fait l’expérience de la photo souvenir, son savoir actuel [sur son propre corps] rentre en concurrence avec celui qui est impliqué dans la photo et il se suspend, à savoir il s’éloigne du processus de stabilisation sémiotique du réel, il se potentialise (ibidem, p. 66, nous traduisons).
- Note de bas de page 122 :
-
Rappelons que le schéma de la p. 72 est revisité et « tensivisé » davantage dans le schéma de la p. 139.
- Note de bas de page 123 :
-
Sur la relation entre description et narration dans l’image photographique et la relation entre image et récit voir Marion (1997).
Pour revenir aux distinctions et aux polarisations contenues dans L’image précaire – que Schaeffer propose au lecteur d’évaluer et de corriger si nécessaire –122, on peut affirmer que le témoignage est une des fonctions les plus importantes de l’image photographique. Dans le cas du journalisme Schaeffer distingue, outre le témoignage, d’autres modes de fonctionnement de la photographie : présentation et monstration sont différenciées moyennant l’objet représenté (entité ou événement)123 et donc nommées illustration présentative et monstration du « moment décisif ». L’illustration présentative, par rapport à la monstration du moment décisif, fait partie d’un journalisme de réflexion ou de synthèse qui, au lieu de témoigner de faits qui ont à peine eu lieu, reprend des informations déjà publiées et tente d’en offrir une opinion ou une systématisation. Le changement de fonctionnement de l’image dépend aussi du type de texte verbal et dans le cas de l’illustration présentative en un certain sens elle ne se pose plus comme une image générique « nécessaire » et irremplaçable, puisqu’il existe une classe d’images plutôt vaste qui, en l’occurrence, s’offrirait comme « utilisables » voire interchangeables avec l’image ou la série d’images effectivement publiée.
3.5. Entre statut artistique et statut documentaire
Un texte résulte de la création continue de ceux qui le transmettent, tant pour son expression que pour son contenu (Rastier).
On a une double vision de la photographie qui est à chaque fois excessive et erronée. Ou on la prend comme une pure transcription mécanique et exacte du réel : c’est toute la photographie de reportage, ou dans certain cas, la photo de famille ; ce qui évidemment est excessif parce qu’une photographie de reportage implique aussi une élaboration, une idéologie de la prise de vue, de la coupe. Ou bien, à l’autre extrême, comme une sorte de substitution de la peinture ; c’est celle qui s’appelle la photographie d’art et ceci est également un excès, parce qu’il est évident que la photographie n’est pas art au sens classique du terme (Barthes).
- Note de bas de page 124 :
-
Contre une conception ontologique de l’image artistique qui vise à résoudre la question « Qu’est-ce qui est art », il est nécessaire d’alléguer la question provocatrice « Quand est-ce de l’art » (Goodman) qui explique que l’image peut changer de statut selon les pratiques sociales au sein desquelles elle est sémantisée.
Les normes communicationnelles peuvent aussi être entendues comme des pratiques qui se stabilisent en des statuts sociaux permettant de reconnaitre sous quel angle une série des photos a été sémantisée. Partons de la distinction entre pratiques de valorisation documentaire et de valorisation artistique. Certes, la racine de la dichotomie entre photographie artistique et photographie-témoignage remonte au débat sur la photographie inaugurée par Baudelaire et elle est reprise ensuite par tous les théoriciens de la fin du dix-neuvième siècle jusqu’à nos jours (voir Bourdieu 1965 et Floch 1986). Depuis toujours on a distingué entre photographie d’art, c’est-à-dire photographie qui « vaut pour elle-même » et photographie comme moyen, preuve, témoignage de quelque chose d’extérieur à elle124.
À l’encontre des photos de statut artistique, les photographies valorisées comme documents rendent toujours pertinente la question de la véridicité, voire la véridicité apparaît comme préalable de leur valeur comme témoignage de quelque chose qui pourrait avoir une importance pédagogique pour l’observateur et/ou une valence éthique. Ceci rend l’enquête sur la genèse de l’image absolument pertinente pour en comprendre l’efficacité et le rôle social – quoique, comme nous avons remarqué, même dans le photojournalisme l’image peut être construite, reconstruite, re-travaillée et ré-utilisée pour différents objectifs.
Une même image photographique peut passer d’un statut documentaire à un statut artistique ; du reste, les deux statuts ne doivent pas être considérés comme incompatibles ; une photo de dénonciation peut continuer à fonctionner comme témoignage politique même si elle est exposée dans un musée : elle peut garder sa prégnance éthique même à l’intérieur d’une grille interprétative artistique qui rend surtout pertinentes les valeurs plastiques et les jeux méta-linguistiques.
- Note de bas de page 125 :
-
Pour un traitement sémiotique des théories institutionnalistes de l’art, cf. Basso Fossali (2002b).
Certes, nous ne voulons aucunement affirmer que n’importe quel texte puisse passer d’un statut à l’autre et souscrire totalement aux théories institutionnalistes de l’art125, mais plutôt rebondir sur le fait que l’analyse textuelle est nécessaire mais non suffisante pour expliquer la « vie » d’une image, dont il est nécessaire de sonder les pratiques d’appropriation sociale.
- Note de bas de page 126 :
-
Cf. la reproduction dans Frizot (éd. 1994, p. 608).
À ce propos, à partir d’une série de photos du photographe Marc Riboud sur la guerre du Vietnam126, Bernhardt (2001) distingue entre deux types de lectures, ou de valorisation des images : la lecture référentialiste et la lecture « libre ou abstraite ». La lecture référentialiste porterait exclusivement sur l’information événementielle représentée, tandis que la lecture libre prendrait en compte les images au-delà de l’événement représenté, en se concentrant sur les jeux rhétoriques de la composition visuelle. Mais les deux lectures ne sont pas totalement indépendantes, puisque la lecture libre, ou rhétorique, transforme l’interprétabilité de l’événement représenté – ou du moins du point de vue sur l’événement. Bernhardt ne se limite pas à observer que la lecture libre rend pertinentes les formes plastiques de l’image, mais affirme que :
leur véritable signification se produit sur un niveau de notions abstraites […]. On peut donc distinguer deux lectures possibles de la seule et même image de Riboud : un premier niveau où les entités figuratives renvoient à des individus concrets (le soldat et la jeune femme), et un deuxième niveau où les mêmes entités renvoient à des concepts ou entités abstraites […]. À ce dernier niveau de lecture, l’image ne représente plus l’événement, mais exprime une structure sous-jacente à l’événement (Bernhardt 2001, p. 35).
La seconde lecture de l’image est amorcée par la pertinence de l’opposition plastique — qui devient sémantique — entre les deux personnages représentés, le soldat et la jeune femme : « c’est la structure d’opposition dans l’image qui structure alors la lecture de l’événement » (ibidem, p. 36). Le sens de la lecture se serait donc inversé : « si dans le premier cas, l’image est lue et comprise à partir de l’événement, dans le deuxième cas, c’est la structure de l’événement qui est lue et comprise à partir de l’image » (ibidem). Mais quelle relation établir entre ces deux pratiques de lecture et les contraintes textuelles ? Ou encore, toutes les images se prêtent-elles à ces deux lectures, référentielle et « abstraite » ? Les configurations textuelles et les pratiques réceptives sont-elles liées par des règles ou existe-t-il une arbitrarité totale ? Toutes les images se prêtent-elles à être assumées sous un statut artistique, et vice-versa même les images constituées comme exemptes de tout objectif historique ou documentaire peuvent-elles devenir témoignages, ne fût-ce que de leur technique photographique ?
Bernhardt nous offre un autre exemple du passage entre une lecture et l’autre par le biais d’une photographie qui représente les accords de Washington entre Rabin, Arafat et Clinton où c’est la structure triangulaire au sommet de laquelle se trouve Clinton qui nous permet de lire cette image comme le récit d’une paix annoncée – garantie par l’intervention des Etats-Unis (ibidem, pp. 56-57). Comme l’affirme Bernhardt, la construction plastique de cette image, qui représente une rencontre entre politiciens, peut fonctionner comme « image-configuration » — et non seulement comme image référentielle —, c’est-à-dire comme image construite plastiquement de telle façon qu’elle « peut inciter à formuler un jugement à partir duquel on va “lire” un événement historique » (ibidem, p. 58). Bernhardt décrit l’image-configuration comme une image qui a le pouvoir de :
créer une distance par rapport à ce qu’elle représente : même si par ses propres moyens elle ne peut formuler aucune critique explicite, elle pourrait indiquer cette distance par rapport au sujet de sa narration et fournir ainsi une critique tacite, une critique par l’absence d’une affirmation de son message et de son jugement (ibidem, p. 59, nous soulignons).
- Note de bas de page 127 :
-
Cf. Barthes (1957). Dans son analyse d’une photo d’un jeune garçon de couleur en uniforme, occupé à faire le salut français, Barthes voit une image dont la signification conforte l’idéologie colonialiste. La photographie « mythique » produit une confusion entre l’idée d’authenticité liée à la singularité et une interprétation générale et généralisante, qui a donc l’ambition d’imposer une vision du monde comme si c’était une vision naturelle. Mais, plutôt que d’image mythique, il est plus correct de parler dans ce cas de construction mythologique d’une image qui vise à la présenter comme l’unique capable de réassumer une situation à travers sa configuration et d’en donner une explication.
Bernhardt propose ainsi deux types d’interprétation : celle qui considère le photographe comme une singularité et celle qui en revanche le généralise. C’est ce second type d’interprétation que Bernhardt déclare être celui qui se rapproche le plus de la lecture mythologique barthésienne127.
À l’inverse, il faut bien se rappeler qu’une image « intentionnée » comme œuvre d’art peut passer à un statut testimonial et être interprété comme témoignage d’une technique artistique, se dé-généraliser et devenir un document historique singularisant.
- Note de bas de page 128 :
-
Cet ouvrage de 1878 est le premier volume de la série Professional Papers of Engineering Department U.S. Army, 7 vol. et atlas, U.S.Government Printing Office, Washington D.C., 1877-78.
Venons-en maintenant à la confrontation opérée par Krauss (1990) entre une image du photographe Thimothy O’Sullivan (Tufa Dormes, Pyramid Lake, Nevada, 1868) ayant des ambitions esthétiques et une copie lithogra-phique de 1875 de la même photographie pour la publication de l’ouvrage de Clarence King, Systematic Geology128. Si dans la première image les rochers « qui paraissent flotter ou planer, ne sont en fait plus que des formes » (Krauss 1990, p. 38), dans la lithographie « les reflets des rochers dans l’eau ont été soigneusement recréés, rétablissant pesanteur et orientation dans cet espace qui était, dans sa version photographique, baigné par cette vague luminosité que produit le collodion là où il a été exposé trop rapidement » (ibidem, p. 38).
Krauss précise que les différents effets de sens des deux images ne sont pas dus au manque de talent de l’imprimeur, mais appartiennent à deux espaces discursifs et culturels différents. La lithographie appartenant au discours de la géologie, il était nécessaire, à partir de l’image de O’Sullivan, de rétablir les éléments de la description topographique, « enraciner, structurer, redresser le plan des données géologiques de ces dômes de tuf. En étant que formes flottant sur un continuum vertical, elles auraient été inutiles » (ibidem, p. 38). L’hypothèse de Krauss est que l’image artistiquement valorisée, et donc susceptible d’être insérée dans les musées, intériorise, grâce à sa topologie comprimée et privée d’horizon (absence de profondeur, construction graphique), l’espace de l’exposition, le mur ; par contre, l’image topographique – qui reconstruit profondeur et orientation —, s’avère utile pour des repérages scientifiques et industriels (dans ce cas la conquête et l’exploitation de l’Ouest américain). Cet exemple peut être utile pour montrer la façon dont un différent statut de l’image rend pertinent, de cette dernière, différentes configurations et en « infléchit » l’interprétation. Mais cet exemple démontre aussi qu’une image, pour réussir à faire part d’une autre pratique réceptive, doit pouvoir se modifier également au niveau des configurations textuelles.
3.5.1. La sérialité dans la légitimation d’artisticité
- Note de bas de page 129 :
-
Celui qui tente d’articuler la problématique du statut artistique de façon complètement différente est Bourdieu (1965) qui pose la question au niveau de jeux de distinction entre classes sociales. Les images photographiques et leurs pratiques sont lues comme indicateurs sociaux de classe et de caste : la pratique de l’Instamatic, par exemple, agit comme indice social des classes ouvrières, face auquel les autres classes réagissent pour se distinguer. Les classes plus aisées doivent s’abstenir des instantanés à la douzaine du dimanche, ou bien s’identifier avec une autre pratique photographique qui se croit très différente, la pratique artistique : en somme, la photographie artistique existe par rapport à une photographie commune seulement comme prolongement de l’expression des différentes classes sociales. Dans ce sens, la photographie artistique se révélerait seulement un effet sociologique plutôt qu’une réalité esthétique et formelle.
Si nous prenons en compte le statut artistique de l’image photographique, nous devons rappeler que pendant des décennies on s’est demandé quelle était la valeur de l’objet photographié eu égard au statut artistique de l’image photographique129. Picaudé (2001) se demande :
Par opposition aux images faites manuellement, la photographie a ceci de particulier qu’elle appartient aussi bien au monde des choses (en qualité d’indice, trace de la chose) qu’au monde des représentations (imaginaires et signifiants de la culture visuelle). L’ambiguïté ontologique se répercute au niveau perceptif : voir une photographie est-il plus proche du fait de voir la chose photographiée ou du fait de voir une image ? (p. 22).
Comme on l’a déjà remarqué dans l’introduction, l’objet photographié qui en un certain sens « résiste » à l’énonciation photographique est traité par maints théoriciens comme une limite de la photographie pour être considérée sur le modèle d’un art. L’affirmation de Benjamin à ce propos – tandis que la peinture est art de l’exécution, dans la photographie quelque chose reste qui ne se résout pas dans l’art du photographe – est vraiment symptomatique d’une tradition de pensée qui commence par Baudelaire et continue jusqu’à la théorisation contemporaine. Sontag (1973) est du même avis que Benjamin :
Tandis qu’en peinture le travail de l’expert présuppose toujours le rapport organique d’un tableau avec le corpus des œuvres d’un individu dans sa totalité, ainsi qu’avec des écoles et traditions iconographiques, en photographie un vaste corpus d’œuvres d’un individu n’a pas nécessairement une cohérence stylistique interne (Sontag 1973, p. 121, nous traduisons).
À prendre au sérieux les affirmations de Benjamin et Sontag, on en viendrait vraiment à penser que le photographe est esclave de ce qu’il photographie, de ce qui s’offre à sa vision et qu’il est dépourvu de tout pouvoir. Si dans le cas de l’image valorisée comme témoignage le problème se pose de façon somme toute moins urgente, dans le cas de la valorisation artistique de l’image le problème se fait plus délicat. Même Schaeffer affronte la question des limites que l’objet « disponible à la prise » pose à la liberté du photographe et à la légitimation d’artisticité. Le caractère constructif de la photographie
est déstabilisé ou fragilisé, dans la mesure où il est toujours transposable en un moment d’espace-temps réel : la construction est référée à un choix, à une sélection parmi les possibilités d’enregistrement qui sont préétablies par l’espace « réel » correspondant (Schaeffer 1987, pp. 118-119).
C’est en ce sens que l’espace photographique se différencie de l’espace pictural :
L’espace imagé photographique apparaît toujours comme un espace matériellement contraint, alors que l’espace pictural est libre, c’est-à-dire soumis uniquement aux contraintes idéelles des règles culturelles. Bien entendu, l’organisation de l’espace photographique fait aussi intervenir des règles culturelles, mais celles-ci restent toujours liées aux contraintes de l’espace matériel : on peut choisir parmi les contraintes, mais on ne saurait s’en affranchir, puisqu’elles définissent le champ des choix possibles (ibidem, p. 119).
- Note de bas de page 130 :
-
Nous pensons aussi aux cas d’automatisation et de motorisation de la genèse de l’image où la rapidité de la succession des déclenchements fait parler d’« image heureuse ».
Même pour Schaeffer il est difficile de distinguer entre ce qui dérive de la construction énonciative de l’image et ce qui « appartient au réel » : « Comment distinguer, par exemple, dans les merveilleuses photos botaniques de Blossfeldt, ce qui appartient à la prise de vue et ce qui appartient à la richesse de la nature ? » (ibidem, p. 159). En outre, nous rappelle Schaeffer, très souvent les images appréciables sont construites à l’aide du hasard130, ce qui démontre l’importance de la disponibilité de l’imprégnant.
Quelle est donc la part de l’objet (objet trouvé) qui se présente dans le lieu, qui « sollicite » le photographe et, d’autre part, celle de la prise d’image ? Une question de ce genre n’existe guère en peinture. Pensons à Canaletto et à ses vues de Venise : personne ne pourrait attribuer à la seule beauté de Venise la plénitude esthétique des paysages de Canaletto. Quelles sont donc les frontières entre la plénitude sensible que l’énonciation photo-graphique offre au sujet représenté et celle que le sujet représenté offre à la photo ?
Schaeffer, face à la question de « combien compte l’objet imprégnant par rapport à l’artisticité de l’image », propose de distinguer entre l’œuvre photographique et, par exemple, l’œuvre littéraire : tandis que dans le second cas on peut parler d’œuvre d’un grand écrivain même face à la production d’un seul livre, une seule image photographique réussie ne suffit pas à qualifier un photographe de grand photographe, ou d’artiste. Schaeffer affirme :
Pour accepter de voir dans une image isolée le résultat d’un talent photographique spécifique, nous attendons de pouvoir la mettre en parallèle avec toute une série d’images du même photographe. Il y a donc dissociation entre le jugement de goût porté sur les qualités d’une image individuelle et la notion d’“œuvre” en tant que référable à un talent régulier (Schaeffer 1987, p. 160, nous soulignons).
- Note de bas de page 131 :
-
À propos des concepts d’artiste et d’œuvre dans le domaine photographique, cf. les intéressantes réflexions de Krauss sur les photographies d’Atget qui ont posé beaucoup de questions à ses interprètes et qui ont soulevé la question de la quantité des prises photographiques dans le choix de paramètres de la légitimation d’artisticité : comment 10,000 prises photographiques très inégales peuvent constituer une œuvre d’artiste de caractère homogène ? Comment justifier l’assomption artistique de ces prises par certains mouvements esthétiques tels que le surréalisme et la Neue Sachlichkeit lorsqu’il s’agit de la production photographique destinée à un catalogue d’images prises sous des commandes institutionnelles ? (1990, pp. 59 sq).
Ce serait alors seulement face à une série de photographies qu’il serait possible d’appliquer la lecture artistique131. C’est à travers l’observation attentive d’une série de photographies qu’on peut découvrir en elles les variantes et les invariants, les différences qui se ressemblent. Cette prise de position met en jeu les invariantes stylistiques d’un photographe : un certain corpus ou une série, en mettant en scène différents sujets, ont la possibilité de démontrer que ce n’est pas le simple représenté qui signifie, mais la praxis énonciative.
S’il est difficile, selon Schaeffer, de mettre en relation une image photographique avec sa tradition, pour distinguer les traits pertinents dans une image photographique il est nécessaire de la doter de pierres de touche : l’analyse d’une série limite à son sens le risque d’arbitraire de jugement. Schaeffer souligne ainsi l’importance de l’étude sérielle :
Non pas parce que l’image individuelle ne « signifierait » que dans la totalité organique de l’œuvre, mais parce que l’accumulation quantitative permet d’éliminer peu à peu les traits non stables, référables aux idéosyncrasies de telle ou telle situation d’empreinte particulière plutôt qu’à des choix figuratifs réfléchis (p. 209, nous soulignons).
Si la question de la série nous semble pouvoir se définir comme une réponse assez satisfaisante au problème du rôle de la photographie à l’intérieur des arts, nous devons rappeler que la question de la « résistance de l’objet » se pose également dans d’autres cas, comme dans celui de la classification des genres. On y reviendra dans les pages suivantes. À présent on poursuivra avec des réflexions portant sur les rapports entre statuts différents.
- Note de bas de page 132 :
-
Je tiens à remercier Thierry Lenain pour avoir attentivement relu les pages qui suivent en améliorant mon texte initial.
3.5.2 Le statut artistique et le statut dévotionnel. Le cas de la photographie à thématique religieuse132
Un cas très particulier de photographie est celle qui vise à représenter des dimensions invisibles de notre vie et notamment la transcendance des valeurs, ainsi que la dimension sacrée de notre existence. Comme on l’a amplement discuté ailleurs (Dondero 2009a), pour étudier la photographie à thématique religieuse il nous faut nécessairement faire référence à la tradition picturale. Comme on l’a déjà expliqué, la thématique religieuse en peinture a pu assumer de droit une valorisation sacrée qui apparaît par contre comme interdite à la photographie artistique contemporaine. Il est couramment admis que tout a été accordé à la peinture, même la représentation de Dieu et de la transcendance ; au contraire, depuis ses origines, la photographie a été reléguée par la doxa à un destin médiatique d’« empreinte du visible et du présent » et à ne pouvoir représenter que l’ici-et-maintenant et elle a été interprétée comme un médium qui ne permet que la reproductibilité et par conséquent que le commerce profane des valeurs. Si le tableau a toujours été pris en compte comme exemplification des arts autographiques (Goodman 1968), où tout trait inscrit sur le support est pertinent pour la signification puisque le support des images autographiques est censé être original — et donc le produit unique et non répétable de la sensori-motricité du producteur— , en revanche les photographies ont été longtemps interprétées comme allographiques, à savoir reproductibles à partir d’une matrice-partition, qui est le négatif : le support d’inscription des formes, dans les différents tirages, ne pouvait donc pas être considéré comme unique et original. Avec le médium photographique, les notions d’original et de faux allaient perdre leur signification pour faire place à la notion de copie et de reproduction. C’est aussi pour cette raison que la photographie a conquis un statut artistique très tard et que pour longtemps la doxa l’a décrite comme un objet médiatique incapable, non seulement de représenter, mais aussi de signifier la transcendance. Mais on voudrait aller ici un peu plus loin et rejoindre nos réflexions du premier chapitre de ce travail en montrant à travers la photographie à thématique religieuse que le fonctionnement du médium peinture et du médium photographie est un peu plus complexe : ce ne sont pas seulement les techniques (sensori-motricité de la peinture vs machinalité de la photographie, unicité sacrale du tableau vs multiplicité des tirages photographiques) qui décident du sens d’un corpus. La possibilité de signifier la transcendance est en fait transversale à une distinction par techniques de production : un statut photographique différent de l’artistique, le statut dévotionnel, peut être mis en relation non pas avec la peinture occidentale des événements religieux mais avec le genre du portrait par excellence, l’icône, et assumer une valence sacrée. Le même médium photo-graphique peut non seulement assumer des significations opposées dans le cas des deux statuts des images photographiques, mais aussi se référer à des modèles iconographiques et culturels complètement différents.
Commençons par la photographie artistique. L’iconographie de la photographie artistique à thématique religieuse s’inspire de l’iconographie picturale de la tradition moderne occidentale. La production photographique récente de certains photographes tels que par exemple Bettina Rheims, Marina Abramovich, Jan Saudek, Pierre & Gilles et bien d’autres met en scène des tableaux vivants qui miment les iconographies de tableaux célèbres de la Renaissance et de la période baroque. Contrairement aux peintures dont elles s’inspirent, les photographies-tableaux vivants apparaissent comme des machinations théâtrales à effet esthétisant, des ostentations et des mises en scène fausses, trompeuses et mensongères, et les sujets représentés comme des imposteurs. Le simple fait qu’une scénographie ait été préparée pour montrer des personnages mis en pose mimant des attitudes stabilisées dans la tradition iconographique, a provoqué la perte de l’effet sacralisant de la scène religieuse. Si, en effet, la thématique religieuse en peinture était a priori en accord avec une signification sacrée, il n’en va pas de même avec la photographie artistique. Cela s’explique par le fait que dans notre culture, une des conceptions du sacré les plus intéressantes couvre le champ sémantique de l’authenticité, du secret et de la grâce entendue comme inconscience, ainsi que l’affirme Gregory Bateson (1991). On peut considérer comme sacré seulement ce qui n’est pas montré avec ostentation, dont on ne fait pas de marketing, qu’on ne peut pas préemballer et, même, dont on ne devrait rien savoir (Bateson et Bateson 1987). Selon cette conception, le sacré, pour se conserver comme tel, ne peut pas être argumenté ni reproduit : voilà pourquoi, quand l’énoncé photographique met en scène une thématique religieuse en faisant prendre la pose à des personnages avec des intentions artistiques et donc commerciales, il perd toute son aura sacrale. Si le sacré, chez Bateson, se veut le domaine d’une communication tacite, non répétable, non commercialisable, et même inconsciente, par contre la photographie artistique à thématique religieuse, en tant que produit d’un geste intentionnellement esthétique, compliqué et machinique, a été interprétée comme une sorte de commerce blasphématoire de l’image des saints et comme la profanation d’une tradition inviolable. La thématique religieuse dans la photographie artistique montre tout son caractère construit, alors que le sacré est quelque chose qu’on ne peut pas construire, ni préparer.
Il est donc possible d’expliquer l’effet de désacralisation de l’iconographie picturale produit par la photo artistique de deux manières : 1) la photographie est un produit de la mise en scène machinique, alors que la peinture est considérée comme produit authentique de la sensori-motricité du corps du peintre, lui aussi sacralisé, surtout à partir de la Renaissance ; 2) si la peinture a été considérée comme produit d’un acte non répétable (unicité du geste sensori-moteur) comme l’est l’expérience du sacré (notamment épiphanique), la photo, avec sa reproductibilité technique et ses multiples tirages, montre justement la dispersion de ce noyau unique et séparé de tout le reste, qui est le sacré.
Mais la même thématique religieuse peut fonctionner de manière très différente sous un statut tel le statut privé de la photographie et qui normalement implique aussi un changement de genre (de la scène collective stéréotypée on passe au portrait) : la transformation du statut et du genre fait fonctionner le médium photographique de manière tout à fait différente. En fait, le statut de la photographie dévotionnelle est à notre avis un exemple important qui vise à démontrer que la genèse à empreinte n’empêche pas la production photographique de signifier quelque chose qui va au-delà du représentable et au-delà de la reproduction d’un ici-et-maintenant.
- Note de bas de page 133 :
-
Pour une analyse des photos des saints qui ont vécu après la découverte et la diffusion du médium photographique, comme le saint de Naples Giuseppe Moscati (1880-1927), voir Dondero (2008a).
- Note de bas de page 134 :
-
Dans d’autres cas, lorsque les images pieuses ne sont pas produites à partir d’une photo, elles dérivent leur configuration figurative et plastique de l’iconographie picturale institutionnalisée des saints, elles ne sont jamais la reproduction exacte d’un tableau célèbre, mais plutôt des imitations de nombreux tableaux célèbres. Dans le cas de la peinture, art autographique par excellence, il n’existe pas un alphabet de signes, et donc aucun trait du tracé du producteur ne peut être écarté comme contingent, et aucune déviation considérée comme non significative. Le fait que, dans les images pieuses, la main des peintres soit dépourvue de ses saillances stylistiques caractérisantes et singularisantes au profit d’une accumulation/soustraction des mains fait que ces petites images sont considérées comme des exemples d’anonymat stylistique. La main de l’artiste perd son individualité, devient un topos et cela pour deux raisons : la première est, banalement, située au niveau de l’objet : c’est la reproduction massive des petites images, donc leur étendue spatiale ; et la deuxième, située au niveau du texte, est que ces images pieuses sont le résultat iconographique de l’addition, fusion ou soustraction de plusieurs mains et styles créateurs différents. Ces images deviennent récurrentes en deux sens : premièrement au niveau de l’objet-image, parce qu’il y a des milliers d’exemplaires d’images pieuses diffusées partout, et deuxièmement au niveau de l’iconographie, parce que la configuration textuelle qui appartenait à la peinture devient une iconographie anonyme, qui a été dépouillée de toute propriété singulière et caractérisante, donc autographique. L’image pieuse est une image qui fait la moyenne à partir des mains de différents artistes et construit un style moyen, une main-moyenne qui devient le prototype contemporain de la médiation impersonnelle qui a toujours témoigné de l’incarnation du divin.
Comme on vient de le dire, si la photographie artistique contemporaine hérite son iconographie de la tradition de la peinture occidentale (scènes religieuses), l’iconographie de la photographie dévotionnelle se rapporte plutôt à la tradition de l’icône (portrait). De manière paradoxale, le fait que la photo dévotionnelle des saints133 soit produite en tant que portrait et par un processus génétique qui assure l’attestation d’une empreinte confirme d’autant plus sa valeur sacrée : la photographie dévotionnelle est énoncée comme si elle témoignait d’un visage enregistré sur la plaque photosensible bien au-delà du vouloir et de la préméditation de l’énonciateur, comme si la photo était sans énonciateur, sans mains et sans intentions. Elle apparaît comme une image non intentionnelle et impersonnelle, ce qui lui garantit une aura d’authenticité et de nécessité ontologique typique de la dimension sacrée. Elle s’affiche comme le produit dérivant de quelque chose de transcendant à l’homme, quelque chose qui lui est supérieur et qui échappe à sa compréhension (et au faire du producteur). Ce quelque chose a déterminé cette présence qui s’est imprimée de manière autonome sur un support témoignant. Si la photographie artistique était interprétée comme une photographie construite et intentionnelle, au contraire les pratiques de sémantisation de la photographie dévotionnelle valorisent le fait que celle-ci, notamment par son cadrage, est construite de façon à montrer la présence enregistrée comme si elle émergeait d’un endroit insaisissable, d’un fond impénétrable. Dans le cas de la photographie artistique, c’était justement la reproductibilité engagée par le dispositif qui empêchait les images d’être interprétées comme des produits authentiques, uniques et sacralisés. Cela pourrait sembler paradoxal, si l’on pense que l’image artistique est toujours unique, et que les images dévotionnelles, en devenant des images pieuses, sont reproduites en une infinité d’exemplaires. Une des raisons de la différence dans les modes de valorisation de ces deux types d’image dépend sans doute du fait qu’on ne peut s’approprier l’image artistique qu’à distance respectueuse, par le seul regard (même si l’on en est le propriétaire en tant que collectionneur), alors que l’image dévotionnelle devient presqu’une relique, voire une image qui se manifeste comme empreinte d’une transcendance lorsque la manipulation de l’utilisateur l’a marquée. D’une certaine manière, on pourrait dire que la photographie artistique circule dans la société avec un statut de textualité à regarder et à apprécier, alors que la photographie dévotionnelle circule en tant qu’objet qu’on peut toucher, manipuler, transformer et que l’on peut s’approprier jusqu’à la faire devenir un objet intime. On pourrait affirmer que la photographie dévotionnelle, contrairement à la photo de statut artistique, ne met pas en scène une thématique et un événement religieux, mais est elle-même au centre d’un événement religieux. En fait, la photo dévotionnelle transformée en image pieuse fonctionne comme une structure de contact entre le fidèle et l’instance transcendante, tout en étant, paradoxalement, une textualité tout à fait anonyme dans son processus d’instanciation. L’anonymat de la main instanciatrice est doublé par le processus d’anonymisation du corps du saint photographié lorsque la photo est transformée graduellement en image graphique, voire justement en image pieuse : de la photo argentique on passe à une photo retouchée et enfin à l’image graphique, voire à l’image pieuse134. Les corps des saints photographiés se défont en des corps de moins en moins caractérisés et de plus en plus stéréotypés, abstraits du présent, jusqu’à devenir des modèles iconographiques qui se soustraient de l’immersion dans leur temps. Cette abstraction du temps est une des caractéristiques dont les supports des pratiques dévotionnelles paraissent avoir besoin. On pourrait dire que la photo dévotionnelle se charge surtout d’une fonction phatique. Ces types d’images n’ont aucun autre objectif que de maintenir une syntonisation avec l’ordre transcendant, elles maintiennent en présence, préparent l’événement possible d’un mot révélateur et construisent une attente. D’une certaine manière, ces images fonctionnent comme des purs média : le fait que les figures représentées dans les images pieuses soient souvent très banalisées montre que ce qui compte est la disponibilité de l’image pieuse elle-même. Les caractéristiques textuelles sont tout à fait insignifiantes parce que le culte vise justement à les utiliser comme médium, à y voir à travers, à les dépasser. C’est justement l’anonymat de l’image pieuse qui lui permet de mobiliser l’œil intérieur qui doit dépasser la banalité du visible : c’est la banalité figurative de l’image pieuse, son éloignement des détails du portrait photographique, qui permet de la dépasser, de ne pas se concentrer sur la textualité indicielle pour justement accéder à quelque chose d’ultérieur. Les images pieuses se caractérisent enfin comme des dispositifs neutres — leur figuration est presque dénuée de saillances. Elles sont des machines paresseuses, comme les définirait Umberto Eco, qui demandent au fidèle de dépasser la banalité du stéréotype et d’accomplir la pratique de médiation : avec l’image pieuse, on n’est pas tant, en fait, le dévot d’un saint que celui d’une pratique de dépassement.
- Note de bas de page 135 :
-
Voir à ce propos Sicard (1998), Mondzain (2002), Belting (2007).
Si les tableaux vivants photographiques citant des iconographies picturales de la tradition apparaissent donc comme des énoncés qui montrent toute la « complication » de la mise en scène et l’effort de l’adéquation à une tradition stabilisée, avec la photo dévotionnelle, qui assure par contre une iconographie « naturelle », le visage du saint semble s’imprimer sur le papier imprégnant sans passer à travers la main et la préméditation de l’homme : dans ce cas, la genèse indicielle valorise une authenticité de l’émergence de la présence. Ce mode d’émergence des formes dans la photo dévotionnelle, lié à une instanciation entendue comme non intentionnelle et donc authentique, nous rappelle une autre émergence de la présence décidemment plus célèbre, celle du corps de Jésus Christ sur le saint suaire. Il faut en fait se rappeler que ce sont les stratégies du renversement du négatif au positif, typiques du fonctionnement à empreinte et du développement photographique, qui ont permis de révéler et faire émerger le corps de Jésus Christ sur le saint suaire, et de mettre en lumière la naturalité de cette empreinte135. En effet, après plusieurs expériences scientifiques sur le saint suaire — qui ont montré que les traces provenaient d’une action « naturelle » non intentionnelle entre le corps et l’étoffe —, est né le mystère de l’image sans médiation, sans auteur, sans mains, en un mot, acheiropoïète. Et le négatif photographique ainsi que le suaire assument le statut d’empreintes non encore développées, encore à révéler. À partir de là, le mécanisme typiquement photographique qui transforme le négatif en positif, à savoir le mécanisme qui permet la révélation, comme dans le cas de la révélation du saint suaire, a été interprété comme quelque chose qui peut parler au nom de la transcendance même.
Nous pouvons remarquer enfin que le statut peut déterminer les différentes valorisations de la genèse photographique et les valeurs pertinentes du médium. Si dans le cas de la photo artistique il y avait une incompatibilité entre effet sacralisant et spécificité de la genèse (intentionnalité de la prise de vue, construction de la pose, etc.), on voit ici que le statut privé-dévotionnel rend pertinent et met en valeur d’autres caractéristiques du même médium photographique, tels l’automatisme du dispositif, le mécanisme physico-chimique, à savoir les processus d’inscription naturelle de développement et de révélation qui deviennent les paradigmes d’une image qui se produit sans mains comme le saint suaire.
Le médium photographique dans le cas du statut dévotionnel change de rôle et de signification par rapport au statut artistique, même si la genèse photographique à empreinte reste la même dans les deux cas : le médium, de lieu de commerce et de reproductibilité dans le statut artistique (tableaux vivants), devient le lieu d’attestation de l’original le plus originel (saint suaire), lorsqu’il est rendu pertinent par le statut dévotionnel, c’est-à-dire le prototype de toutes les empreintes uniques et sacrées (image pieuse).
Enfin, ce qui me paraît intéressant à remarquer à ce propos est que, paradoxalement, si la photographie dévotionnelle, du point de vue de l’instanciation, est une image destinée à être interprétée comme acheiropoïète, au contraire, du point de vue de la réception, elle est censée posséder un fort pouvoir de mise en communication et justement de médiation entre deux niveaux de réalité différents. Il est vrai que l’image dévotionnelle, pour avoir accès au domaine du sacré et non seulement du religieux, doit être considérée comme consécutive à une exécution non humaine et donc interprétée comme une image sans médiation, mais c’est vrai aussi que l’image dévotionnelle utilise son caractère non médié comme garantie de médiation entre le récepteur et un territoire transcendant.
3.5.3. Le statut éthico-politique de la photographie. Le cas du genre du reportage de guerre
Réfléchissons maintenant sur un autre statut que celui artistique, à savoir le statut éthico-politique que je distinguerai du statut simplement documentaire qui n’a pas les mêmes enjeux didactique et éthique et qui comprend différents genres textuels qui partagent tous le questionnement sur les droits de l’homme.
L’ouvrage de Beyaert-Geslin L’image préoccupée, consacrée à la photographie de reportage, est une source précieuse pour pouvoir caractériser et systématiser la question des rapports entre statut éthico-politique et genres. La photographie de reportage, en fait, entendue en tant que macro-genre, fonctionne comme un diagnostic du temps présent en se révélant comme une parole à responsabilité collective. Elle doit être distinguée de la photo de presse parce qu’elle se caractérise comme une pratique professionnelle (la photo de presse inclut aussi les images des amateurs) et parce que, tout en étant une photo à portée collective, choisit l’individu, et notamment l’individu vulnérable, comme sujet d’interrogation ultime (la photo de presse est normalement beaucoup plus détachée des prises de position sur l’humanité et l’individu et elle pourrait être comprise comme macro-genre appartenant au statut documentaire).
En suivant Beyaert-Geslin (2009), on pourrait affirmer que la photo de reportage soulève deux questions fondamentales en sémiotique : la question du temps, et celle du corps, à savoir de l’authenticité de la prise de vue et, par conséquent, de l’éthique.
Commençons par la question du temps. Elle ne concerne pas seulement le fait que la photographie de reportage se présente comme la photographie la plus engagée par rapport à notre prise de conscience du présent – elle sert à ne pas faire passer le temps, à mettre le temps présent en présence car elle demande une réaction à l’homme en tant que sujet politique et en tant que sujet vulnérable – mais elle construit aussi un rapport très particulier au temps de la pratique photographique elle-même. Elle permet, en fait, de s’interroger sur comment un accident, une contingence ou une occasion peuvent se constituer en événement : c’est justement la photographie qui fixe un ensemble flottant de pratiques concurrentielles ou seulement possibles en une nécessité. Cette nécessité c’est justement la photo qui la construit – s’il y a photo, il y a événement – mais l’événement peut la surprendre aussi : c’est le cas de photos dépaysées par l’événement, voire des photos qui enregistrent quelque chose qui ne pouvait pas être prévu et qui posent au photographe des questionnements éthiques sur son propre travail, sur ce qu’il est censé, ou pas, témoigner.
La pratique de la photo de reportage met le temps au centre de ses préoccupations dans un autre sens aussi. Elle partage avec la forme de vie scientifique un certain nombre de caractéristiques : non seulement elle vise à faire un diagnostic du présent mais elle doit aussi construire « une preuve pour les autres » et elle doit le faire de manière éclatante, éclairante et surtout rapide : le fond agonistique est le même que celui scientifique ainsi que le processus de la recherche et l’élan de la découverte. De cette façon, elle trouve sa forme la plus exemplaire dans le scoop : le scoop est une « course au plus près » (Beyaert-Geslin 2009, p. 72).
- Note de bas de page 136 :
-
Voir à ce propos les corpus analysés par Beyaert-Geslin qui mettent en scène les manifestations dans la place de la République à Paris contre la menace du Front national en 2002 ou les photos d’Anthony Suau qui témoignent des déménagements et de la perte de logement causés par la crise des subprimes aux États-Unis.
Ce que Beyaert-Geslin nomme la photographie de reportage pour nous comprend des genres différents tels la photo de guerre, la photo des événements de crises à implication sociale, souvent à sujet politique136, la photo d’actualité, etc.
- Note de bas de page 137 :
-
À ce propos voir Beyaert-Geslin (ibidem, pp. 154-159) sur les corpus de reportage de guerre de Robert Capa et Lee Miller.
La photographie de reportage de guerre est celle qui le mieux manifeste les considérations générales de la photographie de statut éthico-politique : c’est la photo du passé immédiat, un passé sur lequel on peut non seulement faire du diagnostic, mais intervenir. Elle vise à mettre sous les yeux de l’observateur les dissonances cognitives et esthésiques qui constituent l’événement et l’urgence d’une réaction de notre part (ce qui n’est pas le cas, pour Beyaert-Geslin, de la photo de statut documentaire qui s’efforce de révéler les continuités isotopiques de notre histoire passée et présente). Ce type de reportage de guerre qui saisit le feu de l’événement est à distinguer de la « photographie d’actualité » car elle décrit des situations de la vie quotidienne où la guerre est « toujours le fond – au sens figuratif ou au sens de la causalité – d’une scène de vie quotidienne organisée autour de personnages significatifs » (ibidem, p. 156)137. Bref, c’est une photo qui n’appelle pas l’observateur à intervenir dans l’immédiat de ses choix politiques ou civiques.
Le genre du reportage de guerre peut être considéré comme un genre en soi, même si les configurations visuelles peuvent être très diverses les unes des autres. Ce qui rend homogène ce genre est la thématique de la guerre mais aussi le fait que c’est une photographie qui met en scène la douleur du sujet représenté et symétriquement, l’effort du reporteur pour le saisir de la manière la plus authentique possible. Ce genre de photo met aussi l’observateur dans une position très précise : celle d’un sujet vulnérable en tant qu’homme et tant que sujet politique.
3.5.3.1 Le reportage de guerre et les corps éthiques
Comme l’affirme Beyaert-Geslin (2009) les corpus visuels appartenant au reportage de guerre mettent en jeu le corps du photographe, du sujet photographié et de l’observateur de manière très particulière : de manière très différent que dans le domaine de l’art, l’observateur se retrouve à découvrir que la prise de vue ainsi que les positionnements du corps et la direction des regards posent un questionnement éthique. Quelle est la bonne distance que le photographe doit garder vis-à-vis de ses sujets, surtout lorsqu’il s’agit de sujets souffrants ? Doit-il se tenir le plus près possible pour saisir tous les détails du drame, ou bien doit-il prendre un recul pudique devant la douleur des autres ? Où se trouvent les limites entre le très près et le trop près ? Quand l’auteur du scoop devient-il un paparazzi ? Comme l’observe Beyaert-Geslin le reportage de guerre pose le dilemme entre la proximité déontologique du photographe en tant que professionnel et le retrait pudique du photographe en tant qu’homme interrogé par des questions éthiques. Comment pouvoir concilier l’implication professionnelle et la délicatesse de l’homme ? Et encore, comment est-il possible de construire une image de reportage qui soit le plus authentique, sincère, touchante possible et qui refuse en même temps l’idéologie, la manière et le stéréotype ?
Pour répondre à cette question, il faut voir de plus près quelles sont les typologies textuelles de ce genre de photo. Ce qui devrait normalement témoigner de l’authenticité concerne en premier abord la distance corporelle témoignée par la topologie visuelle, mais aussi les soi-disant « preuves plastiques » de la difficulté de la prise de vue. Dans les photos bien connues de Robert Capa de la guerre espagnole par exemple la dangerosité de la scène est signifiée par une sous-information figurative qui est balancée par une surinformation plastique. Le plan de l’expression livre une textualité appauvrie où les détails de l’événement sont oblitérés, mais en même temps l’empreinte corporelle de l’énonciateur qui investit le plan de l’expression compense cet appauvrissement : son corps en danger, très près du danger, fonctionne comme une surinformation sous forme des grains texturaux et de formes floues à effet disparaissant ; il s’agit d’une surinformation provenant directement de sa chair et de sa vie risquées afin de témoigner. Le monde et l’événement photographiés sont représentés tels des obstacles à l’énonciation photographique, « qui cède pourtant sous la pression du corps » (ibidem, p. 88). Le « frottement » entre la prise de vue et le monde qui ne veut pas se faire saisir est témoigné par les formes floues de l’image et signifie la transformation du voir du photographe en éprouver avec tout son corps, avec son histoire de vie, avec son destin aussi. Beyaert-Geslin se demande si ces photographies peuvent être entendues comme des autoportraits d’une vie mise au service d’une cause collective ou s’il peut s’agir plutôt d’une construction préméditée du photographe ou du produit de retouches post-factum qui ne visent qu’à être persuasifs sans pour autant s’appuyer sur un véritable sacrifice. Pour répondre à cette question, Beyaert-Geslin identifie trois instances de la pratique du reportage : la pose et la citation d’iconographies picturales comme expression d’une préméditation invalidant le régime éthique de la photographie d’une part, et la blessure du corps du photographe comme négation de la préméditation, de l’autre.
1. Partons avec la question de la pose qui nie toujours l’effet de naturel typique de l’effet de vérité lié à l’instantanéité, cette dernière étant concevable comme « une synchronisation de la pratique [photographique] avec le corps du sujet et avec le monde » (ibidem, p. 105). La pose construit toujours un effet de sens de manière, programmation et desynchronisation du corps du sujet du monde. Le sujet photographié au regard embrayé apparaît ainsi comme un complice de la théâtralisation de l’action mise en scène par le photographe. Si la pose apparaît comme la négation de l’élan sacrificiel du photoreporter et de la spontanéité de la prise de vue jusqu’à en nier la conduite éthique, Beyaert-Geslin nous fait apercevoir aussi que certaines images sans pose soulèvent au contraire le problème d’un sujet photographié qui n’a pas été libre de choisir de se faire photographier ou pas. En fait, le sujet qui ne pose pas est passivisé par le vouloir du photographe qui décide de le prendre en photo sans que le modèle puisse décider quoi que ce soit : il est doublement passivé autant par l’événement que par le corps choisissant et agissant du photographe. Si donc l’image avec pose se donne à voir comme une fiction qui nierait en principe les temporalités pertinentes à la pratique du reportage, l’image sans pose pourrait en revanche révéler le pouvoir de manipulation du photographe sur le modèle qui réduirait ce dernier à un objet : dans ce cas le sujet photographié reste à l’insu de la prise de vue et le photographe pourrait se révéler comme un traître. Certes, Beyaert-Geslin n’oublie pas de remarquer que même avec un sujet absorbé dans l’action on ne peut pas vérifier si cet absorbement n’est pas une pose elle aussi et qu’il n’y ait pas également de mise en scène de cette naturalité.
2. Dans le cas de la citation d’iconographies picturales, on est à nouveau face à un arrangement plastique qui pourrait invalider l’authenticité éthique à cause de sa trop facile reconnaissance figurative : il s’agit de poses qui miment des configurations corporelles et spatiales appartenant aux modèles de la peinture religieuse ou d’histoire. C’est vrai que ces modèles construisent une lisibilité de la photo grâce à cet argument d’autorité qui est la peinture ancienne, mais cette comparaison entre le drame actuel et le drame ancien révèle tout son caractère idéologique et nous met face à des valeurs préétablies qui écrasent toutes les particularités du drame présent en imposant une « vérité exemplaire » qui est en contraste avec une « vérité authentique ». Une fois de plus tout ce qui est figé, par la pose ou par un modèle iconographique connu, ne permet pas à la photo de se manifester comme message sincère et authentique d’un présent qui nous préoccupe ici-et-maintenant ; c’est pour cela que, comme l’indique Beyaert-Geslin, l’esthétisation est un risque que l’image de reportage ne peut pas courir et notamment pas l’image qui met en scène des drames : seules les événements heureux peuvent être acceptés comme esthétisants, les tragiques ne supportent pas le peaufinement des formes. Comme on l’a vu précédemment avec les exemples des photographies tableaux-vivants, l’esthétisation porte avec elle un effet de manipulation qui pourrait toujours ressortir comme effet de sens non voulu de l’image de reportage… c’est pour cela que l’auteure voit comme seule solution possible une photo qui « s’affranchit de son énonciateur et semble procéder d’une énonciation collective » (p. 78), bref une image sans intention aucune, le produit d’« une énonciation par laquelle le monde s’énoncerait seul, [le produit de l’] ingénuité d’une “machine enregistreuse” corporelle » (p. 145). Une photo de ce genre pourtant ne peut pas exister — s’il y a photo il y a intention humaine et donc manipulation… — à moins de concevoir une image photographique qui soit acheiropoïètes, encore une fois sur le modèle du saint suaire…
3. La troisième instance de l’authenticité, qui est peut-être la seule qui puisse être considérée comme la preuve véritable d’un engagement éthique de la part du photographe, concerne le sacrifice corporel de ce dernier. C’est le corps blessé du photographe qui aurait le pouvoir d’incarner et signer l’authenticité de la photo de reportage. Le corps blessé du photographe devient ainsi la seule surface d’inscription de l’événement qui puisse relever d’une prise authentique, mais de cette façon la textualité de l’image perd toute son inhérence. Dans ce cas aussi, comme remarqué auparavant, en tant qu’interprètes des photos, on ne peut que parier sur ces dernières sans jamais arriver à mettre le mot fin sur la sincérité des images. Avec ce cas extrême on a vu comment dans certains genres d’images la pure textualité ne peut rien garantir sur l’authenticité de l’image et il ne nous ne reste que parier sur les effets des textes : ce n’est que le hors-image qui peut nous donner des réponses.
Une autre fois, comme dans le cas de Barthes et de la photographie du Jardin d’Hiver, certaines pratiques peuvent acquérir toute leur valence seulement lorsque le contenu de l’image perd toute sa pertinence, lorsque le texte visuel se tait jusqu’à disparaître.
3.6. Les genres photographiques au musée
Tout peintre a son genre. Un amateur demanda un lion à un peintre de fleurs. « Volontiers, lui répondit l’artiste, mais comptez sur un lion qui ressemble à une rose comme deux gouttes d’eau » (Diderot).
- Note de bas de page 138 :
-
Le débat sur les genres photographiques a occupé ces dernières années tant le monde de l’art que les conservateurs des plus importantes collections photographiques du monde (Bibliothèque Nationale de France à Paris, le Musée des Beaux-arts de Houston, le Musée Victoria et Albert de Londres) et les théoriciens de la photographie français, américains, etc. ; pour preuve, le colloque qui s’est tenu à la Bibliothèque Nationale de France en 1999 intitulé « La confusion des genres en photographie ». Le président de la Bibliothèque Nationale de France, Angremy, dans sa présentation des actes de ce colloque, affirme que la répartition des photographies selon les genres semble encore un critère indispensable et évidemment le premier type de jugement sur l’œuvre, à tel point que la « réflexion esthétique commence souvent par l’identification du genre » (Angremy 2001, p. 7). Le colloque de 1999 se demandait précisément si un critère aussi ancien que celui des genres pouvait encore révéler une efficacité – du moins expositive – même si, tentant de répondre à cette question, on finit bien entendu par toucher la trame des jugements esthétiques. Sur ce point, cf. Schaeffer (1987, chap. « La question de l’art »).
- Note de bas de page 139 :
-
Pour cette raison Schaeffer, dans le texte qui accompagne le catalogue de l’exposition parisienne Portraits, singulier pluriel (1997), affirme qu’organiser une exposition d’art photographique autour d’un genre a encore un sens, puisqu’il n’est pas possible de parler d’« art généralisé » comme le fait Thierry de Duve, entendant par là un art sans genres, pure expression d’une artisticité métaphysique.
Comme on l’a déjà avancé brièvement auparavant, les genres, dans le cas de l’image photographique, ne peuvent être analysés selon la pertinence de l’« objet représenté » ; d’ailleurs le texte ne présente pas de partie localisable qui déclare à quel genre il appartient : le genre est dispersé et diffus à l’intérieur du texte. Comme on vient de le voir avec l’exemple de la photo de reportage, pour comprendre la signification d’une image, nous ne pouvons nous baser seulement sur la classification par genres dérivant de la peinture, puisque la pratique réceptive et le statut très variés des photographies, en se posant comme point de vue sur les différentes textualités, ont le pouvoir de transformer la typologie générique de la tradition picturale. Souvent on a déclaré que les pratiques photographiques déconstruisent les genres traditionnels138. Dans ce débat Schaeffer défend l’importance du niveau d’analyse du genre photographique et explique que le caractère subversif par rapport à la peinture se constitue immédiatement en genre nouveau grâce à la relation avec les genres traditionnels139. La classification par genre nous paraît encore d’une importance vitale, en tout cas comme critère possible de classement et d’exposition, du moins par défaut :
Les pratiques transgénériques tout comme celles de déconstruction générique n’apparaissent jamais comme telles que par rapport aux genres dont elles effacent les frontières ou qu’elles déconstruisent. Dès lors que ces catégories cessent d’être opératoires, le caractère « subversif » ou « transgressif » des écarts disparaît du même coup : ce qui jusque-là était « écart » s’instaure en catégorie générique nouvelle (Schaeffer 2001, p. 17).
En outre, la catégorie de la transgression générique n’est pas véritablement pertinente en photographie : elle a été formulée pour la littérature et la peinture, où l’horizon d’attente du genre que l’œuvre singulière devrait transgresser est interne à l’art littéraire et pictural. Mais en photographie la relation est externe puisqu’elle se joue entre l’art photographique et ses multiples pratiques sociales :
les catégorisations génériques que l’usage artistique de la photographie doit déplacer sont supposées être celles de l’usage non artistique de la photographie ; de même l’horizon d’attente générique serait formé par les catégorisations de ces usages non artistiques (ibidem, p. 18).
Dans ce cas, on glisse de la relation entre l’œuvre individuelle et la tradition à celle entre le domaine artistique et l’expérience non artistique des récepteurs : « Ce qui est en cause ce n’est plus une dynamique artistique mais une relation antagonistique entre l’art et les catégories ayant cours dans notre existence quotidienne » (ibidem, p. 18).
- Note de bas de page 140 :
-
Sur le portrait en peinture et en photographie cf. Beyaert-Geslin (2003). Pour une étude de la photographie comme trace autobiographique voir Méaux et Vray (2004).
- Note de bas de page 141 :
-
Voir à ce propos Le Guern (2010) qui analyse le portrait en relation à sa légende et notamment en relation à une fonction indicielle (la légende précise qu’il s’agit d’un individu précis) et à une fonction iconique (la légende affirme qu’il s’agit du portrait d’un homme sans préciser son identité).
Dans tous les cas, Schaeffer rebondit sur la relation entre genres et fonctionnement social de la photographie. Schaeffer affirme que la fonction d’un portrait, par exemple, dépend de son contexte réceptif plus que des caractéristiques de l’image et Schaeffer (1997) note que d’ailleurs la confusion du genre avec l’objet représenté surgit spécialement dans le cas du portrait140. Mais dans ce cas également il est nécessaire de distinguer entre ses sous-genres et les diverses pratiques : par exemple, dans le cas de la photographie judiciaire et d’identité comme dans le portrait de famille, le sujet photographié dans ses détails identifiants est très important, tandis que dans le cas du portrait saisi comme une œuvre d’art il l’est moins141.
Ainsi, les genres s’affichent soit : 1) à travers une approche qui rend pertinent leur statut social, soit 2) à travers l’objet représenté, soit 3) à travers leur esthétiques au niveau de l’énonciation énoncée. Essayons de voir tout cela de plus près en prenant en examen le cas du musée de la Photographie de Ciniciello Balsamo (Milan) ; les critères d’exposition des collections de photographie nous permettent d’approfondir la recherche sur certaines questions théoriques car le musée photographique est le banc d’essai de la réflexion sur la pratique photographique : le musée, à travers le catalogage, la classification, l’exposition et la disposition spatiale des œuvres, fournit des réponses, même provisoires, aux nœuds théoriques que nous examinons. Plus encore que les expositions personnelles des artistes et les rétrospectives monographiques, les expositions des archives et des fonds, c’est-à-dire des diverses collections d’un musée, permettent d’analyser in situ et en acte la catégorisation et la classification de la photographie contemporaine. Dans ces cas, on part toujours d’une matière plutôt informe, celle des diverses collections provenant de plusieurs cultures, lieux et époques, que l’exposition a en quelque sorte le devoir de faire dialoguer stratégiquement dans la salle d’exposition. Le type d’exposition dans ce musée montre qu’on peut identifier le genre non pas à un certain type d’objets représentés, mais à des praxis énonciatives se fondant sur des relations perceptives : la trouée pour le paysage, la saillie pour la nature morte, la focalisation particularisante pour le portrait, etc. qui sont en rapport avec des statuts et des pratiques réceptives.
Le musée en question a présenté un certain nombre de photos d’un fonds intitulé « Idée de Métropole » en 2002 à la Villa Ghirlanda (siège du musée), dont les images les plus représentatives ne sont pas des paysages métropolitains, mais des portraits de bébés ou d’enfants qui nous regardent dans les yeux et des représentations de différentes variétés de plantes. Les photographes engagés dans ce projet sur la métropole se sont consacrés non tant au genre qui se rapproche le plus du thème choisi, la photographie d’architectures urbaines, le reportage de rue, etc., mais plutôt à des genres qui ne renvoient pas au thème de la ville : le portrait qui singularise un personnage (ou un groupe) en le rendant unique, ou la nature morte qui demande au spectateur un regard de près qui contemple la texture des objets représentés. De cette façon la relation habituelle entre thème et genre est subvertie et c’est précisément cette subversion qui souligne la vitalité du critère de perception et de sémantisation des images à travers les genres.
3.6.1. Les critères de l’exposition muséale
Une des questions certes banales, mais centrales, pour comprendre les sections d’exposition, et non seulement l’histoire critique du médium photographique, est à nouveau la dichotomie entre photographie artistique et photographie documentaire. Dans ce cas, si le fondement de cette dichotomie réside dans les pratiques productives et réceptives auxquelles les photographies sont ramenées, ces différentes pratiques réceptives peuvent rendre pertinente la même textualité à leur façon et construire différents parcours textuels :
Les arpentages topographiques d’Atget sont désormais les premiers paysages de la modernité, l’intention publicitaire n’est plus perceptible dans les célèbres natures mortes de Kertész ou d’Outerbridge et il arrive même qu’on reconnaisse une réelle qualité esthétique aux archives anthropométriques qu’on ira même jusqu’à exposer aux murs des galeries, hors de leur contexte, en tant que portraits… (Angremy 2001, p. 7).
D’ailleurs, nous sommes désormais habitués à nous rendre dans des expositions d’art qui exhibent des photographies de guerre autrefois considérés comme photos d’actualité, périssables, et à rendre pertinentes des isotopies plastiques et des parcours sémantiques que nous n’activerions pas si les photographies nous étaient présentées comme des simples photos de presse. Si même l’âge peut s’ériger en critère artistique, nous nous rendons compte que l’histoire des expositions d’art nous empêche de décider a priori quelle peut être la « qualité » d’une image artistique :
- Note de bas de page 142 :
-
Tout ceci pourrait être contredit par le fait que, par exemple, la recherche métalinguistique des années 1920 a mis en lumière la capacité de la photographie à dépasser son destin d’image transparente ; cette recherche a servi quasi de manifeste d’une artisticité immanente à l’image photographique. Mais de l’autre côté nous savons bien que les expérimentations d’un Veronesi, par exemple, peuvent être sémantisées non seulement par un regard qui les rend pertinentes comme « recherches linguistiques » qui tendent à autonomiser le langage photographique par rapport au modèle, mais aussi comme document d’un faire technique, témoignage d’une pratique productive. Dans ce cas donc, l’image exposée au musée parce que méta-photographique peut être rendue pertinente par des historiens et des sociologues comme documentaire d’une pratique d’instauration qui a transformé la pratique sociale de la vision.
La collection photographique muséale est toujours en partie une collection d’objets trouvés. Les images ne sont pas sélectionnées uniquement en vertu d’un canon esthétique fermement établi, mais tout autant à cause de leur prégnance individuelle, que celle-ci soit due à leur organisation formelle, aux objets empreints, à leur allure (ce « je ne sais quoi » que Barthes qualifiait de punctum) ou simplement à leur âge. Bien sûr, il existe indéniablement une pression institutionnelle qui vise à la constitution de corpus d’images référables à des œuvres individuelles, et cette pression est d’autant plus forte que les images sélectionnées sont récentes. Mais plus on se rapproche des premières décennies de l’histoire de la photographie et plus les critères de sélection se brouillent : à la limite une daguerréotypie peut déjà prétendre au statut muséal, du simple fait qu’elle existe. Autrement dit, l’art photographique en tant qu’institution muséale semble osciller en permanence entre le document et le monument (Schaeffer 1987, p. 158)142.
Mais venons aux critères d’accrochage dans notre musée, qui sont les plus divers : par genre, date, collection de provenance, etc., ce qui montre bien la difficulté de la classification.
1) Un premier critère d’accrochage dans le musée milanais est le critère historico-artistique et pourrait être défini comme valorisant des « recherches linguistiques et des expérimentations linguistiques » ou des « recherches et réflexions méta-textuelles ».
2) Inversement, la classification qui sous-tend les trois murs de la salle d’exposition où l’on peut admirer les paysages métropolitains de Milan pris par les plus grands photographes du monde entier (« Idée de métropole »), est précisément une classification par genres. Tandis que les paysages exposés sur les murs sont de dimensions plutôt imposantes, les images montrées sur les panneaux sont de dimensions plutôt discrètes : elles sont disposées sur des présentoirs spéciaux et miment un mouvement saillant vers l’observateur, un mouvement de « venir à la rencontre ». Au contraire, l’agencement des paysages, pendus aux murs, marque le fonctionnement de percée vers le dehors typique des paysages qui, comme l’affirme l’historien et théoricien de l’art Stoichita (1993), fonctionne comme ouverture « à fenêtre » vers l’horizon. Il existe donc une relation entre les configurations textuelles des images et la façon dont elles sont exposées : nature morte sur le présentoir et paysage au mur.
3) Même la thématique sociale des œuvres est utilisée comme critère d’exposition. En effet, sur un autre panneau de la salle nous trouvons des images qui sont cataloguées sous le nom un peu vague de « photographie sociale » : cette fois nous ne sommes plus face à un critère d’exposition historico-artistique, ni de genre, mais la formule « photographie sociale » devrait rendre pertinente, d’une part, la thématique des œuvres, de l’autre, le statut sous lequel elles circulent dans le social. Si les thématiques des images rassemblées ici sont les plus diverses, le statut documentaire est absorbé dans le statut artistique, non seulement par l’emplacement muséal, mais aussi par la présence de portraits à ambition artistique. Dès lors les images exposées sous la formule « photographie sociale » n’excluent ni les textes expérimentaux, ni les textes à statut artistique, pris par certains des photographes les plus célèbres du monde. La photographie sociale serait-elle simplement une étiquette pour rassembler les images les plus diverses ? Cette étiquette même serait-elle impure, voire privée de toute valeur heuristique théorique ? La notion de photographie sociale nous renverrait à des images qui visent à informer, et que Floch aurait considérées comme appartenant à la photographie référentielle, à même de « restituer la parole du monde ». Si ce type de classement renvoie à une esthétique textuelle de l’image, à l’inverse, l’autre opposition que Floch trace entre valeurs d’usage et valeurs de base investies dans la photo, aborde la photographie comme un « programme narratif dans la vie d’un producteur ou d’un utilisateur » (Floch 1986, p. 19). Dans notre cas, il nous semble que le critère expositif et théorique de « photographie sociale » risque d’être peu heuristique, vu qu’il ne peut pas être considéré comme co-extensif ni de la photographie référentielle, ni de l’attitude documentaire pratiquée par les historiens.
Ce qui nous semble intéressant de remarquer, c’est surtout la nécessité de porter un regard sur le texte photographique qui ne fasse pas abstraction de son histoire productive et réceptive, mais qui en même temps ne se résolve pas en elle ; il paraît nécessaire d’analyser comment les pratiques réceptives parcourent une même image en en focalisant des sens et des directions diverses, qu’il faut mettre en comparaison. Du reste, une fois établi le statut selon lequel on aborde une certaine photographie pour la faire signifier, l’analyse des formes de la textualité reste l’unique mode pour objectiver et contractualiser la validité d’un parcours de sens.
4. Du texte photographique à l’objet-photographie
4.1. Aura et reproductibilité photographique
- Note de bas de page 143 :
-
Pour une brève histoire de l’aura, cf. Grojnowski (2002). Les « aurae » dans le monde gréco-latin, filles d’Eole, sont des incarnations de souffles d’air, d’exhalaisons, d’êtres impalpables, invisiblement présentes. Le terme aura devient synonyme d’effluve vital ; au dix-neuvième siècle et dans les milieux de la médecine et des sciences paranormales, synonyme d’âme.
L’interrogation menée précédemment sur les pratiques réceptives de l’image nous conduit à nous déplacer de la photographie comprise comme textualité à la photographie comprise comme objet, liée aux divers dispositifs présentationnels, tels que des albums photographiques, stéréographiques, des box de musées, des écrans d’ordinateur, etc. Le niveau de l’objet est concevable comme médiateur entre celui du texte et celui de la pratique. Ceci nous amène surtout à nous occuper de la question de l’original, de la reproduction et donc des différents tirages. À ce propos, la théorie benjaminienne de l’aura143 qui rend pertinents, dans la photo ainsi que dans le tableau, les modes de production, et donc la question de l’authenticité, nous permet de problématiser le niveau de la textualité par rapport au niveau de l’objet.
L’aura d’une œuvre d’art, notamment picturale, pour Benjamin (1938) est étroitement liée à l’exemplaire unique original, c’est-à-dire à l’authenticité, cette même authenticité qui est refusée par Benjamin aux images photographiques produites à partir du négatif – considéré comme l’unique original photographique.
Selon Benjamin la reproduction photographique d’une œuvre d’art picturale ou architecturale, par exemple, permet à l’œuvre d’être diffusée et réadaptée à des situations qui ne seraient pas accessibles à l’original même : mais de cette façon se joue une dévaluation de l’hic et nunc de l’œuvre, parce qu’on la transporte dans l’ailleurs et le non-maintenant, en déstabilisant donc son effet de présence et son autorité au sein d’une tradition historique. Ce faisant, de la valeur cultuelle de l’œuvre on passe ainsi à sa valeur profane, culturelle. Dans ces écrits Benjamin rappelle que l’œuvre d’art, avant l’avènement de la modernité, était intégrée, grâce à son unicité, à la tradition religieuse et au culte ; l’objet reproduit, en revanche, se « re-présente cycliquement » et met en échec son positionnement temporel et celui des œuvres qui lui sont liées. Pour Benjamin et sa « théologie esthétique » (Grojsnowski 2002, p. 293) le problème de l’efficacité de l’original se pose en effet surtout en relation au temps et à la tradition : la technique de reproduction soustrait l’œuvre à sa propre mémoire, à la stratification de la tradition parce que, en un certain sens, elle actualise le re-produit à chaque fois que celui-ci se présente sous nous yeux. L’objet original et authentique, au contraire, se caractérise par le fait qu’il est « l’unique apparition d’un lointain, si proche soit-il » (Benjamin 1938, p. 278). Sur la valeur cultuelle Benjamin affirme :
Lointain s’oppose à proche. Ce qui est essentiellement lointain est inapprochable. En effet le caractère inapprochable est l’une des principales caractéristiques de l’image servant au culte. Celle-ci demeure par sa nature un “lointain, si proche soit-il”. La proximité que l’on peut atteindre par rapport à sa réalité matérielle ne porte aucun préjudice au caractère lointain qu’elle conserve une fois apparue (ibidem, note 1, p. 280).
L’aura produit l’apparition du lointain dans le proche, du passé dans le présent, de l’ailleurs dans l’ici, c’est-à-dire réactive l’origine des valeurs dans la dimension du présent. Bref, l’aura présentifie l’origine.
- Note de bas de page 144 :
-
Pour un approfondissement de la question de l’aura sacrée cf. Dondero (2009a).
Plus l’original est dominé par l’unicité et par la durée (dans le sens d’un lointain qui persiste jusqu’à l’ici-et-maintenant), plus la reproduction est caractérisée par le répétable et le périssable. Dans ce cas, nous pourrions même parler de violation produite par la reproductibilité, justifiée par le fait que Benjamin décrive la perte de l’aura comme un « objet dépouillé de sa gaine », c’est-à-dire de quelque chose qui le protège en l’isolant, et qui fonctionne comme une enveloppe qui le scelle et le sépare du monde. Ce sceau auratique doit être pensé comme une zone de séparation, brumeuse et vaporeuse, qui entoure l’objet, tandis que la reproductibilité équivaut à la « perte de l’auréole » et de la « distinction ». Dans ce sens nous pourrions affirmer que l’objet d’art, revêtu de sa gaine sacrée, est une apparition qui se retient lorsqu’elle s’offre à l’observateur, tandis que la reproduction va directement, de façon itérative et ostentatoire, « au devant de celui qui la reçoit » (ibidem). Plus l’objet d’art est replié en lui-même, parce qu’il maintient la trace du geste productif, qui est unique, plus, à l’opposé, l’objet reproduit, privé de sa gaine, se disperse, en se mettant à la merci de tous. Pour Benjamin, l’objet auratique est concentré en soi-même, se réalise dans l’apparition « unique », tandis que le parcours de l’objet reproduit est caractérisé par la diffusion et la pulvérisation de sa valeur. Dans ce sens, dans le système de Benjamin, la propriété sacrée coïnciderait avec une clôture, tandis que la reproduction se traduirait par la dispersion et le morcellement. Il semble décidemment que pour Benjamin, plus l’extension expositive des images augmente, plus on perd la concentration intensive de leur efficacité : « au rapt […] s’oppose la diversion » (ibidem) et on passe ainsi de la contemplation à la distraction, de la concentration sacrée à la dispersion profane. Il n’existe donc pas de possibilité de copier l’aura pour le savant allemand : aura et possibilité de réplique s’excluent réciproquement144.
Les affirmations de Benjamin sur le déclin de l’aura de l’image reproduite et reproductible par rapport à celle produite par la main humaine sont aux antipodes, par exemple, des affirmations de Barthes sur la vivacité de l’image photographique considérée comme plus efficace que l’image picturale dans le rendu de la présence. Pour les théoriciens de la photographie, surtout pour les pragmaticiens, la valeur de l’efficacité de la photographie se trouve exactement à l’opposé de celle décrite par Benjamin : chez Krauss (1990), par exemple, c’est précisément l’indiscernabilité de l’image photographique par rapport à son objet (jusqu’à considérer l’image photographique comme un ready-made), ou le fait que le photographe ait été là comme témoin devant le « photographié », qui crée l’effet auratique, c’est-à-dire la force de présence entre le producteur passé et l’observateur présent que seulement l’image photographique peut engendrer.
4.1.1. L’aura de la patine
Si la théorie de l’aura ne prend pas en compte les configurations énonciatives de la textualité, elle devient pertinente si on étudie la photographie comme objet et comme matérialité qui garde en mémoire les traces de l’acte et du sujet producteur. Du reste, même la photographie hyper-auratique de la mère au Jardin d’Hiver décrite par Barthes (1980) ne doit pas son efficacité au réseau des formes qui la constituent, mais au fait qu’elle soit avant tout un objet matériel sur lequel s’inscrivent les traces du temps. Barthes sémantise la photographie également et surtout comme objet matériel authentifié grâce à une patine acquise à travers le temps : « La photographie était très ancienne. Cartonnée, les coins mâchés, d’un sépia pâli, elle montrait à peine deux jeunes enfants debout » (Barthes 1980, p. 106). La photographie interrogée par Barthes garde les marques de son histoire d’usage, de sa détérioration chimique (« d’un sépia pâli ») et conserve inscrit en elle le fait qu’elle ait été à plusieurs reprises regardée et touchée (cartonnage et coins mâchés). Barthes ne considère pas tant l’aura comme dépendant de sa production, mais plutôt de la « biographie » de l’image, c’est-à-dire des traces de la manipulation de la part des récepteurs. Benjamin, en revanche, envisage la photographie, tout comme le tableau, uniquement quant à sa production et non pas tant quant à son usage et à la patine du temps. Dans ce sens donc, si Benjamin traite l’aura comme une propriété a priori de l’objet (tous les tableaux originaux la possèdent, de même que tous les daguerréotypes, etc.), Barthes envisage l’aura comme patine déposée sur l’objet : dans ce sens, l’aura ne se confond pas avec la généricité de la genèse, mais avec la particularité et l’intimité des pratiques d’utilisation. La photo en tant qu’impression assume dès lors une importance considérable dans la théorisation du champ de la photographie. Une image qui a été « vécue » et manipulée ne possède pas la même aura qu’une image qui vient d’être imprimée. Les styles d’impression évoluent, les encres, les papiers et, surtout, les traces de la stratification du temps : dans le cas de la patine ce n’est pas tant la configuration textuelle qui compte, mais les traces incorporées par l’image témoignant de son vécu.
- Note de bas de page 145 :
-
Sur l’objet-daguerréotype cf. Edward & Hart (dirs 2004).
Les propriétés physiques des images photographiques ont toujours été considérées en sémiotique comme inessentielles par rapport à la signification de l’image, tels des supports neutres. L’anthropologie de l’image en tant qu’objet culturel a par contre rendu pertinent sa matérialité. Comme l’affirment les anthropologues Edwards et Hart (2004a), nous ne devons pas oublier que les caractéristiques matérielles de la photographie influencent les formes de la textualité. En effet, dans le cas du daguerréotype par exemple – qui pour Benjamin, à la différence de l’impression photographique, garde intacte l’aura – les propriétés visuelles de sa surface dépendent directement de sa matérialité. Le daguerréotype, qui se formait sur une surface argentée, était protégé par un verre entouré de laiton, de soie ou de velours, et renfermé dans du bois ou dans de la peau et exhibait une telle combinaison de matériaux qui mettaient l’observateur face à une multiplicité de textures, de couleurs et de types de surfaces. Puisqu’on ne pouvait l’observer que grâce à des lumières particulières (raking light) qui permettaient la visibilité des formes malgré les nombreux reflets de la surface argentée, cet objet demandait à l’observateur d’être manipulé et impliquait donc une expérience tactile : l’étui devait être ouvert avec beaucoup d’adresse et de soin et manipulé jusqu’à ce que la vision émerge de la surface d’argent145. Si l’effet auratique ne dépend pas de la configuration textuelle, la matérialité de l’image modifie néanmoins les formes textuelles : le matériel qui enveloppe la plaque métallique du daguerréotype sur lequel les formes sont imprimées produit un effet-filtre à la vision et module la perception des formes.
4.2. L’aura entre autographie et allographie
Tandis que l’expérience auratique est une expérience réceptive obtenue par le biais d’une relation avec l’hic et nunc de la production, comme cela arrive dans le cas du daguerréotype ou de la peinture, chez Benjamin, on l’a vu, la reproductibilité de l’image photographique cause la perte de l’aura. Ceci signifie-t-il que pour Benjamin la photo prise dans son occurrence unique par un Polaroid, appareil qui s’avère un des plus vulgaires, banals et diffus, pourrait posséder une aura ? Il nous semble que la voie tracée par Benjamin, qui ontologise la genèse des images, soit difficile à suivre. Nous sommes plutôt convaincue que même une image photographique reproductible, un tirage parmi tant d’autres d’un négatif, peut produire un effet auratique : comme l’affirme Sontag (1973), même une photographie d’Atget imprimée sur du papier désormais introuvable possède une aura. En effet :
La vraie différence entre l’aura d’une photographie et celle d’un tableau se situe dans le rapport différent au temps. Les outrages du temps tendent à abîmer les tableaux. Mais une partie de l’intérêt intrinsèque des photographies, et une cause importante de leur valeur esthétique, sont précisément les transformations auxquels le temps les soumet, leur capacité à fuir les intentions de celui qui les a faites, en somme. Après un laps de temps suffisant, nombre de photographies acquièrent une aura (Sontag 1973, p. 122).
- Note de bas de page 146 :
-
Sur le « vintage-print », cf. Willumson 2004. Les tirages vintage sont ceux développés les dix années qui suivent la production du négatif : de cette façon tant le négatif que les tirages sont liés historiquement à la production de l’image qui est considérée comme investie de valeur. Les photos tirées après les dix années, considérées non-vintage, sont bien moins appréciées sur le marché, voire refusées par les musées américains. Ces affirmations s’opposent clairement aux positions de Benjamin : « De la plaque photographique, par exemple, on peut tirer un grand nombre d’épreuves ; il serait absurde de demander laquelle est authentique » (1938, pp. 281-282). A propos de la conservation non seulement du négatif, mais aussi du tirage original et de la relation de l’image à un lieu particulier, cf. Baetens (1994).
- Note de bas de page 147 :
-
Pour ce qui est de la distinction entre arts autographique et allographique, cf. Goodman (1968) qui distingue entre arts autographiques, dont l’authentification est liée à l’histoire productive, et arts allographiques, authentifiables par « l’identité d’épellation » (sameness of spelling).
- Note de bas de page 148 :
-
La notation est une « correspondance exacte quant aux séquences de lettres, aux espacements et aux signes de ponctuation » (Goodman 1968, p. 149) – qui n’existe ni en peinture ni en photographie où manque un alphabet de caractères –, qui existe en revanche pour la littérature et la musique.
En ce qui concerne l’originalité de l’image photographique par rapport à l’image picturale, Sontag distingue entre les copies tirées du négatif original à l’époque de la prise et les générations de tirages ultérieurs du même négatif146. Dans ce sens, Sontag semble affirmer que tant le type de papier que ses techniques de tirage peuvent assurer à la photographie une originalité, parce qu’ils renvoient directement au choix du photographe. Or même au cours d’une durée bien précise on peut tirer le même négatif de différentes manières : c’est pourquoi la photographie mérite d’être considérée, au même titre que la peinture, comme un art autographique147. Pour preuve on peut considérer qu’un développement de négatif totalement différent de celui choisi initialement par le photographe peut être considéré comme un faux, ce qui arrive dans les arts autographiques, mais non dans les arts allographiques. Pensons aux différentes exécutions d’une même partition musicale : elles sont toujours des originaux car il suffit qu’elles suivent de manière correcte la partition. Dans ce sens, le négatif photographique ne fonctionne pas comme partition, parce qu’il n’existe pas de notation pour un négatif et donc la concordance ou non avec l’« identité d’épellation »148 ne s’avère pas pertinente : une image développée selon un choix lumineux et chromatique différent de celui choisi par le photographe est susceptible de devenir un faux de ce même négatif. En outre, si l’image picturale est considérée comme un original grâce au lien avec l’acte de production, nous pouvons affirmer la même chose pour la photographie, étant donné que chaque image, selon des degrés différents, authentifie l’acte producteur. Si en peinture l’original est authentifié moyennant les traces laissées par la main et par la sensori-motricité de l’artiste, en photographie l’authentification s’obtient grâce au choix du « cadrage », qui résulte de la prise de position du corps du photographe, du papier, du calibrage du tirage, du format, de la résolution de l’impression, etc.
- Note de bas de page 149 :
-
Cf. à ce propos Dondero (2006b).
Si nous prenons par contre en compte la théorie du philosophe Nelson Goodman, nous pouvons affirmer que l’image photographique serait qualifiée d’œuvre autographique à objet multiple. Les nombreuses impressions qu’on peut tirer d’un seul négatif (autographique) sont multiples (œuvre allographique à « objets multiples »), mais nous savons bien que les différents tirages peuvent ensuite restituer un seul négatif selon des modalités assez différentes. Cette possibilité s’accommode de la décision fréquente de la part du photographe de choisir une technique et un calibrage du tirage qui remontent à l’original photographique. La photographie est donc un art autographique à objet multiple au sens où l’artiste décide par exemple combien de et quels tirages doivent être considérés comme originaux149.
4.2.1. Les tirages photographiques et l’authenticité
Goodman distingue entre art autographique et art allographique non seulement par le biais de la pertinence du faux, mais également par les différents stades productifs des arts : la peinture, art autographique, possède un seul stade et la musique, allographique, en a deux (partition et exécution). Il existe des exceptions à cette distinction ; ainsi la photographie s’articule en deux moments, celui de la « prise » et celui de son développement, mais ne peut pas être considéré comme un art allographique tout court : il n’existe pas d’identité d’épellation pour le négatif photographique comme il existe en revanche pour la partition musicale. Le négatif photographique, même s’il est fixé une fois pour toutes, n’a pas d’identité d’épellation parce qu’il ne possède pas de système de notation et donc n’a pas le pouvoir de légitimer tous les tirages qui en dérivent, lesquels peuvent tellement différer les uns des autres jusqu’à rendre l’œuvre méconnaissable. En fait, en photographie, toutes les zones de lumière et d’ombre imprimées sur papier sont constitutives, comme en peinture, tandis que nous savons bien qu’en littérature la couleur de l’encre ou le papier sur lequel est imprimé un roman sont des caractéristiques contingentes par rapport au caractère artistique de l’œuvre. En littérature, comme dans le cas de la musique, il existe un système de notation qui peut décider de l’exactitude ou non des exécutions. La photographie est donc, contrairement à la musique mais comme la gravure cette fois, un art autographique dans ses deux étapes. Le fonctionnement du cliché gravé, de la photographie imprimée et du tableau sont comparables : dans les trois cas la certitude de leur authenticité dépend de l’identification de l’objet matériellement produit par l’artiste. Cependant, à la différence de ce que Goodman pense de la gravure où les différents tirages obtenus d’un même cliché sont tous des exemplaires authentiques de l’œuvre – aussi différents qu’ils soient en couleur, en quantité d’encre, en qualité d’impression et en type de papier –, tous les tirages du même négatif ne sont pas des exemplaires authentiques de l’œuvre parce que la diversité d’exposition de l’impression, la qualité du papier, etc. peuvent faire la différence entre un original et un faux, bien qu’ils proviennent d’un même négatif. Mais tant dans le cas de la photographie que dans le cas de la gravure – puisqu’il n’existe pas de systèmes de notation ou de critères de congruence entre un tirage, un cliché ou un négatif – le rapprochement entre deux tirages n’est pas plus probant que celui entre deux tableaux, c’est-à-dire impossible à l’œil nu : il est donc nécessaire de renouer avec l’histoire de la production pour la peinture ou de l’autorisation pour les tirages photographiques. Certes, tous les tirages autorisés par un artiste comme originaux valent comme des exécutions originales, et ceci non pas grâce à la congruence avec un système de notation, mais grâce à la décision de l’artiste.
Il existe en outre d’autres stratégies pour authentifier une photo – à part celle du photographe qui opte pour un tirage et décide d’un format et d’un certain nombre d’exemplaires originaux – : lorsqu’on intervient manuelle-ment sur le négatif ou sur le tirage, on les « autographie » parce qu’on signe la photographie par un geste du corps propre en en renforçant l’authenticité. L’écriture calligraphique sur la photographie permet d’identifier un tirage photographique unique comme le seul auquel on puisse attribuer le statut autographique, mettant quasi de côté le négatif qui, quoique « à l’origine » du texte, ne s’avère ensuite qu’un des passages de la production de l’œuvre. L’écriture calligraphique permet de faire de cette œuvre-là – et seulement de cette œuvre-là – l’unique tirage autorisé par l’énonciateur parce que signé par le geste corporel, et d’exclure tous les autres. Par le truchement de l’écriture les tirages photographiques ne seraient plus de simples occurrences du négatif, mais s’élèveraient au rang d’œuvres autonomes et uniques. L’écriture apposée sur la surface d’une photographie, en tant que mise en valeur calligraphique, convertit le régime d’instanciation (d’autographe multiple à autographe unique), en transformant une seule impression en exemplaire authentique de l’œuvre. L’écriture sur le support photographique est en général une forme d’appropriation de l’image de la part du photographe qui, par le biais du geste scriptural, insère dans l’image photographique obtenue mécaniquement son faire gestuel et sensori-moteur – même si, comme nous le savons bien, le simple faire photographique témoigne déjà de la trace d’un mouvement sensori-moteur, comme dans le cas des photos délibérément « bougées ».
4.3. La photographie comme texte et la photographie comme objet
À partir des réflexions de Benjamin sur l’aura de l’original, la patine de la photographie, et du travail de Goodman, il s’avère nécessaire de mettre en relation le niveau sémiotique de la textualité avec le niveau objectuel de la photographie et, par conséquent, avec les pratiques institutionnelles de conservation, catalogage et exposition muséale. Considérer la photographie comme objet et non seulement comme texte peut expliquer le lien entre textualité et pratiques institutionnelles, à partir des pratiques familiales jusqu’aux pratiques liées aux collections à but documentaire, historique et scientifique des bibliothèques et des archives ainsi qu’aux pratiques d’exposition. Comme l’affirment deux anthropologues de la « matérialité » de l’image photographique :
Si nous éloignons le foyer méthodologique de son contenu, nous pouvons noter que ce n’est pas seulement l’image en tant qu’image qui est le lieu du signifié, mais que ce sont les formes matérielles et présentationnelles et les usages auxquels elles sont sujettes qui ont une fonction centrale pour la photographie en tant qu’objet socialement relevant. On peut aussi remarquer que ces formes matérielles existent en dialogue avec l’image même et que ce dialogue produit les valeurs associatives que les photographies incarnent (Edwards & Hart 2004a, p. 2, nous traduisons).
Si, comme le voulait Floch (1986), nous devons faire la distinction entre l’analyse des photographies et les théories sur la Photographie, il est nécessaire d’impliquer dans ces analyses également leurs supports matériels, ainsi que la trace de l’usage, puisque : « La matérialité traduit le concept abstrait et représentationnel de la photographie en photographies comme objets qui existent dans l’espace et dans le temps » (Edwards & Hart 2004a, p. 2, nous traduisons).
Si chez Floch c’était la lecture plastique de l’image – qui libérait la photographie de la dépendance du référent – qui permettait d’analyser les photographies et de s’éloigner de la Photographie réifiée de la théorie de Dubois (1983), dans ce cas c’est l’étude de la matérialité de l’image qui l’émancipe de l’ontologisation, la matérialité de la photographie étant directement liée à la diversité des pratiques réceptives.
Les caractéristiques matérielles des photographies ont une forte influence sur la façon dont elles sont lues et interprétées, étant donné que différentes formes matérielles déterminent différentes sémantisations et modes d’utilisation. La matérialité de l’image est donc un niveau sémiotique global par rapport au niveau local du texte.
Edwards & Hart (2004a) distinguent trois formes corrélées de matérialité de l’image :
- Note de bas de page 150 :
-
Si on transforme par exemple le support matériel d’un texte photographique (en l’occurrence, une image journalistique format A4 en image cartonnée et accrochée aux murs de la ville) et le statut d’afférence, les stratégies de focalisation, de magnification et de virtualisation de sa morphologie textuelle (support formel) changeront aussi (Fontanille 2005).
-
la « plasticité » de l’image, à savoir son traitement chimique (chemistry), le papier sur lequel elle est imprimée, le type d’encre, etc. ;
-
les « formes présentationnelles » telles par exemple les cartes de visite, les cabinet cards, les albums, les écrans d’ordina-teur, les différents types d’encadrement de l’image photo-graphique150 ;
-
les traces physiques de l’usage et du temps (la patine et l’usure).
- Note de bas de page 151 :
-
Sur la relation entre la photographie, sa configuration textuelle et le livre qui la contient et l’exhibe, cf. les observations de Baetens (1998, pp. 33-34).
D’une part, les formes présentationnelles modalisent le récepteur parce qu’elles se posent comme guide à l’utilisation, mais de l’autre, les traces de l’usage, la patine, transforment ces mêmes formes (voir schéma n° 7). Dans ce sens, nous voyons que les différentes formes de matérialité de la photographie peuvent s’avérer heuristiques pour rendre compte de l’interaction entre le sujet et l’objet, entre les parcours de réception proposés par l’objet (énonciation énoncée), et les voies élues par le sujet, ses manipulations de l’image le long du temps de vision151 (énonciation en acte), de conservation ou d’utilisation.
Schéma n° 7
- Note de bas de page 152 :
-
Edwards & Hart (2004a) parlent de « vision » et de « contenu de l’image » qui se différencie du niveau « présentatif » de l’image.
Comme l’affirment Edwards et Hart (2004a), l’image en tant que « vision »152 (à savoir le niveau du texte) et l’image en tant que « forme présentationnelle » (à savoir le niveau de l’objet) sont toutes deux impliquées par la pratique sociale. Les albums de photographies sont liés tant au niveau du texte qu’au niveau global de la pratique familiale où l’on feuillette l’album dans des occasions particulières, selon des rythmes particuliers, en privé, en groupe, en compagnie d’étrangers, etc. Les niveaux d’analyse doivent être toujours imbriqués : souvent c’est la pratique qui décide de l’interprétation du texte (la pratique de l’observation familiale ne rend pertinents que certains parcours textuels), d’autres fois c’est la forme présentationnelle de la textualité qui peut décider de la pratique, par exemple les grands albums de photographies, posés sur la table, semblent conçus pour une réception collective, tandis que les plus petits, qu’on peut passer d’une main à l’autre, impliquent une vision plus intime et rapprochée. Ainsi s’emboîtent trois niveaux d’énonciation ou présentatifs différents :
-
celui de l’énonciation énoncée du texte photographique,
-
celui présentatif de l’encadrement de la photographie (praxis énoncia-tive de l’objet),
-
celui de la scène prédicative de la pratique (énonciation en acte).
En outre, une photographie, ou un groupe de photographies, sont sujets à des changements de statut, qui accompagnent les changements d’exposition et de classification. L’historien de l’art Willumson, par exemple, conser-vateur de la Section Photographique du Getty Research Institute de Los Angeles, a suivi le trajet de certains albums de famille depuis les mains privées et celles d’antiquaires ou de libraires, jusqu’à celles d’instituts, comme la bibliothèque. L’objet photographique change plusieurs fois de statut pendant ce cheminement : d’objet privé à usage familial, il passe à un usage commercial, jusqu’à assumer un rôle social au sein d’institutions telles des librairies ou des musées, et enfin peut être remis en vente, cette fois sur le marché de l’art. Les différentes pratiques institutionnelles transforment les parcours interprétatifs des textes photographiques (de l’album de famille à contempler dans une salle de séjour, on passe à l’album collectionné par les antiquaires, à celui dans la vitrine de la librairie jusqu’à celui souvent démonté des musées).
Si nous considérons le niveau objectuel comme un niveau de raccord entre le niveau textuel et le niveau des pratiques (Fontanille 2004), nous serions à même non seulement d’analyser le sens des photographies particulières, mais également le fonctionnement des institutions culturelles.
4.3.1. Le cas des D. M. Seaton European Travel Albums
- Note de bas de page 153 :
-
Sur le mode d’insertion des photos et des textes dans les espaces de l’album cf. Willumson (2004, pp. 63-65).
Willumson (2004) affirme que des milliers de photos déclenchées lors d’un voyage ou à l’occasion de mariages ou de rites « de passage » d’une personne ou d’un groupe familier, sont écartées de l’album de famille – celui-ci étant un objet qui sélectionne, met en série et transmet les expériences et les souvenirs153. En revanche, les photos qui sont choisies et insérées dans l’album sont souvent accompagnées de textes écrits à la main qui côtoient les lieux, les personnes et les événements représentés, comme il arrive dans le cas des albums de voyage d’un industriel américain entre 1898 et 1902, D. M. Seaton. Dans ces albums les photographies sont collées et redécoupées de façon à ce que le texte écrit soit facilement intercalable. Souvent elles sont numérotées et mises en relation avec un plan des villes visitées, inséré dans les dernières pages de l’album, sur lequel sont placés les numéros des lieux parcourus qui correspondent aux images. Même les textes des lettres à la famille et des descriptions font allusion à ces numéros : utiliser le plan de cette façon signifie insérer les photos dans le contexte urbain et établir une relation entre l’écrivain et les photographies. Les actes de lecture et de manipulation des D. M. Seaton European Travel Albums sont plutôt complexes puisqu’on passe de l’image photographique au texte écrit à la main et au plan à la fin du volume. À la mort des proches de Seaton l’album change d’espace de réception en devenant un produit « curieux » et bizarre mis aux enchères par la Swann Gallery de New York, qui en signe l’entrée sur le marché et le désigne comme un objet commercial. La Swann Gallery était réputée pour son commerce de livres de collection, d’art en particulier. L’album fut acquis par le Getty Centre de Los Angeles qui englobe tant le Getty Research Institute que le Getty Museum, qui collectionne des photographies. L’album de Seaton n’est cependant pas approprié aux critères de collection du musée, surtout parce que l’état de certaines photos, notamment leurs surfaces, n’était pas comparable à l’aspect immaculé de la photo d’art. Ne se conformant pas aux critères classificatoires et aux standards du musée d’art, ces albums convenaient mieux à ceux de la bibliothèque — entre autre à cause de la relation entre image et texte écrit ainsi que des informations qu’ils contenaient sur l’Europe et l’Amérique au début du 20e siècle. Dans la bibliothèque du Getty Research Institute ces albums, répertoires de mémoire personnelle au départ, sont évalués maintenant comme des « types » représentatifs d’un genre, l’album privé de voyage, et comme une source d’informations visuelles et verbales : ici, en effet, toutes les localités visitées sont annotées et archivées et, qui plus est, l’album sur l’exposition parisienne de 1900 devient le principal document qui nous renseigne sur l’événement de l’époque.
Le parcours des albums démontre donc le rôle stratégique du lieu et de la discipline sous laquelle ces objets sont classés et sémantisés : dans le cas de la bibliothèque et de l’archive historique, le niveau informatif et historique prévaut au détriment d’autres possibles pertinences, comme celle de la disposition stratégique d’image et texte dans la topologie de la page de l’album.
4.3.2. Les cartes stéréographiques et le catalogage. Le cas du Central Pacific Railroad
Les photographies stéréographiques sont produites avec un appareil photographique à deux objectifs qui produit deux images, à deux degrés et demi de distance l’une de l’autre. Les clichés qui en résultent sont très petits (8x8 cm) et pour être observés correctement sont collés sur des cartons (9x18 cm) qui les rendent plus solides. Agencées à l’intérieur du dispositif de vision, le stéréoscope, les deux images se fondent en une vision unique qui produit un effet de profondeur tridimensionnel : la forme matérielle du papier stéréographique construit un effet de « réalité virtuelle » avant la lettre. Malheureusement, pour des contraintes de catalogage, dans les bibliothèques ce fonctionnement ne peut pas être maintenu, de sorte que les deux images, au lieu d’être traitées comme une paire, sont considérées comme des copies, des duplicata. Au lieu d’être utilisées comme des images différentes qui composent une vision tridimensionnelle unique grâce au dispositif stéréoscopique, elles sont considérées comme des images identiques, à regarder comme des photographies normales et ne sont collectionnées, cataloguées et conservées que pour les seules informations qu’elles contiennent. Cette méthode de classification ignore cependant les qualités matérielles des papiers stéréographiques qui à travers le stéréographe réussissent à produire un effet de profondeur ; la bibliothèque, en effet, les utilise comme si c’était des livres, et n’en reconnaît pas les qualités esthétiques et esthésiques.
- Note de bas de page 154 :
-
Les titres du verso du carton sont souvent ignorés dans le catalogage, bien que l’image et son support soient nés comme inséparables. Au début les stéréographies étaient utilisés exclusivement par la compagnie ferroviaire et n’étaient pas commercialisées : pour cette raison, quand ces images passent dans d’autres mains que celles qui les utilisaient pour montrer le succès de la compagnie – et donc solliciter les investissements – ; l’emploi du stéréographe pour visualiser les images ne s’avère plus possible. Par conséquent, même les titres du verso du carton changent selon leur lecteur modèle : un exemple en est que dans le passage des mains privées de la compagnie à leur publicisation et à leur commercialisation en 1868 le logo placé derrière une photo qui émet ces paroles « Photographed and Published for the Central Pacific Railroad » est transformé en « The World as seen in California » : le nouveau public est devenu celui du marché du tourisme.
Willumson (2004) prend en considération une série de stéréographies du Central Pacific Railroad (CPRR) qui, suivant les vicissitudes des compagnies ferroviaires, changea de propriétaires et donc de pratiques d’utilisation. Produites entre 1865 et 1869, les 364 stéréographies ont été montées initialement sur des cartons standards et leur verso portait les titres des images. Au recto des images des numéros sur des petits bouts de papier étaient collés sur les bords : les titres rappelaient les sujets représentés, les localisations géographiques et la distance de la gare d’origine de Sacramento, en Californie154. Dans la bibliothèque moderne les titres placés au verso de l’image sont éliminés, puisque les priorités du catalogage de la bibliothèque concernent surtout le texte visuel. Pour conserver l’effet de tridimensionnalité de l’image produite par le dispositif stéréographique, on aurait dû maintenir les deux images et leur titre. Le dispositif stéréographique exige que les yeux soient bornés par le viseur du stéréoscope : dès que les deux images se fondent et émergent dans le champ visuel, tous les stimuli visuels hors du viseur sont éliminés. Cet encadrement crée un effet de tridimensionnalité parce que l’image remplit le champ visuel entier, contrairement à ce qui arrive normalement quand l’observateur perçoit les limites spatiales de l’image. Dans la vision stéréographique le champ de vision est enveloppé par la tridimensionnalité de la photographie, du numéro et du titre qui sont apposés stratégiquement sur et sous l’image. Puisque les numéros et les titres ne sont pas considérés en dehors de la vision stéréographique, la séquentialité des images de la CPRR est ignorée et celles-ci sont regroupées avec des autres cartes stéréographiques sur la base du sujet représenté. Une série particulière de stéréographies (la séquence de 321 à 325) témoignait des progrès faits par le chemin de fer à travers le désert du Nevada, connu comme les « marches de civilisation » du territoire indien Shoshone : le sens de cet événement fut en partie perdu dans l’acte de catalogage et d’archivage. L’impact originaire de la séquence, qui mettait en lumière la juxtaposition entre les zones primitives et les zones civilisées du chemin de fer, est totalement détruit par le désintérêt pour la sérialité qui était à la base du système de numérotation et de titrage de ces objets. Dans la bibliothèque ces images sont considérées comme au-delà de leur matérialité (et du carton sur lequel étaient collées les photos et apposées les inscriptions), à l’instar des photos dans les livres, et on n’en a rendu pertinent que le thème : « Indiens », « Transports », « Paysage », « Ponts », « Portraits », « Villes ». Tout ceci pour conformer le corpus aux exigences de catalogage de la bibliothèque.
4.3.2.1 La galerie d’art et la négation de la corporéité
La stéréographie doit s’adapter à la bibliothèque dès lors que celle-ci est surtout une institution qui sert de dépôt de données. Le musée d’art est clairement une institution bien différente : il n’est pas seulement un dépôt de collections, mais plutôt un lieu d’exhibition, une vitrine. Si la bibliothèque doit accueillir des objets qui peuvent informer, le musée doit montrer des objets de valeur esthétique.
Pour la stéréographie il a toujours été difficile d’entrer dans les musées surtout parce que la pratique traditionnelle d’exposition favorise les grandes dimensions des clichés et leur encadrement sous verre, tandis que la stéréographie, et les images de très petite dimension, requièrent un contact physique ou en tout cas une relation de proximité. Le musée a toujours privilégié la relation à distance de l’œuvre : comme la corporéité de l’observateur est niée, ainsi est niée la corporéité de l’objet d’art. Dans les rares cas où la stéréographie entre dans les musées, elle est contrainte de « mimer » l’art photographique grand format et des maîtres reconnus à travers des critères esthétiques qui proviennent d’autres formes d’art, comme la peinture. De cette façon l’art de la stéréographie est dénaturé.
- Note de bas de page 155 :
-
Hormis quelques rares stéréographies qu’on pouvait en effet voir à travers le stéréographe, les autres étaient reproduites de façon numérique ou placées sous verre pour supporter la comparaison avec la grandeur monumentale des autres paysages photographiques.
Willumson (2004) étudie aussi une des inclusions les plus innovantes de la stéréographie entre les murs d’un musée : en 1999 s’est tenue au Musée d’Art Moderne de San Francisco une exposition de grands paysages américains, Carleton Watkins : The Art of Perception. Pour présenter les travaux stéréographiques de l’artiste, qui a surtout produit des paysages photographiques, on a utilisé une technique innovante qui visait à leur donner une autonomie par rapport à la production photographique classique de l’artiste ; les stéréographies, placées dans la dernière pièce de l’exposition, ont été transformées en images numériques et montrées sur des écrans d’ordinateur. Cette présentation avait sa raison d’être parce qu’elle permettait la présentation de l’esthétique de la tridimensionnalité, mais excluait totalement le rapport de l’image avec son support, et en outre, dans le passage de la carte stéréographique au numérique, l’écart entre les deux images produites par l’appareil stéréographique à travers les deux objectifs rapprochés disparaissait encore une fois et les deux images différentes étaient présentées encore une fois comme équivalentes – comme il arrivait dans les bibliothèques. Cette stratégie présentationnelle n’illustre pas du tout la stéréographie du dix-neuvième siècle, mais plutôt les critères et les nécessités muséales : l’effet tridimensionnel était reproduit, mais pas l’objet stéréographique et la réception liée à celui-ci155.
Au sein de l’exposition muséale l’œuvre stéréographique de Watkins était marginalisée pour ne pas distraire le visiteur de la contemplation de la production plus « haute » de l’artiste. Des techniques expositives de ce genre visaient surtout à attirer l’attention sur les niveaux jugés plus nobles de l’art photographique et à neutraliser les aspects industriels et commerciaux de celui-ci. En outre, à en croire Willumson, même les albums de photographies gigantesques ont été démontés et exhibés sur le mur comme des images individuelles, ce qui relance le fonctionnement de l’image comme objet isolé, élitaire, finement sélectionné. Si l’album privilégie la connexion « physique » entre images et spectateur, cette relation n’était pas transférable dans les salles muséales où l’objet artistique est sacralisé. Marginaliser le rapport tactile entre observateur et œuvre avait surtout comme objectif de conserver l’objet dans le meilleur état possible bien qu’en même temps cette stratégie refoule toute trace d’usage de l’objet, voire sa patine d’authenticité. Le musée vise en effet à annuler toute trace de l’histoire d’usage de l’objet ; l’objet sans patine du musée est paradoxalement aussi loin que possible des stratégies de production et de conservation de l’aura : sous verre, protégé, isolé, il ne produit aucun effet de contact direct avec la pratique de la production. Du reste, les qualités esthétiques considérées comme nécessaires pour qu’une photographie puisse atteindre la légitimité artistique concernent la bonne conservation de sa surface ; or les bonnes conditions du tirage excluent l’usure et donc la patine. Ces critères d’exposition rompent totalement avec la préservation de l’histoire de l’objet en dépit du fait qu’un des buts du musée devrait être celui de pouvoir témoigner plutôt que d’éluder le passé et la biographie de l’objet.
4.3.3. L’archive et la collection
Tandis que la pratique de l’archivage concerne un ordre des photographies imposé par le temps de la production, une collection dépend d’une logique différente, à savoir de l’organisation et de la sélection du collectionneur. Comme l’affirme Stewart (1984) : « dès que l’objet est complètement libéré de ses origines, il est possible de générer une nouvelle série, pour l’insérer à l’intérieur d’un autre contexte qui est suscité par la sélectivité du conservateur » (p. 152, nous traduisons).
Dans ce sens, ignorantes de la production et du contexte dans lequel une image a été interprétée et utilisée, les collections d’objets individuels deviennent des lieux abstraits. Leur unité et cohérence dérive du propriétaire, c’est-à-dire du collectionneur « qui construit une narration produite par l’“occasion” qui remplace la narration de production » (ibidem, p. 165, nous traduisons). Ce faisant, les photographies perdent leur importance comme ressources historiques, en se retrouvant liées seulement à l’historicité de la collection : l’image est séparée de ses contextes de production et d’utilisation passés, d’autres propriétaires, etc.
Qu’en est-il en revanche de la numérisation des images, numérisation qui dans plusieurs cas pourrait être comprise comme archivage ? Nous savons par ailleurs que nombre de photographies qui ne sont pas numérisées, dont celles qui sont détériorées par le temps, ou produites dans des pays émergents, sont vouées à disparaître.
En tous cas, de nombreuses propriétés de l’objet-photographie risquent d’être perdues : les différentes dimensions sont modifiées en faveur d’une forme standard liée au format des écrans d’ordinateur. En outre, le verso de l’image – sur lequel pouvaient être inscrites la date, la signature ou qui pouvait être annotée par des phrases – n’est quasi jamais numérisé en même temps que le recto. Outre ceci, les photos qui proviennent par exemple de collections ou d’albums – architectures globales au sein desquelles chaque image assumait un rôle par rapport aux autres images ou à la série entière –, sont numérisées une à une comme des images individuelles et donc non liées à une successivité ni à la page qui les contenait. En outre, l’image photographique était une surface qu’on pouvait retoucher manuellement et qu’on pouvait recouvrir d’inscriptions depuis notre sensori-motricité que ce soit par l’écriture, la peinture ou la gravure. Désormais, tout type de retouche passe par l’intermédiaire de programmes conçus expressément pour mimer les gestes sensori-moteurs continus mais qui, agrandis, révèlent leur discontinuité. Outre ceci, l’équilibrage délicat entre qualités physiques et qualités techniques, ou les équilibres de tons, sont en un certain sens standardisés par la qualité et par le spectre tonal prévu par la technologie de visualisation au sein de laquelle elle est englobée.
- Note de bas de page 156 :
-
Cf. Sassoon (2004 en part. p. 198, figure 12.2).
- Note de bas de page 157 :
-
Le fait que dans le cas de la photographie il n’existe pas d’original unique sauf le négatif qui n’est cependant pas identifié comme artefact autonome, nous permet d’affirmer que les nombreux tirages que nous pouvons obtenir d’un négatif acquièrent de l’intérêt au niveau d’une sémiotique des cultures parce qu’ils démontrent que le signifié d’un document photographique ne réside pas seulement dans son « contenu » mais aussi dans le cadre dans lequel il est appelé à fonctionner.
Dans la plupart des sites d’art, par exemple, on n’a accès qu’à l’image isolée, séparée, déliée de sa matérialité culturelle et physique, même s’il existe des sites d’art qui se rapprochent de l’archivage de la culture matérielle – et non de la méthode des collections. Sassoon (2004) cite parmi ces rares sites le John Curtin Prime Ministerial Library qui maintient l’intégrité des objets sélectionnés et construit des liens aux informations contextuelles sur l’objet en reconnaissant à la photographie son statut d’objet historique spécifique : même le verso des images156 est numérisé ainsi que les éventuelles didascalies. Très souvent en outre ce sont des photographies qui proviennent d’un même négatif qui sont numérisées, c’est-à-dire qu’on numérise les originaux multiples – qui changent de sens s’ils sont pratiqués au sein des différentes formes présentationnelles, matérielles et contextuelles. Pour ce site tout objet-photographie, même s’il provient d’un même négatif, est considéré comme un objet autonome à partir de la façon dont il a été sémantisé et encadré durant son histoire et par quel système discursif il a été absorbé157.
Dans le processus de numérisation, mais surtout de visualisation et d’archivage visuel, on risque de perdre l’intégrité écologique de la photographie avec son histoire matérielle. Ce sont donc les institutions culturelles, dont celles qui conservent les images, qui détiennent le pouvoir de transformer et d’encadrer notre compréhension des sources historiques des objets et qui créent le discours à l’intérieur duquel les images sont englobées et auquel elles doivent faire référence. Or ces institutions ont la responsabilité précise, souvent pas reconnue, de préserver la matérialité de l’objet dans le temps.
4.3.4. Sur la conservation de l’objet-photographie et la numérisation
Comme témoignent les exemples sur lesquels nous nous sommes brièvement attardée, le support matériel, les formes présentationnelles et les traces de l’usage sont vraiment essentiels pour comprendre les pratiques d’une image.
Le passage du support papier au support numérique par exemple ne renvoie pas simplement à une transformation des éléments « visuels » de l’image (par exemple à une translittération de tons chromatiques). Comme l’affirme Sassoon (2004), le processus de numérisation implique un processus culturel plus complexe : « La nature de l’objet-photographie et les pratiques institutionnelles qui l’entourent montrent que la traduction du matériel au numérique devient un processus culturel, et non seulement et simplement technologique » (Sassoon 2004, p. 189, nous traduisons).
Il est donc nécessaire de relier le changement de matérialité au changement des pratiques : par exemple, dans le cas de la numérisation, il s’agit de donner un accès facile à l’image, voire de la conserver. Mais il est certes important de nous poser la question de savoir ce que comporte la numérisation par exemple pour quiconque accomplit des recherches anthropologiques, historiques, historico-artistiques, etc. et se base sur des photographies : quelle importance revêt dans ces cas l’original ? Qu’est-ce qui se perd dans la traduction vers le numérique ?
Si la numérisation est surtout une technologie de visualisation, nous devons rappeler qu’il ne s’agit pas de reléguer la question de la traduction au niveau du plan de l’expression sans considérer ce que sa technologisation entraîne au niveau des effets de sens : par exemple, quelles possibilités, pour les photographies artistiques, d’être étudiées en tant qu’objets authentiques ?
- Note de bas de page 158 :
-
Nous pensons par exemple aux gestes qu’on accomplit pour observer un détail d’une photographie produite mécaniquement : nous utilisons une loupe et nous nous déplaçons sur elle en modulant et en équilibrant notre distance par rapport à la loupe et à l’image. Si, en revanche, nous voulons agrandir un détail de l’image numérique, nous devons utiliser un clavier et une souris, mais nous maintenons la même distance par rapport à l’écran d’ordinateur que lorsque nous observons l’image dans sa globalité : dans le cas de l’image numérique la « loupe », activée par une simple commande, devient le délégué de nos mouvements sur l’image.
Comme on vient de le voir, la reproductibilité numérique risque de ne donner accès qu’au texte de l’image et non à l’image en tant qu’objet : la trace de l’usage sur l’objet-photographie est perdue. Si la traduction n’est pas neutre, il est nécessaire de se demander ce qui survit – ou devrait survivre — de la signification inhérente à l’original, et donc au fait qu’elle ne soit pas qu’une image, mais un objet. La photographie numérisée ne peut pas être considérée comme une simple « substitution » de l’objet-photographie. Il est capital donc de relier les différents niveaux sémiotiques de l’image – ses configurations et stratégies énonciatives, le fait qu’elle soit un objet physique manipulable, le fait qu’elle soit sémantisée au sein de situations institutionnelles ou non – si nous voulons analyser les transformations de la forme papier à la forme numérisée. L’image numérique est elle aussi un objet : elle est supportée par un instrument de production (le logiciel) et de visualisation, l’écran, qui devient son support matériel et qui en fait un « objet ». Cet objet est éphémère au sens que l’écran sert d’instrument « momentané » de visualisation de différentes images l’une après l’autre, ou également de plusieurs images simultanément. Ces images peuvent être « manipulées » seulement à travers des programmes spécifiques. Mais l’image numérique est également constituée par un support : le support ne renvoie pas à la technique anthropomorphe avec laquelle l’image a été produite, mais renvoie à la manipulation à travers des instruments de médiation. Même le négatif de la photographie analogique pouvait être considéré comme un instrument de médiation, même si l’image tirée était quelque chose de plus que le résultat d’une stratégie ou d’un dispositif de visualisation. Or l’écran n’est autre qu’un dispositif de visualisation qui est relié à un dispositif de production158.
En outre, les images numériques sont susceptibles de retouches, mais différentes de celles qu’il était possible d’accomplir sur l’objet-photographie papier : dans le numérique les traces de ces élaborations peuvent s’intégrer parfaitement à la texture et à la définition de l’image, en tant qu’élaborations mono-matérielles, et rendre complètement invisible la trace de la modification. Dans le cas de la photographie papier les retouches manuelles étaient totalement reconnaissables en tant que dues au pinceau ou au stylo, à savoir hétéro-matériels. La numérisation homogénéise en quelque sorte les différents types d’image, tant leur dimension et leurs caractéristiques objectuelles, que leurs caractéristiques purement visuelles.
Même l’image numérique est un objet doté d’une épaisseur physique propre grâce au support-écran qui devient une forme présentationnelle – comme les albums photographiques – au sein de laquelle l’image inscrit sa configuration. Ce qui cependant paraît tout à fait impossible c’est l’usage, vu que l’unique usage auquel l’image numérique invite est le fait d’être regardée – et non de surcroît touchée, humée, découpée, pliée, encadrée, etc. Mais les stratégies de visualisation technologique évoluent ; le spectre de couleurs, par exemple, se transformera dans le futur et les possibilités tonales actuelles pourront peut-être assumer un jour une aura liée à la pratique productive actuelle.
Autre question à remarquer est que la pratique de numérisation tend à privilégier les photographies considérées comme « valables » esthétiquement, tandis qu’un destin plus obscur est réservé aux photographies familiales ou au polaroid et aux instantanés. Et encore, les photographies purement documentaires qui, étant moins intéressantes pour le marché numérique, sont rarement numérisées. De sorte que, si d’une part la numérisation est une pratique de documentation qui fournit l’accès démocratique aux images photographiques, de l’autre elle concerne seulement les images considérées comme œuvres d’art et non celles à statut documentaire…
5. Conclusions
- Note de bas de page 159 :
-
Sur cette problématique, cf. Basso Fossali, 2006c, Fontanille 2008.
Un des objectifs de cette étude fut d’enquêter sur le territoire des pratiques photographiques (productives et interprétatives) et de nous mesurer aux choix épistémologiques de la discipline sémiotique de tradition structurale-générative. Pour ce faire, il nous a fallu mettre en tension le paradigme textualiste dans lequel la sémiotique a donné sa contribution la plus décisive au débat interne aux sciences humaines. En convoquant un nombre de contributions théoriques appartenant à des positions épistémologiques et à des approches méthodologiques sensiblement différentes, nous avons cherché à les confronter et à les ramener à un champ de pertinences qui sont celles qui définissent le projet de la sémiotique : placer la signification au centre des processus culturels, éludant ainsi toute prétention de fondement ontologique de connaissances et d’expériences. La nécessité de replacer au sein des examens disciplinaires la réception et les pratiques de production ou de circulation des textes photographiques ne signifie toutefois pas qu’il faille penser les contextes ou les encyclopédies de référence comme dépositaires du sens, mais au contraire qu’il faut les saisir comme le terrain de son inépuisable élaboration intersubjective. Le texte photographique peut ainsi être redécouvert comme point d’articulation de pratiques qui cherchent à en contractualiser le sens dans un cadre de finalités qui en dépendent également. Ceci signifie que sémiotique du texte et sémiotique des pratiques ne peuvent que s’avérer complémentaires159.
- Note de bas de page 160 :
-
A ce propos, cf. Beyaert-Geslin, Dondero, Fontanille (dirs.) 2009.
La théorie du discours greimassien plaçait au second plan l’analyse de la genèse de l’image, puisqu’elle n’accordait aucune prégnance à la tradition et à l’acte productif. Nous avons tenté de remettre en lice l’impensé de cette théorie160, la signifiance de la substance de l’expression et de sa constitution en sondant la notion de syntaxe figurative de Fontanille (2004). Ceci nous a amenée à nous interroger sur les modes où se produisent, se transforment et s’inscrivent les formes (chapitres un et deux) : si, selon Floch, les différentes gestualités instauratives n’étaient pas pertinentes pour l’analyse textuelle, elles recommencent à signifier si on prend en compte une instance énonciative incarnée qui permet de penser les images en relation directe avec la corporéité du producteur et de l’observateur. Étudier l’image photographique à travers les techniques d’inscriptions et les qualités des supports et des apports nous a permis non seulement de rendre à nouveau pertinent l’acte de production de la textualité, mais également d’envisager l’image photographique en tant qu’objet matériel (chapitre quatre). À ce propos on a remis en cause, pour les images à statut artistique, la question tant débattue de l’original, de son efficacité esthésique et donc des arts autographiques et allographiques (Goodman). Dès lors que la question de l’original rend pertinent le support de l’image et l’histoire de son instanciation, il est nécessaire de pouvoir rendre compte de l’aura des images (Benjamin), ainsi que de la stratification des usages, voire la patine. En outre, l’approche de la photographie en tant que support matériel nous a permis de passer au crible les divers statuts de la photographie, tels le statut documentaire, l’éthico-politique et l’artistique (chapitre trois). Nous nous sommes demandé si l’approche épistémologique des pratiques peut se conjuguer avec l’approche de la textualité. Si, en un certain sens, l’approche du texte et de ses stratégies énonciatives vise à construire un modèle des observateurs possibles, l’approche de la pratique module le point de vue textualiste en montrant que les différentes pratiques réceptives (mais dans de nombreux cas également productives) peuvent déterminer différents types possibles de parcours interprétatifs du texte. Selon cette approche, l’image photographique est tour à tour « constituée », analysée et interprétée sous des faisceaux de pertinence différents selon la pratique en cours et le statut auquel elle appartient. Le changement de statut, et donc de stratégies et de traditions interprétatives, est également lié aux changements de support matériel (chapitre quatre) : lorsque, par exemple, des images privées, tels les souvenirs de famille ou de voyage, passent de la forme présentationnelle de l’album à celle de l’archive ou de la collection, elles peuvent assumer une valence de documents historiques. Dans ce sens, l’approche du support matériel du texte photogra-phique nous permet d’évaluer comment la biographie des images est valorisée quand les institutions et les pratiques qui les englobent et les font signifier changent. Dans cette perspective, il est nécessaire d’étudier le rapport du niveau textuel avec le niveau objectuel de la photographie et, par conséquent, avec les pratiques institutionnelles de catalogage, de conservation et d’exposition muséale.
Il s’agit donc de rebrancher la photographie sur un circuit de signification où matériaux, techniques, usages, conceptions mêmes de l’image font office de relais discursifs. Voici alors que à l’hétérogénéité des points de vue épistémologiques dans l’examen de tels relais doit correspondre une géographie de points d’articulation et de détermination réciproque.
Les différentes formes de matérialité de la photographie doivent, d’une part, être ramenées à un scénario de production où elles ne figurent pas seulement comme des effets-résultats, mais comme partie intégrante du processus de transformation du monde ; de l’autre, elles sont saisies comme assumées au sein d’un scénario que Goodman appellerait d’implémentation, c’est-à-dire le cadre des modalités selon lesquelles une société met en circulation et organise la réception des artefacts culturels. L’objectualité de l’image est en effet en relation d’une part avec la textualité, et de l’autre avec la pratique plus ou moins institutionnalisée au sein de laquelle se tisse le sens.