La Visualisation de l�Information.
Auteur : Patrick Poulingeas
Date de mise � jour : 17/02/2004
1. Introduction.
����������� La visualisation de l�information [1] est un ensemble de techniques permettant de repr�senter des donn�es structur�es. Le fait que l�on dispose d�informations sur les donn�es distingue la visualisation de l�information de m�thodes employ�es en statistique o� l�on cherche justement � d�couvrir des relations entre les donn�es. Le but de la visualisation de l�information est de repr�senter de fa�on coh�rente et claire un nombre important de donn�es afin qu�une personne puisse prendre conscience des informations structurelles pr�sentes dans ces donn�es. Pour cela, il faut tenir compte du fait que l�utilisateur peut �tre amen� � manipuler la repr�sentation qu�on lui offre (ce qui implique une visualisation et des interfaces adapt�es).
����������� Deux probl�mes apparaissent alors :
� Le contexte : On doit toujours avoir une vue globale (m�me impr�cise) de la totalit� des donn�es.
� Le focus : On doit pouvoir s�lectionner une donn�e particuli�re.
A titre d�exemple :
����������� Dans l�explorateur de Windows, on a le focus (puisque l�on peut arriver � s�lectionner n�importe quel fichier d�une arborescence d�un disque). Par contre, on perd souvent le contexte (� force de d�velopper la hi�rarchie d�un disque, on ne voit plus la totalit� des r�pertoires situ�s � la racine de celui-ci).
2.
Repr�sentation de graphes et d�arbres.
����������� Les techniques couramment employ�es en visualisation de l�information sont issues de la repr�sentation graphique des graphes. Une structure de graphe est en effet tr�s courante dans des donn�es informatiques. Si la structure se r�duit � un arbre (ce que l�on peut toujours faire en calculant un arbre couvrant de poids minimal � reste � savoir si cette nouvelle organisation de l�information est pertinente), des algorithmes sp�cifiques sont alors utilis�s.
2.1. Repr�sentation de graphes.
����������� La m�thode la plus connue est celle dite de � spring embedding � (appel�e aussi � force-directed method �). Chacun des n�uds du graphe est assimil�e � une masse et chacune des ar�tes � un ressort. Des forces de r�pulsion s�exercent entre les n�uds tandis que des forces d�attraction s�exercent entre les n�uds reli�s par des ar�tes. Au d�part, les n�uds sont r�partis al�atoirement dans un espace 2D ou 3D. L�algorithme fait �voluer les n�uds jusqu�� ce que l�on arrive � un �tat d��quilibre entre les forces. L�objectif est d��viter que des n�uds ou des ar�tes se coupent.
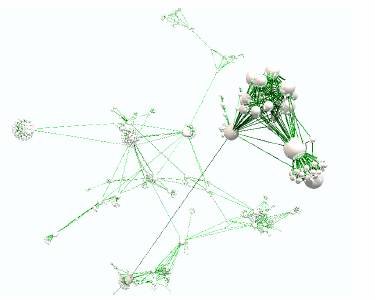
2.2. Repr�sentation d�arbres.
����������� Les deux repr�sentations les plus connues sont :
����������� - les � cones trees � (appel�s � cam trees � quand les c�nes ont un axe horizontal) :
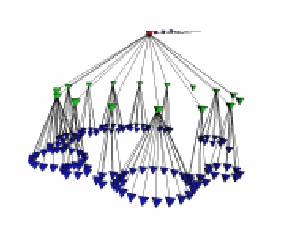
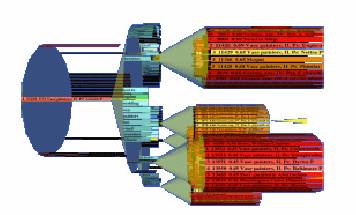
�����������
- les repr�sentations � fish eye � ayant recours � la g�om�trie hyperbolique :
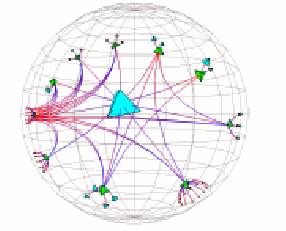
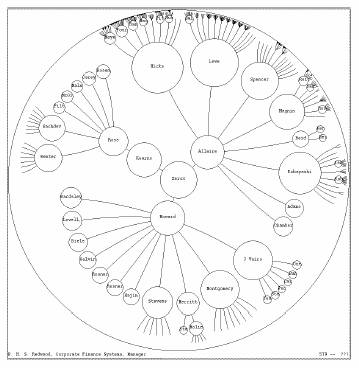
3.
Repr�sentation symbolique.
����������� Dans les algorithmes de � spring embedding �, les n�uds sont simplement repr�sent�s par des boules ou des �tiquettes. Les graphes ont donc souvent un aspect confus d�s que l�on doit g�rer un nombre assez important de n�uds.
����������� Il para�t alors plus int�ressant de repr�senter les informations dans un monde virtuel en �tablissant une bijection entre des donn�es et des entit�s virtuelles. L�aspect final est �videmment plus attrayant. Il est par contre g�n�ralement difficile de garantir le couple focus+contexte (L�utilisateur peut �tre d�sorient� en explorant le monde virtuel).
4.
Applications courantes.
����������� Les algorithmes de � spring embedding � sont souvent employ�s pour visualiser la structure des sites Web. On assimile les pages � des n�uds d�un graphe et les liens hypertextes � des ar�tes. L�inspection du graphe permet de rep�rer des erreurs de conception (Par exemple, un graphe partitionn� en deux gros sous-graphes qui ne sont reli�s que par quelques ar�tes).
����������� Les algorithmes de visualisation d�arbres ont souvent �t� con�us dans le but de faciliter la manipulation des syst�mes de gestion de fichier.
5.
Application dans la visualisation de l�activit� d�un r�seau.
�����������
����������� Les travaux de [2] et [3] ont pour but de repr�senter soit de fa�on symbolique, soit � l�aide des techniques que nous avons �voqu�es l�activit� dans un r�seau (montage de partitions NFS, charge syst�me d�une machine, etc.).

Visualisation de la topologie d�un r�seau � l�aide de � cones trees �.
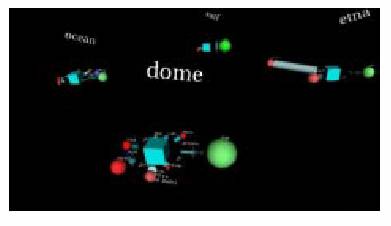
Repr�sentation de l�activit� de diff�rentes stations
sous forme d�un syst�me solaire.
R�f�rences :
[1]������ Ivan
Herman, Member, IEEE CS Society, Guy Melan�on, and M.
Scott Marshall
Graph Visualization
and Navigation in Information Visualization: a Survey
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 2000.
[2] ����� C. Russo Dos Santos, P. Gros, P. Abel, D. Loisel, N. Trichaud (*),
����������� J. P. Paris (**).
Mapping Information onto 3D Virtual Worlds.
(*) Eurecom Institute, B.P. 193. Sophia Antipolis,
France.
(**)CNET
[3]������ P. Abel(*), P.
Gros(*), D. Loisel(*), J.P.
Paris (**)
Network management and virtual reality.
(*) Institut Eur�com, Multimedia Communications Dpt.
(**) CNET France T�l�com.