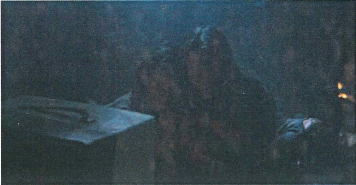En étudiant deux cas de figure très différents l’un de l’autre, on peut voir certaines conditions d’invisibilité des écrans grâce à des déplacements médiatiques et à des jeux de temporalité. Le premier cas est une brève scène marginale de Terminator de James Cameron (1984) qui montre deux fillettes dans l’année 2029 qui sont fascinées par un téléviseur obsolète à l’écran disparu et dans lequel un feu flamboie. Le second cas est une œuvre–promenade de Janet Cardiff, Conspiracy Theory / Théorie du complot (2002), dans laquelle le participant est engagé dans l’expérimentation d’une marche, caméra vidéo en main, donnant ainsi une impression d’écran à la fois présent et débordé par un phénomène de déjà-vu.
By studying two very different scenarios, some of the conditions of screen invisibility are revealed through media movements and temporality-games. The first case is taken out of James Cameron’s Terminator (1984). In the year 2029, two girls are staring at a fire blazing inside an obsolete and broken television. The second case is Janet Cardiff’s Conspiracy Theory / Plot theory (2002). In this audio and video walk, a participant wanders with a hand-held video camera that gives him/her the impression of a present screen which is also extended by a phenomenon of a déjà vu.
1. Introduction
Le fonctionnement habituel des écrans est de disparaître sous les signes qu’ils communiquent. Il est, cependant, toujours possible qu’un support apparaisse et qu’alors, en détournant l’attention sur sa matérialité ou sur son dispositif technique, il fasse écran à la réception des messages. L’expression en elle-même est intéressante : faire écran au sens où l’écran doit non seulement apparaître comme écran, mais bien « se changer » en écran, devenir le résultat de sa propre fabrication. Si l’écran a pour vocation de s’effacer sous les signes qu’il rend visibles, se rendre soi-même visible, pour un écran, implique de faire de sa matérialité et de sa technicité un signe à déchiffrer. Réciproquement, assurer sa non-visibilité devrait aussi restreindre sa lisibilité comme signe. Je voudrais examiner deux cas où l’invisibilité fonctionne néanmoins comme signe. Le premier se trouve dans un bref passage du film de James Cameron, Terminator (1984). Le second est mis en scène dans l’une des « promenades » de l’artiste Janet Cardiff. Deux exemples hétérogènes, comme on le voit. Ils ont l’avantage de présenter deux possibles manières de faire de l’écran quelque chose qui ne fait plus écran. Dans le premier cas, l’écran disparaît par une abolition de sa matérialité au profit du représenté ; dans le second cas, il est invisibilisé par l’expérimentation même qu’on en fait.
2. Pour en finir avec l’écran : un à-côté de Terminator
La meilleure façon de rendre invisible un écran est encore de le supprimer ostensiblement, tout en conservant le dispositif de visibilité dans lequel il était intégré, mais aussi de le déplacer dans le temps et dans d’autres systèmes de médiation.
Ainsi, lorsque Kyle Reese (joué par Michael Biehn), le héros de Terminator, passe en 2029 dans les couloirs souterrains où habitent les humains d’après la catastrophe nucléaire, on le voit en une série de champs/contre-champs observer rapidement un enfant qui joue, un autre qui mange lentement, une femme à l’air épuisé et, enfin, deux petites filles aux cheveux hirsutes et aux visages sales contempler un vieux téléviseur des années soixante. Ce sont en quelque sorte des archives du futur puisque l’action principale du film se passe en 1984 (qui est aussi l’année de sortie du film).
Que vient faire dans ce film un téléviseur aussi manifestement daté ? Il est présent comme signe du passé, marque ostensible d’un recyclage qui doit se contenter des vieilleries obsolètes d’un marché aux puces postnucléaire.
Terminator, James Cameron, 1984
- Note de bas de page 1 :
-
Pour cette analogie des cheveux aux câbles, je renvoie au bel article de Johanne Villeneuve (Villeneuve, 2015).
Or la lumière un peu spectrale qui provient de ce téléviseur n’est pas celle suscitée par l’habituel tube cathodique. Le plan suivant prend position derrière l’une des fillettes dont on voit la masse de cheveux cascader dans le dos comme s’il s’agissait du fouillis de câbles qui devrait encore se trouver dans la boîte-télé1. On discerne en arrière-plan Kyle Reese en train de regarder la fillette et, entre eux, le vieux téléviseur dont l’écran a disparu et qui, en fait, sert seulement de foyer.
Terminator, James Cameron, 1984
Cet épisode s’inscrit dans un moment de repos de l’action. Kyle, le soldat venu depuis l’avenir, et Sarah, la serveuse qui est censée devenir la mère du futur chef de la résistance, sont réfugiés sous un pont. Elle lui demande de lui raconter le monde d’où il vient, provoquant ces soudaines archives du futur. Il lui parle donc de leurs jours cachés dans des souterrains et de leurs nuits où ils partent combattre les machines. Puis les images prennent le relais et nous transportent directement dans le paysage dévasté de 2029. C’est là que nous découvrons les souterrains au sein desquels la caméra circule en suivant Kyle. Souterrains dans lesquels un Terminator s’infiltre parmi les humains : un combat s’engage lors duquel Kyle voit finalement la photo de Sarah Connor, que son propre fils lui avait donnée, brûler sous ses yeux. Un fondu enchaîné superpose alors la photo en train de se consumer dans les flammes et le visage de Sarah Connor dans le moment où Kyle la tient endormie dans ses bras comme si elle sortait, en 1984, des flammes de la photo future.
Terminator, James Cameron, 1984
Le feu dans le téléviseur et le feu qui détruit l’image photographique semblent ainsi former un écho visuel où ce sont à chaque fois les images qui disparaissent. Pourtant, l’absence d’écran n’empêche pas la production d’une image. Les petites filles ne paraissent pas seulement se chauffer auprès du téléviseur. Elles contemplent le feu dans la boîte fermée du téléviseur avec une fascination aussi grande que s’il s’agissait d’une image de flammes. L’absurdité matérielle même d’un feu qui pourrait demeurer tranquillement dans la boîte d’un téléviseur comme si c’était un foyer témoigne bien du caractère imaginaire de cette scénographie. Mais tout se passe comme si ces fillettes gagnaient sur tous les tableaux : elles se chauffent pour de bon grâce au feu et elles en ont l’image grâce à la boîte magique qui le présente à leurs yeux. Elles le consomment par le corps et par le regard, matériellement et idéalement pourrait-on dire. Boîte magique du téléviseur parce qu’il peut accueillir un feu sans flamber lui-même et boîte magique parce qu’elle transforme une chose (le feu) en une autre chose (une image).
Ainsi que l’ont proposé Jay Bolter et Richard Grusin, la remédiation est une façon de voir
[…] comment un médium remodèle ses prédécesseurs et les autres médias contemporains. Bien que chaque médium promette de réformer ses prédécesseurs en offrant une expérience plus immédiate ou authentique, la promesse de réforme nous mène inévitablement à prendre conscience du nouveau médium en tant que médium. Ainsi, l’immediacy mène à l’hypermediacy. (Bolter et Grusin, 2010, 19, trad. libre)
Cet épisode de Terminator nous propose une remédiation intéressante puisque la télévision remédiée par le cinéma apparaît justement comme fournissant une expérience bien plus immédiate que celle du film dans la mesure où il apparaît possible de jouir à la fois de la chaleur de la flamme et de l’image de celle-ci dans la boîte du téléviseur – mais à une condition fondamentale : que l’écran ait disparu.
- Note de bas de page 2 :
-
On pourrait y opposer un film contemporain de Terminator, à savoir The Purple Rose of Cairo (1985), où le personnage principal d’un film (Tom Baxter, joué par Jeff Daniels) sort de l’écran, fasciné par une spectatrice (jouée par Mia Farrow) qui ne cesse de revenir à chaque séance. C’est donc le monde extérieur qui apparaît fascinant (alors même que l’action se situe en pleine crise économique des années 1930 et que Mia Farrow joue, elle aussi, un personnage de serveuse maladroite à la vie triste). Mais surtout le personnage de Baxter ne supprime pas simplement l’écran entre la serveuse fascinée et lui, il emporte avec lui l’univers du cinéma avec les fade-away nécessaires pour les scènes de baiser ou les coups de poing qui ne l’empêchent pas de se relever indemne. Autrement dit, le film de Woody Allen montre bien que l’écran est partie prenante d’un dispositif beaucoup plus complexe et plus riche et que sa suppression provisoire n’entraîne pas mécaniquement une « immédiateté » de l’expérience. Il s’agit même, à l’inverse, de vanter les séductions de la médiation avec le sourire final de Mia Farrow devant la magie de la danse interprétée par Fred Astaire et Ginger Rogers dans Top (...)
Il y aurait donc dans ces souterrains du futur des manières de faire des expériences grâce à l’inventivité de la misère : en recyclant un média du passé, on en vivrait plus immédiatement les vertus en se débarrassant de ce qui principalement y faisait obstacle, comme si, en fin de compte, l’écran seul interdisait l’immédiateté de l’expérience d’un média. L’écran, littéralement, ferait écran, ce serait là son vice intrinsèque. Lui seul couvrirait, cacherait, voilerait des opérations que l’on imagine mystérieuses2.
Dans ce monde caché du souterrain, dans cet univers frappé d’obsolescence et recouvert donc de la poussière du temps, pourrait au contraire apparaître la condition d’une expérience plus authentique d’un média. Ce monde serait désormais sans écran, témoignant d’une humanité reconquise sur les machines (même s’il faut pour cela ne plus avoir accès à un paisible monde extérieur et vivre une existence précaire aux côtés des rats).
Le jeu temporel du récit de Terminator contredit, en fait, ce que les héros prétendent réaliser, c’est-à-dire lutter contre les machines automatisées pour affirmer leur humanité. En effet, le cercle fermé par le biais duquel John Connor, chef de la résistance après l’apocalypse nucléaire, envoie dans le passé un de ses soldats pour protéger celle qui doit lui donner naissance montre bien une chose : la nécessité de s’auto-fabriquer ou de s’auto-instrumentaliser. Comme le commentera le petit John Connor quand le robot lui expliquera ce montage temporel complexe dans Terminator 2 (1991) : « It’s deep » (« C’est profond »). La boîte du temps apparaît en effet dans toute sa profondeur créée par l’illusion perspectiviste qui consiste à se fabriquer. La naissance est programmée comme un destin ou plutôt comme une machine. Et c’est bien parce qu’il a été conçu comme une machine (de guerre) que John Connor est devenu, une fois adulte, le chef incontesté qui a appris à tous les humains comment vivre par la lutte armée contre les machines.
On pourrait penser que Terminator 2 inverse cette logique puisque l’apocalypse nucléaire semble empêchée par les actions du jeune John Connor, de sa mère et du Terminator recyclé en adjuvant des humains. Pourtant, c’est encore parce que Sarah Connor et son fils ont été programmés depuis le futur pour être ce qu’ils devaient devenir (des combattants performants), qu’ils parviennent à rouvrir les possibles de l’avenir. Sans ces opérations, Sarah Connor serait restée une petite serveuse maladroite, uniquement préoccupée par ses sorties du vendredi soir.
Le propre de l’expérience est qu’elle n’ouvre à la connaissance du monde qu’après-coup : il faut d’abord le déroulement temporel de l’expérience pour que le récit de cette expérience soit ensuite transformable en savoir. Or, la construction temporelle rétroactive implique que la connaissance arrive avant l’expérience : en témoigne la photo de Sarah Connor que l’on voit brûler sous les yeux de Kyle à la fin de cet épisode souterrain, puisque cette photo ne sera prise qu’à la fin du film. Le fondu enchaîné du visage de Sarah Connor qui émerge de sa propre photo à un moment où elle n’a pas encore été prise montre cette production de soi avant même que l’expérience ait eu lieu. Le savoir issu de l’expérience n’est plus délivré par la traversée temporelle du monde qu’il suppose ; comme une pizza, il est livré à domicile pour occuper le temps de loisir du week-end.
Revenons en effet sur cette image du téléviseur obsolète recyclé en foyer portatif. Il s’agit bien d’une image historiquement datée puisqu’elle reprend le fonctionnement même de la télévision dans l’espace domestique : dès les années 1950, « logé au centre du foyer, l’objet [téléviseur] entre en peu de temps au nombre des équipements quotidiens ». (Gaillard, 2012, 88) Ce n’est pas simplement une métaphore, comme l’a bien analysé Johanne Villeneuve, car le téléviseur s’est installé très littéralement à la place du foyer de la cheminée familiale :
La télévision entre dans la maison comme le père Noël. Elle consolide les différentes manifestations de sa centralité en remplaçant littéralement le foyer dans le but d’occuper symboliquement l’espace central de la maison et d’accaparer l’attention imaginative. On pourrait même dire qu’elle occupera le ménage dans le sens où elle garde ce dernier occupé. La tridimensionnalité confère à l’appareil son propre espace, un monde en soi, mais coextensif avec l’espace de la maison et sans lequel la maison ne saura plus comment fonctionner. Ces deux traits formels, la tridimensionnalité et la centralité de la télévision, c’est-à-dire sa capacité à entrer dans la maison pour occuper le foyer, différencient clairement la boîte-TV de l’écran de l’écran de projection du cinéma. (Villeneuve, 2015, 77, trad. libre)
- Note de bas de page 3 :
-
Voir les analyses dès les années 1950 de Günther Anders (Anders, 2002).
Là où Terminator se présente comme un film d’anticipation sur le pouvoir mondial des machines, il nous représente, au passage, l’ancrage domestique originel de la machine à images que fut la télévision. Le feu derrière l’absence d’écran est une façon de prendre au pied de la lettre notre habitude d’allumer un téléviseur : le monde extérieur est entré dans l’espace domestique, il a été livré quotidiennement à l’instar de l’électricité et de l’eau pour le plus grand confort des ménages3. Et le film propose de même de livrer non seulement le monde extérieur présent, mais le monde futur dans l’espace domestique du congé de fin de semaine.
Alors que la télévision, comme la radio, relève d’une physique des ondes dont le creuset sensoriel est celui de la voix ou plus généralement du son, le cinéma est une écriture de la lumière et des projections phantasmagoriques. En éliminant l’écran, la remédiation cinématographique de la télévision refait de la boîte-télé une lanterne magique chargée non plus même de proposer un théâtre d’ombres mouvantes, mais le seul spectacle de la production lumineuse : n’oublions pas qu’avant de désigner le support vertical d’une lanterne magique depuis le XVIIIe siècle, le premier sens d’écran est « pare-feu ».
Cependant, par son aspect de feu primitif, cette remédiation montre aussi le caractère « animiste » de la télévision.
Contrairement au cinéma, dont l’image la plus répandue résulte d’une projection surdimensionnée dans un espace public, le produit d’une splendeur qui nous échappe, mais sur lequel nous restons rivés d’une façon phantasmatique, la télévision est un moyen de convivialité, moins fantasmagorique qu’animiste, parce que les petits bonshommes qui habitent sa boîte, comme des marionnettes et leur petit théâtre, sont aussi à l’image de ce que nous sommes, les habitants de nos salons, de notre maison, de nos demeures, partageant avec notre maison une temporalité commune réglée par le quotidien. Ils viennent à nous, mystérieusement liés aux ondes hertziennes, et nous les recevons sans nostalgie. (Villeneuve, 2015, 83, trad. libre)
La proposition de Johanne Villeneuvde de considérer le caractère animiste de la télévision va de pair avec une certaine conception de la temporalité. Comme l’a bien fait remarquer l’anthropologue Philippe Descola, l’animisme ne suppose pas, comme dans la conception occidentale, un temps irréversible, cumulatif, non réversible, ou, comme dans la conception analogique, un temps cyclique où un individu met fin par son action à un cycle pour un instaurer un autre, mais une temporalité aplatie, une constante répétition de l’instant (Descola, 2005). C’est pourquoi la télévision ne peut être un média de la nostalgie à la différence de la photographie ou même du cinéma. La temporalité hallucinée du quotidien domestique la renvoie sans peine à la centralité préhistorique du foyer primitif.
Cette domesticité prend la forme même de la boîte. Un téléviseur est, en effet, avant toute chose une boîte dont la façade est faite d’un verre opaque à l’extérieur, mais photosensible à l’intérieur. La télévision promeut l’espace domestique comme cet espace heureusement clos où la lumière, elle aussi, provient de l’intérieur. Le monde extérieur y est d’autant mieux livré quotidiennement que sa « transportabilité » sous forme d’émissions miniatures l’a déjà domestiqué. Là où le visage énorme de la star en gros plan nous domine, les corps rapetissés pour entrer dans la boîte du téléviseur apparaissent, en quelque sorte, comme des bibelots sonores dont l’inanité n’abolit pas le potentiel d’animation.
Dans ce passage de Terminator, l’écran disparu du vieux téléviseur montre immédiatement la première des techniques, celle du feu. Cependant, cette image de boîte mécanique et de feu fascinant a été en retour exportée dans le monde extérieur pour le constituer comme apocalypse. De la réconfortante flamme domestique au feu nucléaire généralisé, voilà comment on pourrait résumer l’histoire de l’humanité. Mais, de même que la linéarité temporelle est inversée avec l’envoi dans le passé du père de John Connor né, pourtant, après lui, ce que propose le film est l’inverse de cette histoire de l’humanité en retrouvant dans la boîte télé post-apocalyptique les flammes domestiques de la caverne préhistorique. Cependant, l’important est de voir qu’elles sont justement positionnées dans un appareil de médiation obsolète, qui porte donc en lui les marques du temps. Ce que révèle l’apocalyse cinématographique, c’est l’immédiateté phantasmée de l’image télé, la mise en boîte du feu primitif, la fausse présence de l’origine. Si Peter Szendy et Jean-Luc Nancy font bien remarquer que la structure du cinéma n’est pas celle de la caverne platonicienne au sens où elle ne reflète pas un dehors, mais ouvre le dedans sur lui-même (Szendy, 2012, 142-142 ; Nancy, 2001, 45), l’éventrement de la boîte télé l’exhibe par sa remédiation même.
Depuis Michel de Certeau, on a souvent fait l’éloge du bricolage et conçu le recyclage comme une méthode de détournement de pouvoirs et de revalorisation de marchandises. Mais le bricolage offre aussi le côté plus inquiétant de changer les salariés en travailleurs du dimanche. Quant au recyclage, il force à récupérer des marchandises périmées pour les remettre dans le circuit des produits. C’est bien ce qui arrive à ce vieux téléviseur : même s’il y avait de l’électricité pour le faire fonctionner, il n’y aurait pas de programmes à diffuser, sinon ce programme archaïque par excellence que représente une bonne flambée. Le bricolage est une manière de nous faire remonter l’échelle de l’espèce vers de pseudoorigines et de nous remettre dans les pas laborieux de l’homo faber que nous sommes censés avoir été.
Un événement ne se réduit pas à l’instantanéité de son apparition contingente : l’instant de son émergence est repris et répété, documenté et monumentalisé. Il y a eu événement parce que l’on a mis plus dans ce qui est arrivé que ce qui est arrivé, ne serait-ce que par sa réitération dans des nouvelles. Dans Terminator, cependant, la nouvelle précède ce qui arrive. La raison que donne Kyle pour s’être porté volontaire est justement qu’il voulait rencontrer « la légende ». Cette serveuse quelconque qui ne semble désirée par personne (elle est lâchée de manière ouvertement négligente par celui avec qui elle était censée sortir ce vendredi soir) devient éminemment désirable à partir du moment postérieur où elle apparaît comme une légende. C’est non ce qui la précède, mais ce qui la suit qui produit la rencontre. Or, dans les années 1980, le cinéma n’est plus le média des nouvelles. La télévision a pris complètement en charge le régime de l’information et des événements. C’est d’ailleurs par la télévision que Sarah apprend les morts inquiétantes de deux autres Sarah Connor. Quelle est alors la nouvelle, archivée dans le futur, qui nous parvient par les souvenirs de Kyle ? Dans la caverne souterraine, la télévision sans écran apporte la nouvelle du feu domestiqué : l’humanité postnucléaire recommence au début de son âge technique. Elle réitère à sa manière cette phrase qui reste justement dans nos mémoires parce qu’elle est tranquillement prononcée par le robot tueur qui énonce par là sa structure cauchemardesque de revenant du futur : « I’ll be back » (« Je reviendrai »).
3. Janet Cardiff, l’écran vidéo promené
Je voudrais maintenant examiner une autre sorte de promenade. Une promenade qui, cette fois, compose l’essentiel de l’action et propose une autre relation à l’écran. Ce dernier est rendu invisible non plus par une traversée de sa matérialité au profit du représenté, mais par l’expérimentation même qu’on en fait.
Janet Cardiff fait partie de ces artistes qui proposent des installations où, comme le signale Josette Féral, la représentation cède à l’expérimentation et où se mêlent théâtralité et intimité (Féral, 2013). Janet Cardiff fait en particulier des vidéos sur les sites où elle expose, des sortes d’audio-vidéo-guides racontant des histoires à intrigue amoureuse ou policière, mais des intrigues trouées, hésitantes, dont on n’a en fait que des bribes et qui s’opposent aux bouclages temporel et narratif bien délimités de films comme celui de James Cameron. Elle entraîne ses spectateurs avec elle grâce à la voix qui narre cette intrigue, mais aussi ordonne les stations et les déplacements de ces derniers.
- Note de bas de page 4 :
-
Janet Cardiff en collaboration avec George Bures Miller, Conspiracy Theory / Théorie du complot, 2002, Promenade audiovisuelle, 16 minutes 40 secondes, Collection du Musée d’art contemporain de Montréal.
- Note de bas de page 5 :
-
Janet Cardiff insiste sur l’enregistrement sur place afin d’avoir la même acoustique :http://www.cmoa.org/intemational/html/forum/cardiffresponse.htm
Ainsi en va-t-il de la « Théorie du complot » qu’elle a réalisé au Musée d’Art Contemporain de Montréal en octobre 20024. Le participant (ce terme est sans doute plus juste que celui de spectateur) reçoit une caméra vidéo Mini-DV avec écran plasma latéral, chargée du film tourné, et un casque d’écoute ; il doit s’installer à un endroit précis (sur un canapé et non sur le fauteuil qui est à côté) au deuxième étage du Musée d’où tout commence. Lorsqu’il s’y trouve, il met en marche la vidéo et suit simultanément l’intrigue racontée, voire par moments jouée, et les indications de déplacement dans le musée : le classique « tour guidé » du musée prend des détours médiatiques singuliers. En circulant dans les lieux mêmes où l’action s’est déroulée, en voyant autour de soi les mêmes escaliers, les mêmes peintures, les mêmes colonnes que sur son écran vidéo, avec un paysage sonore qui est celui du musée5 faisant écho à celui dans lequel il déambule effectivement, mais avec des personnes qui passent près de lui différentes de celles qu’il voit sur le petit écran dans le cadre de l’intrigue, le participant ne peut manquer d’éprouver un sentiment d’étrangeté devant pareil dédoublement ou débordement de l’écran. Étrangeté qui est aussi celle dans laquelle le récit nous entraîne puisqu’il commence sur un rêve autant que sur un meurtre : « Last night I dreamt that I killed a man » (« La nuit dernière, j’ai rêvé que j’avais tué un homme »).
- Note de bas de page 6 :
-
Sur la mobilité, voir l’analyse de Walter Moser (Moser, 2013).
Rêverie d’un promeneur qui n’est rien moins que solitaire, le participant est alors simultanément pris par l’intrigue miniature et par le spectacle grandeur nature des murs et des personnes étrangères autour de lui. En fait, il les découvre par là même : des murs que l’on n’aurait pas regardés autrement, des personnes que l’on n’aurait pas remarquées par ailleurs, comme ce complot qui demeure mystérieux. Il y a à la fois une dislocation des phénomènes occasionnée par un semblable dédoublement et un curieux rassemblement des êtres et des choses qui nous entourent, générant à la fois synchronisation et désynchronisation. Nous sommes immergés dans l’intrigue en un sens très différent de l’expérience du spectateur, qu’il soit de cinéma ou de télévision, puisque le déplacement in situ nous remet dans les pas supposés des personnages tout en décalant notre perception par rapport aux éléments qui nous environnent. Nous acquérons moins des connaissances du complot ou du musée que nous n’en faisons une expérience singulière. Histoire d’un rêve, d’un désir ou d’un événement passé, la voix qui nous guide dans l’espace et nous renseigne sur le complot requiert de nous une parfaite synchronisation : « Synchronize your movements with mine. Point the camera where I point it. Do you see the stairs in front of you ? Get up. Follow the image on the screen. » (« Synchronise tes mouvements avec les miens. Pointe la caméra où je la pointe. Vois-tu les escaliers en face de toi ? Lève-toi. Suis l’image qui est sur l’écran ») Nous entrons ainsi dans ses gestes au fur et à mesure que l’écran nous les découvre « à la vitesse d’un marcheur pensant » (« at the speed of a thinking walker »), précise l’artiste (Schaub, 2005, 74). La mobilité requise n’est pas simplement affaire de déplacement, mais de rythme : synchronisation et lenteur sont de mise6.
Ne commençons-nous pas à faire alors partie du complot, en circulant ainsi dans des salles du musée qui nous intéressent moins par leurs peintures que par leur effet de décor, croisant des gens qui nous regardent eux aussi avec curiosité, dans la mesure où ils ne peuvent pas ne pas remarquer notre comportement inhabituel ? Le terme de « complot » vient de la pelote, cette petite boule constituée de fils croisés de façon très serrée, auquel le préfixe cum ajoute encore à l’idée de rassemblement – mais un rassemblement de particuliers, secret, un rassemblement qui se fait oublier. Et, de fait, dans le récit qui est joué sous nos yeux ou raconté par la même voix qui nous dit de descendre maintenant quelques marches ou de prendre cette porte à droite ou de nous arrêter en plein milieu du hall central du Musée, il est bien question d’un complot, dont on n’aperçoit que quelques fils : un chanteur poursuivi et tué, une femme mystérieuse, une voiture filmée en vitesse normale puis au ralenti dans le garage de la Place des Arts avec au volant deux personnages qui ressemblent à des gangsters typiques.
Pourtant, il n’y a pas à proprement parler de « théorie » du complot. Sauf si l’on prend théorie dans son sens ancien : le theoros est le témoin, celui qui a vu et peut transmettre aux membres assemblés de la cité des informations fiables, quelqu’un qui a autorité pour voir ce qui se passe (dans la Grèce antique, les femmes, les enfants ne sauraient, ainsi, être des theoroï) ; par extension, quand l’assemblée envoie certains de ses citoyens vérifier, par exemple, la présence ou l’absence d’ennemis, ce groupe est appelé en un pluriel collectif la theoria. Le complot se déroule donc bien sous nos yeux, mais nous en sommes les theoroï, plutôt que nous n’en avons ou n’en faisons la théorie. C’est pourquoi la promenade nous fait emprunter des couloirs du musée interdits au public, nous fait passer à côté ou même nous fait stationner debout, assis, en face de postes de sécurité, nous fait même sortir de l’espace proprement muséal pour aller dans le garage où le meurtre semble avoir eu lieu. La théorie ne se présente pas comme une instance extérieure à ce qui est raconté, qui la surplomberait ; elle consiste immédiatement en ce que nous vivons. En même temps, les interprétations que nous formons de nos perceptions, le crible de notre intelligence et des savoirs qui l’informent, opèrent bien comme des microthéories toujours présentes dans le moindre événement dont nous pouvons témoigner.
Les seuls éléments « théoriques » qui nous sont livrés sont, au moment où nous descendons avec précaution l’escalier du Musée, quelques réflexions sur le déjà vu, comme si c’était là, en fait, que résidait la véritable théorie de l’expérience que nous faisons. Le « déjà vu » est cette pathologie qui nous fait croire que nous revivons un moment présent comme si nous l’avions déjà vécu. Or, en suivant Bergson, on pourrait voir cette appréhension des phénomènes non comme une banale pathologie, mais comme une structuration de notre rapport au temps : pour comprendre comment des présents successifs passent dans ce que nous appelons le passé, il nous faut en effet saisir que chaque présent est dédoublé entre la perception qui disparaît dans l’instant suivant et le souvenir qui demeure dans la mémoire. Autrement dit, le présent ne passe pas dans la mémoire, le souvenir se compose déjà dans mon présent et constitue ainsi un élément en relation avec tout mon passé. Le phénomène du déjà vu révèle en réalité ce dédoublement nécessaire entre perception actuelle et souvenir virtuel.
- Note de bas de page 7 :
-
Voir la stimulante réflexion de Johanne Lamoureux (Lamoureux, 2001).
La promenade composée par Janet Cardiff nous amène à faire l’expérience de ce double jeu entre la perception du monde qui nous environne et le souvenir conservé sur l’écran que nous contemplons, unis, comme dans l’expérience du déjà vu, par la voix qui raconte et, surtout, qui guide aveuglément nos pas, nos gestes, nos arrêts. Même les acteurs de la vidéo sont eux aussi peut-être déjà vus, dans la mesure où il ne s’agit pas de professionnels : ils font partie du personnel du Musée. Ce ne sont pas seulement les lieux, mais aussi les gens qui travaillent dans ces lieux que Janet Cardiff utilise pour élaborer ses Promenades, comme si, de l’actuel de la situation, surgissaient à chaque fois les possibles d’autres existences que visualisait l’écran vidéo. En ce sens, cette œuvre n’est pas seulement in situ, mais, comme on dit en anglais, site specific7.
Par ces scénarios et ce dédoublement des perceptions, la Promenade met dans l’espace la bifurcation du temps lui-même. Elle exemplifie à la fois ces bordures temporelles qui découpent les perceptions et ce débordement intérieur du temps qui fait notre mémoire. Il peut ainsi arriver qu’une image en couleurs du chanteur, écroulé à terre, avec à ses côtés une femme dont on ne voit que les pieds soit reprise dans une seconde image qui montre la première comme une photo en noir et blanc tenue par deux doigts de femme en couleurs. Par cette médiation du film vidéo, en dirigeant notre attention, mais aussi notre « inattention », Janet Cardiff montre les scénarios immédiats qui nous bordent et nous débordent, comme si nous avions accès par ces effets à l’archivage de l’expérience.
Il n’est donc pas indifférent que cette visite guidée dans le Musée d’art contemporain de Montréal ignore les œuvres et les expositions (en nous faisant circuler dans des escaliers, des couloirs, des lieux non autorisés au public et nous fasse finalement sortir littéralement de l’espace muséal pour terminer dans un parc de stationnement) sauf une qui se trouve au sous-sol dans un recoin peu fréquenté et qui thématise justement cette question de l’archive. C’est une œuvre commandée par le MACM en 1992 à Christian Boltanski, intitulée Les Archives du Musée d’art contemporain de Montréal. Elle consiste en 336 boîtes de carton rangées sur des étagères métalliques avec devant chaque boîte une photographie et un nom : ce sont tous les employés qui ont participé à la construction du MACM. Ces boîtes sont rangées dans un étroit réduit fermé par une porte grillagée. La voix nous dit de regarder par cette porte grillagée, puis fait un zoom sur une des photos représentant un homme. Un fondu enchaîné nous découvre le même homme filmé déclarant : « We didn’t see anything or know anything was going on. We were just the builders. » (On ne voyait rien ou on ne savait rien de ce qu’il se passait. Nous étions juste les ouvriers. ») Janet Cardiff exploite donc une sorte de futur de l’archive présentée par Boltanski en remédiant la photographie par la vidéo et la boîte nommée par la parole de l’ouvrier. Elle les coordonne aussi à une mémoire des lieux : par exemple, alors que nous contemplons le grand hall du musée, des voix d’enfants surgissent dans nos écouteurs pendant que la narratrice nous apprend qu’un orphelinat se trouvait autrefois sur le site du musée. Expérience qui brouille les frontières spatiales et temporelles en constituant ce que Fischer appelle à juste titre une « achéologie d’un lieu fictif et réel » (« archeology of fictional and actual place ») (Fischer, 2004, 57).
Cette archè fonctionne, en effet, comme le veut l’étymologie : commandement et commencement. L’écran ne fait pas simplement voir, il dirige le regard en même temps que le participant pointe la caméra vers ce qu’il doit contempler comme s’il le filmait. Janet Cardiff peut aussi renverser la perspective, avec une sorte de contre-champ imaginé, lorsqu’elle désigne par l’écran et par la voix les caméras de surveillance du musée : « We’re being watched » (« Nous sommes surveillés »). Le complot nous intègre : nous sommes nous aussi vus et poursuivis comme ces personnages dont la vidéo semble raconter des bribes d’histoire et que nous poursuivons à notre tour. Ainsi que le souligne Marie Fraser, « la promenade revient dans le passé et se présente à lui. Ce retour du temps dessine une spirale : le passé s’inverse en quelque sorte et se présente à nous comme un futur » (Fraser, 2005, 121). Ainsi, l’exigence de synchronisation entre le récit et les ordres de déplacement alimente en fait une désynchronisation systématique de l’expérience du participant qui légitime alors ce jeu entre passé et avenir.
Cette impression d’archive du futur est finalement renforcée par le dispositif de participation. Comme le remarque Olivier Asselin : « Ces intrigues favorisent évidemment l’immersion. Mais le dispositif technologique vient l’approfondir. Il suscite un type particulier d’identification [...] : l’usager s’identifie à la caméra, aux écouteurs et plus généralement au dispositif technologique, il épouse un regard et une écoute, il vient occuper un autre corps. » (Asselin, 2013, 110-111) A la différence de l’écran du téléviseur des années soixante qui a besoin de la profondeur de la boîte pour recevoir les électrons projetés par le tube cathodique qui balaient son écran, l’écran plasma commercialisé à partir des années 1990 est presque plat et permet de fonctionner comme un admoniteur (dans la peinture classique) ou un pointeur laser (dans les usages modernes). Dans l’usage participatif que propose Janet Cardiff, il est le prolongement simultané de notre index qui désigne et de notre regard qui appréhende.
Plus encore, la vitesse du « thinking walker », que décrit Janet Cardiff, doit être pris (si l’on peut dire) au pied de la lettre. En effet, depuis le XVIIIe siècle où la promenade devient un genre d’écrit et un mode de communication (Sert, 2014), elle devient aussi un modèle pour le fonctionnement de la pensée. Ce n’est plus seulement la méthode comme chemin soigneusement ordonné qui est mobilisée pour penser, c’est le cadre plus relâché de la promenade-entretien qui parvient à rendre compte de la pensée comme processus et surtout processus d’association d’idées. Voilà pourquoi les Promenades de Janet Cardiff suscitent chez les participants une activité qui n’est pas seulement de découverte d’objets, de lieux ou de personnages, mais un processus de pensée. L’écran plasma de l’appareil vidéo est alors d’autant plus invisible (malgré sa matérialité très évidente et le regard dédoublé qu’il implique) qu’il engage le participant à le mobiliser comme s’il devenait une extension de sa main, de sa marche, de son regard, de sa pensée.
On le mesure d’autant mieux lorsqu’on entreprend de refaire cette promenade en 2015 : elle est devenue impossible. On est revenu de l’art comme expérimentation à l’art comme représentation. Le format MiniDV utilisé par Janet Cardiff en 2002 a presque complètement disparu depuis l’avènement de la HD avec sa carte mémoire en 2008. Les bandes Mini-DV étaient assez fragiles et leur durée de conservation estimée à une vingtaine d’années tout au plus. C’est pourquoi le MACM a transféré la vidéo sur un support DVD, mais qui est lisible seulement dans la médiathèque du Musée sur ordinateur fixe. Voudrait-on refaire d’ailleurs la promenade elle-même que l’on ne pourrait en faire l’expérience comme telle, puisque l’aménagement du Musée a changé, certains des couloirs autrefois empruntés sont désormais inaccessibles et la sortie vers la Place des Arts et le stationnement n’existe plus. C’est à une archive du passé que l’on a désormais affaire et à un écran si visible qu’il fait justement écran à l’expérimentation qui était jadis possible.
4. Conclusion
Nous avons donc eu affaire à deux exemples très différents d’invisibilité du cadre. L’un qui faisait disparaître l’écran d’un téléviseur obsolète remédié dans un film apocalyptique ; l’autre qui incluait tellement le participant dans le geste de porter, regarder et marcher avec une caméra vidéo sous les yeux que l’écran devenait une extension du corps et de la pensée. Cet effacement de l’écran vient non seulement de dispositifs médiatiques différenciés, mais aussi des temporalités dans lesquelles il est produit, au point de nous amener au paradoxe d’une imaginaire archive du futur pour mieux concevoir l’invisibilité d’un écran que l’on a, pourtant, sous les yeux.