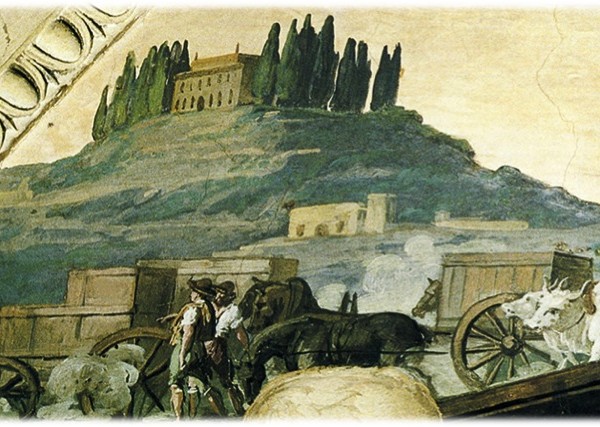Séminaire de l’IiRCO « Conflits, droit, mémoires » : Conférence 4 : Prendre à l’ennemi, rendre au vainqueur
Le 25 février 2016, Xavier Perrot, maître de conférences HDR en histoire du droit (OMIJ, Université de Limoges), a tenu une conférence dans le cadre du séminaire de l’Institut international de recherche sur la conflictualité (IiRCO) « Conflits, droit, mémoires » sur Prendre à l’ennemi, rendre au vainqueur, Histoire du traitement juridique de la circulation des patrimoines culturels en période de conflit. À l’issue de cette conférence, il a accordé un entretien à l’IiRCO dont on trouvera ci-après le compte-rendu.
Voir les photos de la conférence sur la page Facebook de l’IiRCO
IiRCO – Quelles sont les origines historiques des prises de guerre dans le domaine artistique ? Quel est leur statut et l’usage fait de ce type de butin ?
Xavier Perrot – C’est avec Rome qu’apparaissent les premières spoliations systématiques au nom de l’esthétique. Avec le pillage de Syracuse par Claudius Marcellus (en -212), les victoires militaires deviennent la source régulière d’objets précieux et d’ornements de la cité. C’est durant cette période que les tableaux et les statues « étrangers », c’est-à-dire alors grecs, prennent la place des armes dans les trophées.
Le transfert des œuvres d’art à Rome prend tout son sens par l’institution des spolia. Ces spolia, dépouilles de la victoire, sont remployées dans les monuments de la ville et destinées à embellir la cité, tout en magnifiant le pouvoir politique et en assurant l’éternité de Rome. À Rome, le droit au butin (ius pradae) et l’ostentation du triomphe renvoient donc au pouvoir et aux façons de dominer, bien plus qu’à l’esthétique. Érigée en système politique, la spoliation constitue la loi commune. Tite-Live invoque ainsi le droit de la guerre (jus belli) pour légitimer les transferts d’œuvres d’art, quant au droit de Justinien il consacre ce principe. Si dans le monde gréco-latin les lieux de culte et les objets sacrés sont dans l’ensemble préservés parce qu’ils appartiennent au monde du divin et à l’économie générale du sacré, la pratique militaire conduit souvent à piller des villes entières, y compris leur patrimoine religieux : ce fut le cas à Corinthe et à Carthage bien sûr (tout le monde a en tête la formule de Caton l’ancien, delenda carthago). Des voix vont cependant s’élever contre ces comportements excessifs, sans toutefois remettre en cause le droit de butin (ius pradae) sur les œuvres d’art. Parmi les contestataires, Cicéron tient une place centrale, notamment avec son célèbre réquisitoire contre le préteur Verrès, pilleur patenté d’œuvres d’art grecques et siciliennes. Si Cicéron ne discute pas la légalité des spolia et du ius pardae, il insiste, dans sa rhétorique stoïcienne, sur la nécessité de limiter les captures « par devoir d’humanité ». Cet humanitas patrimonial (si l’on peut dire) se mue alors en poncif de la littérature : on le retrouve ainsi chez Salluste (Conjuration de Catilina) et surtout chez Polybe, qui avait participé à la destruction de Carthage et avait appris celle de Corinthe. Ces lettrés n’ignorent pas en effet que la mémoire collective rechigne à éliminer le souvenir de son patrimoine culturel exilé ou détruit ; le lien identitaire avec le patrimoine culturel est généralement tellement fort qu’il freine l’oubli. Mais ces contestations savantes ne dépassent guère le cercle des élites cultivées et surtout ne pénètrent pas le droit ; le droit de conquête et les transferts d’œuvres d’art restent le droit commun, sous l’Empire et après.
IiRCO – Pourquoi la pratique de ces transferts artistiques se généralise-t-elle ? Où les œuvres d’art sont-elles acheminées et quels circuits suivent-elles ?
Xavier Perrot – Confiscations et pillages deviennent l’apanage des nouveaux maîtres après la chute de l’empire romain, tant en Occident qu’en Orient. L’art de l’empire est en effet l’objet de toutes les convoitises, tout comme les chefs-d’œuvre de l’art grec, car ils ne cessent de fasciner tant par leur qualité esthétique que par l’imaginaire politique qu’ils véhiculent. Confisquer de tels objets et les transférer dans les nouveaux lieux de pouvoir revient à s’approprier une partie, voire le tout, de leur puissance symbolique, afin de faire revivre la grandeur dont ils continuent de témoigner. Les chefs-d’œuvre de Praxitèle (Aphrodite de Cnide) émigrent ainsi de la Grèce vers Constantinople, nouvelle capitale de l’empire romain d’Orient ; et plus tard Charlemagne fait venir de Ravenne à Aix-la-Chapelle, dans la tradition romaine de l’ornatus, la statue équestre de Théodoric et des colonnes de Porphyre, colonnes qui à leur tour seront prises par Napoléon pour orner la salle des grands hommes du Louvre.
IiRCO – Le statut des œuvres convoitées, sacrées ou profanes a-t-il des conséquences sur la constitution des prises de guerre et de leur conservation ?
Xavier Perrot – La diffusion du droit justinien après sa redécouverte au XIème siècle offre un surcroît de légitimité aux transferts d’œuvres d’art, sans pour autant exclure totalement de la pratique militaire toute modération ; c’est le cas pour les biens affectés à un usage religieux. Quant aux œuvres profanes, elles ne bénéficient d’aucune protection particulière ; elles font même l’objet d’un important trafic dans les milieux lettrés, c’est le cas du célèbre Aigle de Suger, qui est le remploi d’un vase antique en porphyre sur une monture de la première moitié du XIIème siècle. Il faut toutefois souligner que la conservation de certains monuments profanes est parfois encouragée et très précoce : à Rome, la colonne Trajane est par exemple protégée dès 1162 par un décret du sénat romain daté du 25 mars 1162. Mais dans l’ensemble, seuls les biens remplissant une fonction religieuse sont respectés jusqu’à la fin du Moyen Age.
IiRCO – Quels changements s’effectuent à partir de la Renaissance ? En quoi le XVIIIème siècle constitue-t-il un tournant concernant la réflexion juridique sur les biens de guerre ?
Xavier Perrot – Avec la Renaissance, le rapport aux œuvres d’art évolue ; elles acquièrent un nouveau statut, ce qui éveille l’intérêt de la doctrine juridique, notamment celle dite du droit naturel. Le plus célèbre d’entre les juristes appartenant à cette mouvance est Hugo Grotius qui, dans son Droit de la guerre et de la paix, insiste sur le fait que les choses sacrées et religieuses échappent par nature à la guerre ; celles-ci « ne peuvent être profanées sans violer l’humanité », dit-il. Mais immédiatement après cette affirmation, très réaliste, il rappelle que « le droit des gens accorde [néanmoins souvent] l’impunité à la colère s’exerçant sur ces choses ». À côté de ces biens sacrés, Grotius évoque également les « choses d’embellissement », pour désigner les œuvres d’art profanes qui méritent également certains égards ; cela dit, on ne va pas beaucoup plus loin que ces déclarations de principe… C’est seulement véritablement au XVIIIème siècle qu’un changement de paradigme a lieu. Deux juristes suisses, Jean-Jacques Burlamaqui et Emmer de Vattel, vont en effet déclarer que autant les œuvres sacrées que les œuvres d’art profanes sont dignes de protection en période de guerre. Pour les deux auteurs, leur préservation est justifiée par devoir d’humanité, on retrouve là l’humanitas de Cicéron. Emmer de Vattel déclare en effet : « Pour quelque sujet que l’on ravage un pays, on doit épargner les édifices qui font honneur à l’humanité, et qui ne contribuent point à rendre l’ennemi plus puissant : les temples, les tombeaux, les bâtiments publics, tous les ouvrages respectables par leur beauté. Que gagne-t-on à les détruire (et les déplacer) ? C’est se déclarer l’ennemi du genre humain que de le priver de gaieté de cœur de ces monuments des arts, de ces modèles du goût. » Malgré tout, si l’on constate une sensibilisation des juristes pour ces questions, le droit au butin (ius pradae) n’est toujours pas exclu du droit de la guerre. C’est ce que constate encore au XVIIIème siècle, un peu gêné, un juriste français (Joseph Pothier) qui déclare qu’il faut « laisser aux théologiens le soin de décider si cette manière d’acquérir, qui est légale, suivant le droit rigoureux de la guerre, peut se concilier avec les lois de la charité. »
IiRCO – En quoi la Révolution et l’Empire constituent-ils un moment clef dans l’appréhension du statut des œuvres d’art ? Quel est le théoricien principal de cette réflexion davantage morale et esthétique que juridique ?
Xavier Perrot – La Révolution française et l’Empire rendent particulièrement caduques « les lois de la charité » : vandalisme révolutionnaire, nationalisation des biens du clergé et des émigrés, prises artistiques révolutionnaires puis impériales, sont la norme. Pour les révolutionnaires, l’art est le produit d’esprits libres ; par conséquent, la rhétorique révolutionnaire rappelle en un syllogisme parfait que seule la France libérée des chaînes de la tyrannie monarchique doit accueillir les chefs-d’œuvre de l’art universel à Paris. Le transfert de l’art européen vers Paris est justifié, Paris décrétée capitale mondiale des arts. On dit des chefs-d’œuvre transférés en France qu’« ils sont enfin sur une terre libre » : ce slogan capitalise en quelque sorte sur la théorie néoclassique de Johann Joachim Winckelmann, pour qui « l’œuvre d’art, création libre, ne peut s’épanouir qu’en terre de liberté. » Napoléon perpétue cette tradition spoliatrice, pour magnifier son régime néo-monarchique (v. travaux de B. Savoy). Mais l’empereur échoue à revenir après 1814 et c’en est fini de la domination française sur l’Europe en 1815.
Le grand savant français, Antoine C. Quatremère de Quincy, à la fin du XVIIIème siècle, est peut-être celui qui s’est exprimé avec le plus de subtilité à propos du statut des œuvres d’art en période de conflit, notamment parce qu’il a, à l’époque, pris clairement position contre le déplacement arbitraire des œuvres d’art en dehors de leur contexte. Il faut dire qu’il écrit ses fameuses lettres au général Miranda après la Campagne d’Italie menée par Bonaparte, campagne qui aboutit au transfert à Paris de nombreux chefs-d’œuvre, dont l’Apollon du Belvédère ou le Laocoon… Les 27 et 28 juillet 1798, les Parisiens ont alors l’occasion d’admirer pour la première fois les chefs-d’œuvre de la sculpture antique conquis par l’armée révolutionnaire. Une bannière, dressée au Champ de Mars, déclare : « La Grèce les céda, Rome les a perdus, leur sort changea deux fois, il ne changera plus. » La rhétorique révolutionnaire martèle que les chefs-d’œuvre de l’art européen ont naturellement vocation à être déplacés en France, une France déclarée seule vraie patrie des arts, arts délivrés désormais des régimes despotiques européens. Quatremère de Quincy lui, parce qu’il défend déjà ce que l’on appelle plus tard la conservation in situ, considère au contraire que « ces statues antiques ainsi dépaysées […] perdent sous des cieux étrangers la vertu instructive que les artistes allaient chercher à Rome et qu’ils ne retrouveront plus dans aucune autre ville de l’Europe ».
IiRCO – Quelles sont les conséquences des restitutions de 1815 sur un long XIXème siècle ?
Xavier Perrot – En 1815, après l’échec de Napoléon, la plupart des chefs-d’œuvre déplacés en France durant la Révolution et l’Empire rentrent chez eux, dans leur patrie d’origine. Pour autant, ce n’est pas la doctrine du contexte de Quatremère qui justifia, en 1815, la reprise, par les États européens de l’immense trésor accumulé. Le fondement de la restitution est en effet moins savant et esthétique, comme aurait pu le souhaiter Quatremère, que politique, puisqu’il s’agit de sanctionner le retour de Napoléon de l’Île d’Elbe. Les restitutions de 1815 constituent un évènement si considérable qu’il va contribuer à accélérer le processus de moralisation du droit de la guerre en matière de spoliation et de transfert des œuvres d’art. C’est avec lui que le droit se saisit progressivement de la question complexe du traitement juridique de la circulation des patrimoines culturels en période de conflit, question toujours actuelle qui met très souvent en tension passé et présent. Après 1815, « prendre à l’ennemi » devient un droit de plus en plus contesté (ius pradae) et « rendre au vainqueur » un principe progressivement juridicisé sous la forme du droit de la restitution au propriétaire d’origine : ce n’est plus la « victoire » qui constitue le fondement de la reprise, mais le droit.
C’est le contre-choc des reprises massives de 1815, reprises qui « nationalisent » en quelque sorte les patrimoines des États d’Europe, et provoquent le grand déploiement des musées en Europe au XIXème siècle par réappropriation identitaire d’un patrimoine de plus en plus reconnu comme national. Le XIXème siècle parachève en effet le mouvement de construction des États nations, et les œuvres d’art ont indiscutablement une fonction pédagogique et politique dans cette histoire. Cette série d’évènements va jouer un rôle déterminant dans la formation d’une véritable conscience patrimoniale européenne (certains parleront de naissance de l’histoire de l’art) et pour nous, ici, dans la moralisation du droit de la guerre en matière patrimoniale. Au début du XIXème siècle, la doctrine juridique est ainsi presque unanime à déclarer que le patrimoine culturel ne peut être intentionnellement détruit, ni arbitrairement déplacé. Il faudra par contre attendre la fin du siècle pour que la condamnation du ius pradae pénètre les textes, comme c’est le cas avec les conventions de La Haye de 1899 et 1907. Le droit international conventionnel du début du XXème siècle érige dorénavant les faits de pillage et de spoliation en véritables infractions au droit international.
IiRCO – La condamnation officielle du droit de butin met-elle un terme au débat sur le statut des œuvres spoliées et les mécanismes de restitution ? Selon quels axes se recompose le débat sur la restitution des biens spoliés ?
Xavier Perrot – On aurait pu croire totalement résolue la question des spoliations et clarifié le régime juridique des restitutions à la fin du XIXème siècle : spoliations interdites en cas de guerre, restitutions systématiques au propriétaire en cas de spoliation. Or, en la matière, les choses sont plus complexes qu’il n’y paraît et les deux guerres mondiales du XXème siècle vont le prouver. On sait par exemple que beaucoup d’objets changent de main lors d’un conflit, en dehors même des spoliations administratives, par des actes légaux en apparence – actes de cession, d’aliénation ou de disposition – qui dissimulent en réalité une véritable contrainte, car ils sont effectués alors que le propriétaire est en situation de faiblesse. Le problème est épineux ; il montre que les procédures de restitution ne peuvent pas se fonder sur la seule présomption de spoliation : en la matière, il n’est pas satisfaisant de raisonner sur le mode binaire transfert de propriété/restitution. Cette question a fait l’objet d’une intéressante querelle doctrinale à la fin du XIXème siècle. Les réflexions qui en ont résulté ont apporté de la nuance dans une matière (les restitutions) longtemps juridiquement négligée, puisqu’il s’agissait essentiellement de « rendre au vainqueur », c’est-à-dire de rendre sur le fondement de la victoire.
Comme on le voit, l’expression « rendre au vainqueur » renvoie sans ambiguïté à la contre-conquête. Tout le mérite du débat doctrinal en question est d’avoir insisté sur le paradoxe consistant à « rendre au vainqueur », c’est-à-dire au fond perpétuer le droit de conquête, ce qui revient à consacrer une certaine forme de vengeance, alors qu’il eut été légitime d’attendre un traitement juridique neutre et dépassionné de la question.
IiRCO – En quoi les restitutions de 1815 cristallisent-elles le débat juridique autour des processus de restitution ?
Xavier Perrot – L’enjeu de la discussion doctrinale était celui du statut juridique à accorder aux reprises opérées en 1815, après la défaite de Napoléon.
Deux courants se sont affrontés sur cette question : l’un légaliste, en partie hostile aux reprises de 1815 ; l’autre moraliste, favorable aux restitutions. Les opposants aux reprises de 1815, en raisonnant ici de manière légaliste, recommandent de distinguer entre les œuvres transférées, durant la Révolution et l’Empire, sans base légale après des spoliations et des vols et celles transférées sur une base légale par achat, échange, par traité. Ils considèrent que ces différents modes d’acquérir auraient dû conduire la Sainte Alliance à sélectionner les œuvres à récupérer, ce qui n’a pas été fait. Pour ces auteurs, il fallait uniquement rendre les œuvres spoliées sur le seul fondement de la victoire (ius pradae). Ils suivent en cela l’opinion de plus en plus majoritaire à l’époque (fin XIXème siècle) qui considère que les œuvres d’art sont exclues du domaine de la guerre et échappent désormais au droit de conquête. Mais à côté de telles spoliations, ils refusent de reconnaître la légalité des reprises de biens ayant fait l’objet d’une cession, à la suite d’un traité de paix par exemple. Ils distinguent ici entre l’occupant et le conquérant : l’occupant, simple possesseur, ne dispose pas de la maîtrise pleine et entière des biens de l’ennemi ; le conquérant, au contraire, devient pleinement titulaire du droit de propriété sur les biens du vaincu, après la signature du traité de paix. Il faut rappeler ici qu’une partie des transferts d’objets d’art vers la France avait en effet été validée par des traités ; c’est le cas des traités conclus par Napoléon lors de la campagne d’Italie : le traité de Parme (8 mai 1796), le traité de paix de Tolentino (19 février 1797, article 13), et le traité de Milan (6 mai 1797). Pour ces auteurs, une partie des reprises en 1815 violait donc la foi des traités, comme peut se violer un contrat. On aurait pu toutefois leur opposer que ces traités avaient été signés sous la contrainte, durant la guerre. Mais cet argument ne tient pas à l’époque, car il n’est pas reconnu par le droit international. Le juriste Jean-Louis Klüber fait en effet remarquer en 1819 que de tels traités ne peuvent être entachés d’illégalité, puisque, déclare-t-il : « La légitimité incontestable de la contrainte [induite par la victoire], tient lieu du consentement du vaincu, que celui-ci n’a pas le droit de refuser. » Perdre, c’est en quelque sorte consentir à être spolié… La doctrine légaliste n’hésita pas alors à parler de vol, à propos des reprises de 1815, notamment parce que les Alliés n’ont jamais pris la peine de sanctionner les restitutions sous la forme d’un traité (ni les traités de Paris, ni celui de Vienne de 1815 n’évoquent les restitutions). Cette opinion se retrouve d’ailleurs chez certains savants et intellectuels français qui, bien que non-juristes, s’estimèrent fondés, à la fin du XIXème siècle, à parler en l’espèce de « spoliations ». L’historien de l’art Eugène Müntz n’hésite pas ainsi, en 1897, à intituler l’un de ses articles « La spoliation de nos musées » à propos des reprises de 1815.
À l’opposé des thèses hostiles aux reprises, la doctrine moraliste leur est quant à elle très favorable. Les tenants de ce courant, tout en reconnaissant l’existence des traités de cession (napoléoniens par exemple), s’appuient moins sur une motivation juridique que morale pour justifier les récupérations. Parce que le droit est contre eux ici, en quelque sorte, la doctrine moraliste va privilégier l’équité. Loin des montages juridiques techniques, elle élabore alors une rhétorique humaniste de la justification. Le juriste Jean Gaspard Bluntschli n’hésite pas ainsi à déclarer « comme un progrès humanitaire la décision peut-être égoïste prise en 1815 par les alliés d’obliger le gouvernement français à restituer ces chefs-d’œuvre aux divers pays qui les avaient produits ». Mais ne soyons pas dupe, le « progrès humanitaire » a certainement davantage servi à masquer la sanction internationale unanimement souhaitée contre la France et Napoléon. Il convenait, en quelque sorte, de jeter un voile moral et d’équité sur une stricte opération militaire, la contre-conquête, le fameux « rendre au vainqueur ». Pour autant, Jean Gaspard Bluntschli considère que l’évènement constitue un précédent qui permet au droit international de « poser la règle que les œuvres d’art ne doivent pas être enlevées au vaincu, parce qu’elles ne servent ni de près ni de loin à faire la guerre, et qu’en s’en emparant on ne contraint point l’ennemi à demander plus vite la paix ».
Cette gestation doctrinale, sur un fondement moraliste, va alors partiellement pénétrer le droit international. Les conventions de La Haye de 1899 et 1907 en portent la trace, car elles sanctionnent le transfert des patrimoines culturels en cas de conflits armés, sans toutefois consacrer l’obligation de restituer les œuvres d’art déplacées ; en l’espèce, il faudra attendre la Convention de la Haye du 14 mai 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, qui évoque la question des restitutions dans son protocole additionnel.
IiRCO – En quoi les deux guerres mondiales, qui sont des périodes de transfert d’œuvres d’art majeures, participent-elles à cette « gestation doctrinale » en matière de restitution du patrimoine culturel spolié ?
Xavier Perrot – En dépit des conventions de La Haye, on sait dans quelle mesure les deux guerres mondiales ont provoqué des transferts illégaux d’œuvres d’art. Ce phénomène posait la difficile question de la valeur à accorder à la contrainte, en cas de cession. C’est pourquoi lors de la Première Guerre mondiale, alors que la France subit une importante augmentation des enlèvements d’œuvres d’art à partir du printemps 1917, le législateur français promulgue, le 8 novembre 1917, une loi visant à préserver les propriétés artistiques. La loi déclare que les « circonstances de guerre » constituent une cause objective de vice du consentement en cas d’acte de cession, d’aliénation ou de disposition et ce dès le début du conflit. Les dispositions contenues dans la loi de 1917 seront en partie reprises dans le Traité de paix de Versailles (28 juin 1919) contraignant l’Allemagne à effectuer des restitutions. On le voit, contrairement aux reprises réalisées en 1815, les restitutions consécutives à la Première Guerre mondiale disposent d’une incontestable base légale : malgré tout le Traité de paix reste un texte ad hoc. Quant à la Seconde Guerre mondiale, chacun sait que le pillage des œuvres d’art par l’Allemagne nazie en Europe est considérable : à nouveau, la Convention de La Haye est violée. Le pillage est systématique, car il s’appuie sur un programme idéologique d’instrumentalisation de l’art, s’apparentant à un véritable eugénisme patrimonial : entre réappropriation idéologique et destruction (entartete kunst). La France Libre juge donc utile de dénoncer dès avril 1942, sur le modèle de la loi française du 8 novembre 1917, l’existence d’une présomption de violence pour tous les transferts de propriété réalisés durant la guerre, à côté des spoliations administratives réalisées notamment par l’ERR, mais aussi la Möbel Aktion. Le 5 janvier 1943 est ainsi signée à Londres par dix-huit gouvernements une déclaration interalliée, ou Joint declaration ; immédiatement transposée en droit français (celui de la France libre, puis celui de la nouvelle France républicaine). Par cette déclaration, les gouvernements signataires se réservent le droit de déclarer nuls et non avenus tous transferts de propriété, qu’ils aient revêtu la forme soit d’un pillage manifeste, soit de transactions en apparence légales, même si lesdits transferts ou trafics étaient présentés comme ayant été effectués sans contrainte. Cette Joint declaration, au-delà même de la victoire, servit à la Libération de base légale à des opérations de restitution dans les différents droits internes.
En somme ces deux textes de 1917 et 1943 répondaient au problème des reprises fondées uniquement sur la victoire et le critère moral ; il s’agit désormais moins de « rendre au vainqueur » que de « restituer au propriétaire d’origine ». En cas de victoire comme de défaite après les deux guerres mondiales, la possession des œuvres d’art déplacées pouvait être légalement contestée, consacrant en somme le principe fixé dans les termes de la Convention de 1907 des biens culturels exclus du domaine de la guerre.
Mais si juridiquement la protection des patrimoines culturels en période de guerre est confirmé, si le fait de « prendre à l’ennemi » est interdit par le droit international et si le fait de « rendre au vainqueur » est juridicisé en droit de la restitution, les évènements récents rappellent les limites du droit et montrent combien le patrimoine artistique constitue systématiquement une cible en période de conflit : le néo-iconoclasme et le trafic organisé au Moyen-Orient le montrent dramatiquement !
BP 23204
87032 Limoges - France
Tél. +33 (5) 05 55 14 91 00