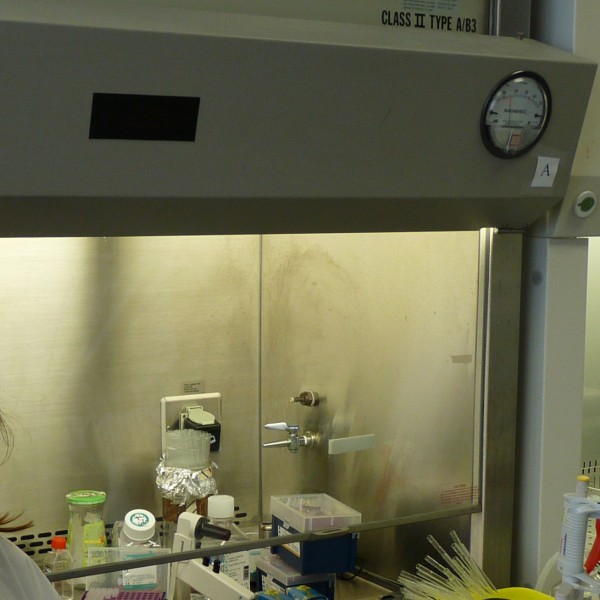Michel Cogné
L’équipe « Contrôle de la Réponse Immune B et Lymphoproliférations » rattachée à l’Université de Limoges, au CHU et au CNRS a découvert un phénomène jusqu’ici inconnu : le suicide d’un gène. Un évènement majeur de régulation de l’immunité.
Votre découverte a fait l’objet de deux publications, dans la prestigieuse revue scientifique internationale « Sciences » et dans le magazine français « Médecine Sciences ». De quoi s’agit-il ?
Les cellules de l’immunité sont les seules cellules qui peuvent remanier, découper leurs chromosomes. C’est comme cela qu’elles fabriquent toute la diversité des anticorps, en rebattant en quelque sorte les cartes de leurs gènes. Nous avons mis en évidence un type de découpage chromosomique qui n’avait jamais été observé et nous montrons que ces cellules peuvent aussi découper l’intégralité du « jeu de carte » des gènes des anticorps et les éliminer totalement. Cependant, elles ne peuvent pas vivre sans ces gènes. On a donc appelé cela une « recombinaison suicide », car elle s’avère fatale pour la cellule qui l’exécute.
Pourquoi la cellule se suicide-t-elle ?
On ne sait pas encore. C’est tout un champ de recherche qui s’ouvre. Aujourd’hui, on peut affirmer que ces cellules se « suicident » et que ces suicides sont fréquents. Cela se produit tous les jours dans l’organisme de tout le monde. Il nous reste à étudier comment ce phénomène est régulé. Est-ce un mécanisme de protection de l’allergie ? Est-ce un moyen d’éliminer les cellules dont les anticorps deviennent nocifs pour l’organisme en cas d’allergie ou de maladie auto-immune ? Les cellules aux anticorps peu performants sont-elles simplement éliminées à cause de leur inutilité ?
Vous ne savez pas ce qui a provoqué ce phénomène ?
Non. On sait qu’il provoque la mort de certaines cellules, mais on ne sait pas encore pourquoi, ni en quoi ces cellules sont différentes de celles qui sont conservées.
Ces recombinaisons chromosomiques se font sur la région des gènes appelée 3’RR sur laquelle notre équipe travaille depuis des années et est la spécialiste mondiale. Normalement, cette région active des gènes d’anticorps, mais Sophie Péron, post-doctorante dans notre laboratoire, a travaillé notamment sur la façon dont cet « interrupteur » peut, non pas allumer les gènes des anticorps, mais, dans certains lymphomes, allumer des gènes de cancers et jouer un rôle dans la transformation de lymphomes en leucémies.
Qu’implique cette découverte ?
Sur un plan fondamental, c’est un mécanisme potentiellement important dans la réponse immunitaire. Le système immunitaire repose beaucoup sur le phénomène de sélection cellulaire. Il faut sélectionner les bonnes cellules, celles qui nous protègent le mieux.
Par ailleurs, nous avons montré que la région 3’RR est aussi capable de subir des mutations au cours des réponses immunitaires. Ces mutations pourraient changer sa potentialité, ses propriétés. Cela veut dire que des cellules tumorales pourraient muter cette région pour activer leurs gènes de transformation tumorale et devenir encore plus oncogéniques.
Si on peut trouver des moyens pharmacologiques pour contrôler le phénomène, cela permettrait de faire mourir les cellules qui donnent des allergies, de l’auto-immunité ou des cancers comme la leucémie ou le lymphome.
Quelles vont être les retombées sur votre équipe ?
Les laboratoires sont reconnus en fonction de leurs publications. Ce n’est pas la première fois que nous publions dans ce type de journaux. Nous avons eu un article dans « Nature » l’an dernier en association avec un groupe américain, et un dans « Nature Immunology » cette année, en association avec un groupe parisien. Bref, nous nous battons pour appartenir au club des laboratoires qui publient dans ces revues mondiales les plus prestigieuses, surtout parce que ces publications constituent un élément d’évaluation et un sésame. Quand on dépose un projet de recherche et une demande de financement, on est jugé en partie sur son projet mais aussi beaucoup sur les publications que l’on a pu faire précédemment… Publier est donc vital !
Suite à cette publication, avez-vous eu des propositions de collaborations ?
Oui, notamment de partenaires américains. Ces données ont été présentées à Boston. Nous travaillons déjà avec des laboratoires de Harvard ou de Chicago. Nous coordonnons un projet ANR avec des équipes de Strasbourg et de Paris. Nous sommes dans beaucoup de réseaux de recherche au niveau national et international car, même si nous sommes heureux de pouvoir clamer aujourd’hui un travail « made in Limoges », nous savons que la recherche actuelle est un travail d’équipes et de réseaux.
J’ai commencé à chercher des partenaires en France pour tout ce qui va être application aux tumeurs, car pour travailler sur des cancers, il faut avoir accès à des collections de cellules tumorales et on en a rarement assez sur un seul site. Nous avons reçu des échantillons de laboratoires de Rouen et de Rennes. Nous avons par ailleurs beaucoup de relations cliniques avec le CIC (Centre d’Investigation Clinique du CHU de Limoges).
Comment se sent-on quand on fait une telle découverte ?
Très excité pendant des mois en se disant « pourvu qu’on soit les premiers ! »… et très paniqué à l’idée que quelqu’un d’autre publie avant nous. Surtout que les laboratoires capables de faire des séquençages de génome entier toutes les semaines auraient pu voir ces choses-là. Mais ils n’ont pas eu l’idée de les chercher.
Et vous comment avez-vous eu l’idée de chercher ce phénomène ?
Je dirais plutôt, comment n’y ai-je pas pensé plus tôt ? Cela fait 15 ans que l’on travaille sur cette région. On l’a séquencé en 1996. Elle a une séquence très originale en immense palindrome (c’est-à-dire que c’est une séquence que l’on peut lire dans les deux sens). A cette époque, j’avais fantasmé sur les recombinaisons, mais nous n’avions pas les outils ni la conviction nécessaire pour rechercher ces recombinaisons. Sophie Péron a remarqué l’an dernier que cette région d’ADN peut être transcrite, ce qui est une autre caractéristique des régions accessibles aux recombinaisons. Cela a fait tilt, et j’ai alors demandé à Sophie de se lancer à la traque de recombinaisons larges, qui aboutiraient à la mort cellulaire. Si ces recombinaisons n’avaient pas tué les cellules, les chercheurs les auraient vues depuis longtemps, parce que les cellules auraient été disponibles. Mais là, toute la difficulté était de trouver un phénomène qui s’autodétruit. Il fallait vraiment qu’on caractérise le phénomène au moment où il se produit. C’est ce qu’on a fait.
Contact : Michel Cogné